6.0 Les métiers et l’apprentissage dans le contexte du marché du travail
6.1 Introduction
6.1.1 Objectif
Ce chapitre examine l’influence générale des métiers et de l’apprentissage sur le marché du travail canadien. Bien que la question demeure liée à la réussite des programmes d’apprentissage et l’obtention d’un certificat professionnel, ce chapitre aborde les effets macroéconomiques de la réussite, et il nécessite donc une approche plus générale que celle utilisée dans les chapitres restants.
Plus particulièrement, les effets de l’apprentissage et des formations dans les métiers sont examinés des perspectives de l’offre et de la demande. La perspective de la demande fait référence à la demande générale sur le marché du travail dans les métiers et au rôle des formations dans les métiers et de l’apprentissage afin de répondre à cette demande. De cette perspective, les apprentis contribuent au marché du travail durant et après leur formation d’apprentissage. Du côté de la demande, ce chapitre examine la proportion d’apprentis selon les différents métiers, la province, le groupe d’âge, le sexe, le statut d’immigrant et l’identité autochtone.
De la perspective de la demande, on peut considérer les formations dans les métiers et l’apprentissage comme une éducation de niveau postsecondaire.Note de bas de page 45 Par rapport à la demande, ce chapitre examine les inscriptions aux formations dans les métiers et à l’apprentissage, l’achèvement de ces programmes de formation, de même que les tendances associées à l’inscription à l’apprentissage, la réussite des formations dans les métiers et l’obtention d’un certificat professionnel dans divers groupes démographiques.
Ces deux perspectives sont réunies grâce à un examen des projections associées à l’offre et la demande en utilisant les projections du Système de projection des professions au Canada (SPPC) allant jusqu'à 2020 dans les métiers choisis, et par rapport à ces inscriptions aux programmes d’apprentissage et à leur réussite.
6.1.2 Contexte
La question de l’offre et de la demande en personnes de métier sur l’ensemble du marché du travail a retenu l’attention des décideurs canadiens, comme l’indiquent les nombreux programmes d’encouragement visant à faire augmenter le nombre des apprentis. À l’échelle fédérale, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a lancé plusieurs programmes semblables au cours des dernières années, dont la Subvention incitative aux apprentis, la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, le Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis et la déduction des frais liés aux outils des gens de métier.Note de bas de page 46
Plusieurs régions canadiennes ont aussi lancé des initiatives stratégiques liées aux métiers et à l’apprentissage au cours des dernières années. En voici quelques exemples :
- l’Ontario et l’Alberta ont lancé des programmes visant à encourager les élèves de niveau secondaire à entreprendre une carrière dans les métiers en leur permettant de commencer une formation d’apprentissage par l’entremise de la participation à un programme d’alternance travail-études pendant leurs études secondaires ;
- en 2007, la Colombie-Britannique a lancé une stratégie visant les apprentis autochtones dans le but d’améliorer la participation des Autochtones aux métiers. La province est consciente des pénuries actuelles et prévues en travailleurs qualifiés, de même que de la croissance rapide de la population de jeunes Autochtones en Colombie-Britannique ;
- le Manitoba a dévoilé un ensemble de nouvelles politiques liées aux projets d’investissement financés par l’État en juin 2011. L’objectif de ces politiques est d’améliorer la sécurité en milieu de travail lors de projets d’investissement et d’augmenter l’emploi dans les métiers spécialisés pour les Manitobains ;
- la Nouvelle-Écosse travaille en partenariat avec d’autres agences afin de mettre en œuvre le programme Techsploration. Son objectif est d’améliorer la participation des femmes dans les métiers spécialisés et les professions liées à la technologie et aux sciences en aidant les élèves de la 9e année et les anciennes élèves de la 10e à la 12e année à explorer divers choix de carrière.
À l’exception de la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, la majorité des initiatives stratégiques ont été axées sur l’augmentation des inscriptions à l’apprentissage plutôt que sur leur réussite. Bien qu’il soit difficile de dire si ces initiatives en sont la cause, on a observé une forte hausse des inscriptions aux programmes d’apprentissage au cours de la dernière décennie. Le nombre d’apprentis qui terminent leur formation a aussi augmenté, en tenant compte du décalage entre la date l’inscription et celle de la réussite.
Malgré un intérêt croissant envers les métiers et l’apprentissage, peu de recherches ont été effectuées sur la contribution des formations d’apprentissage et des certificats d’écoles de métiers sur le marché du travail canadien. Ce chapitre fournit des données de base sur la portée des métiers et de l’apprentissage sur le marché du travail dans son ensemble. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une analyse complète de l’équilibre entre l’offre et la demande, on fournit aussi certains renseignements sur les projections associées à la demande dans les métiers ainsi que sur les implications de la récente augmentation du nombre d’inscriptions à des programmes d’apprentissage et du nombre d’apprentis qui terminent leur programme.
6.1.3 Questions de recherche
Cette partie de l’étude était guidée par les questions de recherche suivantes :
- Comment l’apprentissage et les certificats professionnels contribuent-ils au marché du travail canadien en général?
- Quelle proportion du marché du travail canadien les métiers représentent-ils?
- Comment les taux de participation au marché du travail, d’emploi et de chômage dans les métiers se comparent-ils à ceux des autres professions et des personnes qui ont un niveau d’instruction différent?
- Quel rôle jouent les métiers et l’apprentissage par rapport à la demande sur le marché du travail canadien?
- Quel est le taux d’emploi chez les personnes ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers dans les divers métiers?
- Comment la répartition de l’emploi change-t-elle au fil du temps chez les personnes ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers? Comment cette répartition change-t-elle durant les ralentissements économiques?
- Comment la répartition de l’emploi varie-t-elle chez les Canadiens ayant un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers, par province, groupe d’âge, sexe, statut d’immigrant et identité autochtone?
- Quel est le rôle des métiers et de l’apprentissage dans l’approvisionnement en travailleurs spécialisés au Canada?
- Comment le nombre d’inscriptions aux métiers et à l’apprentissage varie-t-il selon les métiers spécialisés, les provinces/territoires, les groupes démographiques?
- Comment l’offre en nouveaux inscrits aux programmes d’apprentissage et en finissants se compare-t-elle à la demande dans les métiers sur le marché du travail?
6.1.4 Sources de données et méthodologie
La majorité des sources de données dans cette partie correspondaient à la description fournie dans l’introduction de ce rapport. Dans ce cas précis, on a accordé une plus grande importance aux résultats de l’Enquête sur la population active (EPA), puisqu’elle fournit le portrait le plus complet du marché du travail et des changements qu’il subit au fil du temps. Parmi les autres sources utilisées, on compte des statistiques sur l’enseignement postsecondaire et des projections sur l’offre et la demande fournies par le Système de projections des professions au Canada.
La principale méthode utilisée a été le croisement de divers aspects des formations d’apprentissage et dans les métiers avec d’autres professions et avec plusieurs résultats importants obtenus sur le marché du travail, incluant la participation au marché du travail, l’emploi, le chômage et le revenu. Lorsqu’il était possible de le faire, on a présenté des données chronologiques. Plus particulièrement, il était possible de fournir les résultats couvrant une période de 22 ans (soit de 1990 à 2011) pour la majorité des questions d’intérêt grâce à des données de l’EPA. Finalement, on présente certains résultats sur l’offre et la demande de travailleurs, fondés sur des tableaux du Système de projections des professions au Canada.
6.2 Aperçu de la main-d’œuvre dans les métiers, des participants à la formation d’apprenti et des détenteurs de certificat professionnel
6.2.1 Définition des métiers
Il n’existe pas de définition « normalisée » de ce que constitue un « métier ». Différentes définitions peuvent fournir des données différentes quant à la main-d’œuvre dans les métiers et la proportion de la population active totale qui travaille dans les métiers. En voici les différentes manières de définir les métiers :
- Toutes les professions incluses dans le grand groupe H de la CNP-SNote de bas de page 47 de Statistique Canada : emplois dans les métiers, le transport, la machinerie et les occupations connexes (93 professions dans le code de quatre chiffres de la CNP) Cette classification est souvent utilisée afin de produire des rapports sur les métiers parce qu’il s’agit d’un groupe de Statistique Canada et que les chiffres sont facilement accessibles. Cette classification n’est cependant pas particulièrement utile pour procéder à des études sur l’apprentissage parce qu’elle inclut plusieurs professions qui ne sont pas des métiers d’apprentissage (p. ex., aide de corps de métier) et exclut plusieurs importants métiers d’apprentissage (p. ex., cuisiniers, coiffeurs).
- Principaux métiers d’apprentissage (56 professions dans le code de quatre chiffres de la CNP) Supposément, les métiers d’apprentissage incluraient toutes les professions qui se trouvent dans le SIAI (environ 200 métiers dans le code de quatre chiffres de la CNP). Par contre, beaucoup de ces professions sont des métiers d’apprentissage dans seulement une ou deux provinces. De plus, certains métiers importants dans ce groupe comptent seulement un petit nombre d’apprentis, puisque l’apprentissage ne représente pas un cheminement commun vers ces professions. En effet, plus de la moitié des professions dans le SIAI comptent un très petit nombre d’apprentis (dix ou moins), ce qui amène à se demander si ces apprentis devraient être pris en considération, surtout par rapport au total de la population active dans ces métiers. C’est pourquoi on a choisi une liste de 56 métiers qui pourraient être considérés comme des « métiers principaux ». Ces métiers sont utilisés pour la majorité des objectifs de cette étude.
- Une liste de 100 professions créée par RHDCC et utilisée pour calculer la proportion du nombre total des membres de la population active qui pratiquent un métier selon le Recensement de 2006. Ce groupe chevauche beaucoup le groupe H de la CNP-S.
- Un sous-ensemble de 33 professions parmi les précédentes, nommées « métiers traditionnels ». Il s’agit aussi d’un sous-ensemble des 56 principaux métiers d’apprentissage définis plus tôt. Cependant, la main-d’œuvre totale dans ces métiers est semblable, parce que la liste des 56 métiers inclut plusieurs métiers relativement peu populaires.
Le graphique 6.1 montre les tendances du pourcentage de la population active totale qui travaille dans les métiers, en fonction de ces définitions, selon l’EPA. On remarque que le groupe des 100 métiers compilés par RHDCC est demeuré presque stable à environ 17 % au cours de cette période. Le groupe H de la CNP-S a affiché une légère baisse au cours des années 1990, mais il est demeuré presque constant à environ 15 % depuis cette époque. Les effets de la récession récente ont entraîné une faible baisse entre 2009 et 2010, et on a ensuite observé une légère remontée en 2011. Les principaux métiers d’apprentissage ont suivi une même tendance, mais avec une proportion beaucoup plus faible (un peu plus de 10 %) au cours de la dernière décennie. La différence entre les principaux métiers d’apprentissage et les métiers traditionnels de RHDCC est petite, ce qui renforce le fait que les 20 derniers métiers du groupe principal ne comptent que pour un faible pourcentage du marché du travail.
Graphique 6.1 Graphique 6.1 Pourcentage de la main-d’œuvre totale faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011 (Source : EPA)
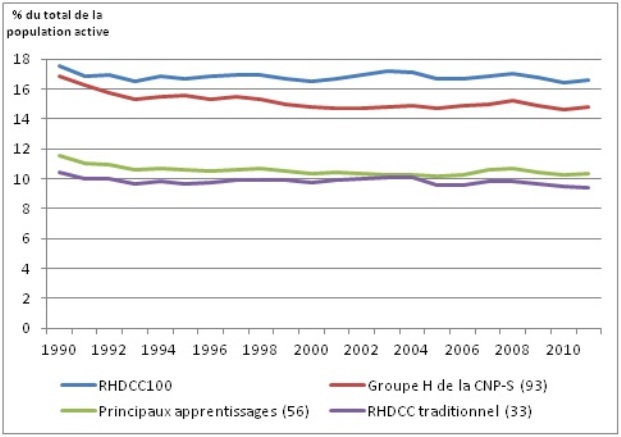
Description de l’image Graphique 6.1 Graphique 6.1 Pourcentage de la main-d’œuvre totale faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011 (Source : EPA)
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la main-d’œuvre totale des métiers faisant partie des quatre définitions des métiers, de 1990 à 2011. Les définitions des métiers incluent : RHDCC100; groupe H de la CNP-S (93); principaux apprentissages (56), et RHDCC traditionnel (33).
Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition de RHDCC100 était de 17,6 % en 1990 et avait diminué à 16,9 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie de RHDCC100 était de 16,5 % en 2001; 16,7 % en 2002; 17,0 % en 2003; 17,2 % en 2004; 17,1 % en 2005; 16,7 % en 2006; 16,7 % en 2007; 16,9 % en 2008; 17,1 % en 2009; 16,8 % en 2010, et 16,4 % en 2011.
Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition du groupe H de la CNP-S (93) était de 16,9 % en 1990 et avait diminué à 14,8 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie du groupe H de la CNP-S (93) était de 14,7 % en 2001; 14,7 % en 2002; 14,8 % en 2003; 14,9 % en 2004; 14,7 % en 2005; 14,9 % en 2006; 14,9 % en 2007; 15,2 % en 2008; 14,9 % en 2009; 14,6 % en 2010, et 14,8 % en 2011.
Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition des principaux apprentissages (56) était de 11,5 % en 1990 et avait diminué à 10,3 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie du groupe des principaux apprentissages (56) était de 10,4 % en 2001; 10,3 % en 2002; 10,2 % en 2003; 10,2 % en 2004; 10,2 % en 2005; 10,3 % en 2006; 10,6 % en 2007; 10,7 % en 2008; 10,4 % en 2009; 10,2 % en 2010, et 10,3 % en 2011.
Le pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers inclus dans la définition de RHDCC traditionnel (33) était de 10,4 % en 1990 et avait diminué à 9,8 % en 2000. Le pourcentage de la main-d’œuvre faisant partie de RHDCC traditionnel (33) était de 9,9 % en 2001; 10,0 % en 2002; 10,1 % en 2003; 10,1 % en 2004; 9,6 % en 2005; 9,5 % en 2006; 9,8 % en 2007; 9,8 % en 2008; 9,6 % en 2009; 9,5 % en 2010, et 9,4 % en 2011.
Le graphique 6.2 place ces renseignements dans le contexte de la population active totale. De cette perspective, la croissance globale dans les principaux métiers d’apprentissage n’a pas été très différente de celle observée dans les autres métiers, mais elle a affiché des fluctuations un peu plus importantes au fil des années. Plus particulièrement, les métiers ont affiché une croissance plus forte que les autres professions au milieu des années 2000, suivie d’une baisse de la croissance au cours de la récession de 2009, puis d’un regain. Les chiffres associés aux dix métiers les plus populaires se sont stabilisés au cours des dernières années.
Graphique 6.2 Main-d’œuvre totale et main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011[Source : EPA]
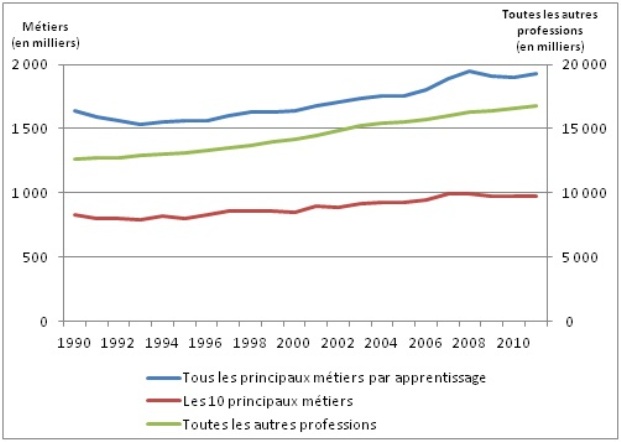
Description de l’image Graphique 6.2 Main-d’œuvre totale et main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011[Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la main-d’œuvre totale et la main-d’œuvre dans les principaux métiers, de 1990 à 2011. La main-d’œuvre est divisée en trois catégories, soit tous les principaux métiers par apprentissage, les dix principaux métiers et toutes les autres professions.
La main-d’œuvre totale pour tous les principaux métiers par apprentissage était de 1 640 100 en 1990 et avait diminué à 1 635 900 en 2000. La main-d’œuvre totale pour tous les principaux métiers par apprentissage était de 1 677 500 en 2001; 1 710 700 en 2002; 1 734 300 en 2003; 1 753 600 en 2004; 1 758 500 en 2005; 1 803 700 en 2006; 1 888 000 en 2007; 1 947 000 en 2008; 1 912 800 en 2009; 1 896 300 en 2010, et 1 931 000 en 2011.
La main-d’œuvre totale pour les dix principaux métiers était de 833 400 en 1990 et avait augmenté à 850 800 en 2000. La main-d’œuvre totale pour les dix principaux métiers était de 895 200 en 2001; 887 000 en 2002; 914 900 en 2003; 926 300 en 2004; 928 800 en 2005; 941 000 en 2006; 993 900 en 2007; 994 800 en 2008; 975 500 en 2009; 970 000 en 2010, et 973 600 en 2011.
La main-d’œuvre totale pour toutes les professions était de 12 604 500 en 1990 et avait augmenté à 14 206 000 en 2000. La main-d’œuvre totale pour toutes les professions était de 14 427 400 en 2001; 14 858 400 en 2002; 15 213 700 en 2003; 15 400 700 en 2004; 15 535 000 en 2005; 15 713 000 en 2006; 15 996 200 en 2007; 16 256 900 en 2008; 16 416 200 en 2009; 16 628 800 en 2010, et 16 768 400 en 2011.
6.2.2 Participation au marché du travail selon la formation scolaire
Le graphique 6.3Note de bas de page 48 indique qu’en 2006, les taux de participation au marché du travail et d’emploi chez les Canadiens qui avaient un certificat d’apprenti ou d’une école de métier étaient supérieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais inférieurs à ceux enregistrés chez les travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire. Le phénomène inverse est observé par rapport au taux de chômage. En effet, le taux de chômage des travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier était inférieur à celui des travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais supérieur à celui des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Le graphique 6.4 montre que le taux général de chômage était à la baisse de 1990 à 2010. Les taux de chômage chez les travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier étaient beaucoup plus faibles que ceux enregistrés chez les travailleurs qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, environ les mêmes que chez les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires, et supérieurs à ceux des travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire. Les effets de la récente récession étaient visibles dans tous les groupes en 2009. Le groupe qui a été le plus touché par la récession est celui des travailleurs qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, suivi des travailleurs qui avaient un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier et les travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires, et finalement les travailleurs qui avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Graphique 6.3 Activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006 [Source : Recensement de 2006]
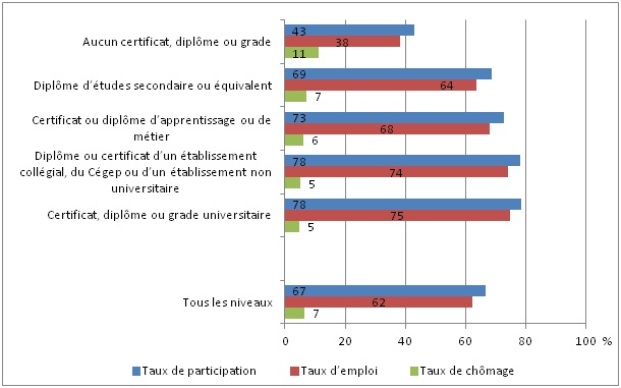
Description de l’image Graphique 6.3 Activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006 [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage des activités sur le marché du travail selon le niveau d’éducation en 2006. Trois indicateurs, soit le taux de participation, le taux d’emploi et le taux de chômage, sont présentés pour chaque niveau d’éducation.
Le groupe de main-d’œuvre sans aucun certificat, diplôme ou grade avait un taux de participation de 42,9 %, un taux d’emploi de 38,1 %, et un taux de chômage de 11,1 %.
Le groupe de main-d’œuvre ayant un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent avait un taux de participation de 68,8 %, un taux d’emploi de 63,8 %, et un taux de chômage de 7,3 %.
Le groupe de main-d’œuvre ayant un certificat ou un diplôme d’apprentissage ou de métier avait un taux de participation de 72,6 %, un taux d’emploi de 68,1 %, et un taux de chômage de 6,2 %.
Le groupe de main-d’œuvre ayant un diplôme ou un certificat d’un établissement collégial, du Cégep ou d’un établissement non universitaire avait un taux de participation de 78,1 %, un taux d’emploi de 74,2 %, et un taux de chômage de 5 %.
Le groupe de main-d’œuvre ayant un certificat, un diplôme ou un grade universitaire avait un taux de participation de 78,4 %, un taux d’emploi de 74.7 %, et un taux de chômage de 4.6 %.
L’ensemble des données de tous les niveaux d’éducation indique un taux de participation de 66,8 %, un taux d’emploi de 62,4 %, et un taux de chômage de 6,6 %.
Graphique 6.4 Tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
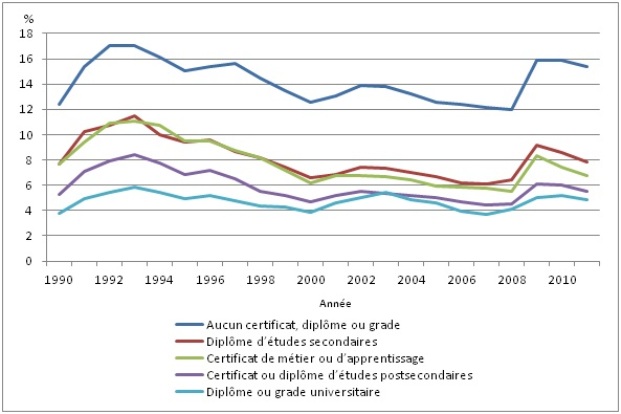
Description de l’image Graphique 6.4 Tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les tendances du taux de chômage selon le niveau d’éducation, de 1990 à 2011. Les niveaux d’éducation inclus sont : aucun certificat, diplôme ou grade; diplôme d’études secondaires; certificat de métier ou d’apprentissage; certificat ou diplôme d’études postsecondaires, et diplôme ou grade universitaire.
Le taux de chômage pour ceux n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade était de 12,4 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans pour ensuite diminuer à 12,6 % en 2000. Le taux de chômage était de 13,1 % en 2001; 13,9 % en 2002; 13,8 % en 2003; 13,2 % en 2004; 12,6 % en 2005; 12,4 % en 2006; 12,1 % en 2007; 12,0 % en 2008; 15,9 % en 2009; 15,9 % en 2010, et 15,4 % en 2011.
Le taux de chômage pour ceux ayant un diplôme d’études secondaires était de 7,7 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de diminuer à 6,6 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,9 % en 2001; 7,4 % en 2002; 7,3 % en 2003; 7,0 % en 2004; 6,7 % en 2005; 6,2 % en 2006; 6,1 % en 2007; 6,4 % en 2008; 9,1 % en 2009; 8,6 % en 2010, et 7,9 % en 2011.
Le taux de chômage pour ceux ayant un certificat de métier ou d’apprentissage était de 7,7 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans pour ensuite diminuer à 6,2 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,8 % en 2001; 6,8 % en 2002; 6,7 % 2003; 6,4 % en 2004; 5,9 % en 2005; 5,9 % en 2006; 5,7 % en 2007; 5,5 % en 2008; 8,3 % en 2009; 7,4 % en 2000, et 6,8 % en 2010.
Le taux de chômage pour ceux ayant un certificat ou diplôme d’études postsecondaires était de 5,3 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de diminuer à 4,7 % en 2000. Le taux de chômage était de 5,2 % en 2001; 5,5 % en 2002; 5,3 % en 2003; 5,2 % en 2004; 5,0 % en 2005; 4,7 % en 2006; 4,4 % en 2007; 4,5 % en 2008; 6,1 % en 2009; 6,0 % en 2010, et 5,5 % en 2011.
Le taux de chômage pour ceux ayant un diplôme ou grade universitaire était de 3,8 % en 1990, puis a augmenté pendant deux ans avant de redescendre à 3,8 % en 2000. Le taux de chômage était de 4,6 % en 2001; 5,0 % en 2002; 5,4 % en 2003; 4,9 % en 2004; 4,6 % en 2005; 4,0 % en 2006; 3,7 % en 2007; 4,1 % en 2008; 5,0 % en 2009; 5,2 % en 2010, et 4,9 % en 2011.
La tendance associée aux détenteurs de certificats d’apprentissage et professionnels est reproduite à une plus grande échelle dans le graphique 6.5 afin d’illustrer plus clairement les fluctuations dans ce groupe au fil du temps. Les effets des deux périodes de récession, au début des années 1990 et en 2009, se démarquent dans ce graphique. À part ces sommets, on remarque plus clairement une tendance à la baisse du taux de chômage chez les travailleurs qui ont ces niveaux d’instruction. Ce résultat est cohérent avec la situation décrite par Desjardins (2011).
Graphique 6.5 Pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
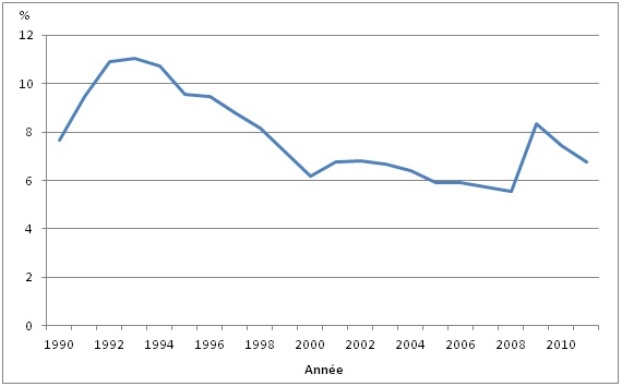
Description de l’image Graphique 6.5 Pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de chômeurs chez les titulaires de certificats professionnels ou d’apprentissage, de 1990 à 2011. Le taux de chômage était de 7,7 % en 1990, avait augmenté à 10,7 % en 1994, puis avait diminué de manière constante pour atteindre 6,2 % en 2000. Le taux de chômage était de 6,8 % en 2001; 6,8 % en 2002; 6,7 % en 2003; 6,4 % en 2004; 5,9 % en 2005; 5,9 % en 2006; 5,7 % en 2007; 5,5 % en 2008; 8,3 % en 2009; 7,4 % en 2000, et 6,8 % en 2010.
6.3 La demande
6.3.1 La reconnaissance professionnelle dans l’ensemble de la population active
Le graphique 6.6 indique le pourcentage du nombre total de travailleurs qui possèdent un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier pour tous les métiers, et pour les dix métiers les plus populaires.Note de bas de page 49 Il montre une tendance relativement stable au cours de la dernière décennie, suivie d’un faible déclin dans les années 1990. Dans les dix métiers les plus populaires, on a observé une légère baisse au cours de la période complète.
Graphique 6.6 Certificats de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
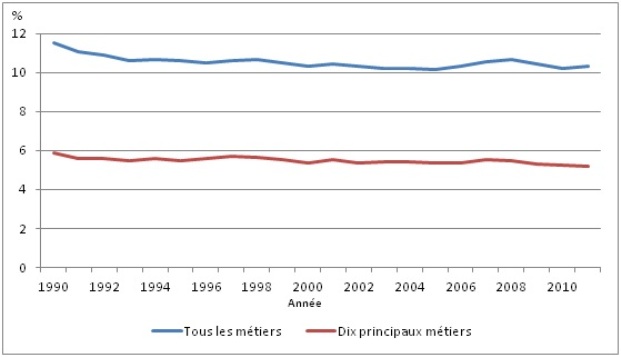
Description de l’image Graphique 6.6 Certificats de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les travailleurs possédant un certificat de métier comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, de 1990 à 2011. Le graphique contient une ligne représentant tous les métiers et une autre représentant les dix principaux métiers comme un pourcentage de la population active totale.
Pour tous les métiers, les travailleurs ayant un certificat de métier représentaient 11,51 % de la population active totale en 1990 et leur pourcentage avait diminué à 10,33 % en 2000. Le pourcentage était de 10,42 % en 2001; 10,32 % en 2002; 10,23 % en 2003; 10,22 % en 2004; 10,17 % en 2005; 10,30 % en 2006; 10,56 % en 2007; 10,70 % en 2008; 10,44 % en 2009; 10,24 % en 2010, et 10,33 % en 2011.
Le pourcentage de travailleurs des dix principaux métiers dans la population active était de 5,85 % en 1990 et avait diminué à 5,37 % en 2000. Le pourcentage était de 5,56 % en 2001; 5,35 % en 2002; 5,40 % en 2003; 5,40 % en 2004; 5,37 % en 2005; 5,37 % en 2006; 5,56 % en 2007; 5,46 % en 2008; 5,32 % en 2009; 5,24 % en 2010, et 5,21 % en 2011.
6.3.2 La correspondance des certificats aux professions
Les résultats présentés ci-dessus montrent que les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou d’une école de métier représentent un peu plus de 10 % de la population active. Par contre, ces résultats ne permettent pas de savoir quelle proportion des membres de ce groupe travaille dans les métiers, et quelle proportion des travailleurs qui pratiquent ces professions détient d’autres types de diplômes ou ont atteint d’autres niveaux d’instruction. Il est donc utile d’examiner de façon plus générale la correspondance entre les titres de compétences et les professions.
Le graphique 6.7 indique la tendance temporelle par rapport à la correspondance dans les deux directions. La ligne bleue dans ce graphique montre qu’en moyenne, environ 30 % des détenteurs de certificats professionnels travaillent réellement dans des métiers. Ces données suggèrent qu’il y a un grand bassin d’ouvriers certifiés qui travaillent dans d’autres secteurs que leur métier. La correspondance s’est quelque peu améliorée au cours des dernières années, ce qui pourrait être lié aux meilleures perspectives d’emploi dans les métiers dont on a fait mention plus tôt.
Il est intéressant de remarquer que le pourcentage des personnes qui travaillent dans les métiers et qui détiennent vraiment un certificat professionnel est seulement un peu plus élevé que le cadre de la correspondance inverse, bien que ces deux données ne soient pas directement liées. En effet, on observe un important décalage dans les deux directions. Ces deux données indiquent que l’offre en ouvriers certifiés serait presque égale à la main-d’œuvre dans les métiers si tous les travailleurs qui ont un certificat professionnel dans un métier travaillaient réellement dans un métier.
Il est important de souligner que ces données sont quelque peu sous-estimées, puisque l’EPA ne nous permet pas d’identifier les travailleurs qui détiennent un certificat professionnel, mais qui détiennent aussi ce que Statistique Canada définit comme un diplôme « d’études supérieures ». Cela est dû au fait que l’EPA n’enregistre que le plus haut niveau d’instruction, qui subsume tous les autres. En réalité, parmi les personnes qui travaillent dans les métiers, une majorité a un niveau d’instruction « inférieur » au certificat d’apprentissage ou au certificat d’une école de métier (graphique 4.2, page 149). En tenant pour acquis que l’objectif est d’améliorer le nombre de travailleurs qui ont des titres de compétence qui correspondent à leur profession, c’est ce groupe qui présente le plus grand intérêt par rapport à la formation.
Graphique 6.7 Correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
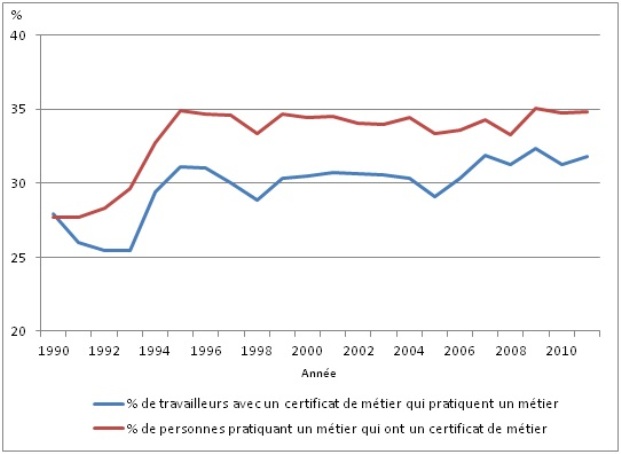
Description de l’image Graphique 6.7 Correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la correspondance des certificats d’apprentissage et d’écoles de métier aux professions et des professions aux certificats, de 1990 à 2011. Une ligne représente le pourcentage de travailleurs ayant un certificat de métier qui pratiquent un métier et une autre représente le pourcentage de personnes pratiquant un métier qui ont un certificat de métier.
Le pourcentage de travailleurs ayant un certificat de métier qui pratiquent un métier était de 27,9 % en 1990 et avait augmenté à 30,5 % en 2000. Le pourcentage était de 30,7 % en 2001; 30,7 % en 2002; 30,6 % en 2003; 30,3 % en 2004; 29,1 % en 2005; 30,3 % en 2006; 31,9 % en 2007; 31,3 % en 2008; 32,4 % en 2009; 31,2 % en 2010, et 31,8 % en 2011.
Le pourcentage de personnes pratiquant un métier qui ont un certificat de métier était de 27,7 % en 1990 et avait augmenté à 34,5 % en 2000. Le pourcentage était de 34,5 % en 2001; 34,1 % en 2002; 33,9 % en 2003; 34,4 % en 2004; 33,4 % en 2005; 33,6 % en 2006; 34,3 % en 2007; 33,3 % en 2008; 35,0 % en 2009; 34,7 % en 2010, et 34,9 % en 2011.
La classification du niveau d’éducation présentée dans le Recensement de 2006 permet de réaliser une distribution plus explicite des travailleurs qui détiennent un certificat d’apprenti inscrit et de ceux qui ont un autre type de certificat professionnel.
Ce deuxième groupe incluait probablement des travailleurs qualifiés, mais aussi les travailleurs qui ont suivi une formation en établissement, ou qui ont un autre type de certificat qui ne mène pas au statut de compagnon. Le graphique 6.8 illustre cette distribution grâce à de véritables données sur la main-d’œuvre plutôt que des pourcentages afin de fournir une idée plus précise de l’importance de ces groupes.
Parmi les travailleurs qui ont un certificat d’apprenti inscrit, on compte un peu moins qui travaillent dans des professions considérées comme des métiers que de gens qui travaillent dans les professions. La différence est cependant beaucoup plus importante chez les travailleurs qui détiennent un autre type de certificat professionnel. Cette différence est probablement attribuable en partie au fait que plusieurs professions qui pourraient être considérées comme des métiers aux fins de formation et de reconnaissance ne sont en réalité pas des métiers d’apprentissage. On trouve des exemples dans les grands groupes de la CNP-S I et J, qui représentent les travailleurs du secteur primaire et de celui de la fabrication, respectivement.
Graphique 6.8 Total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession [Source : Recensement de 2006]
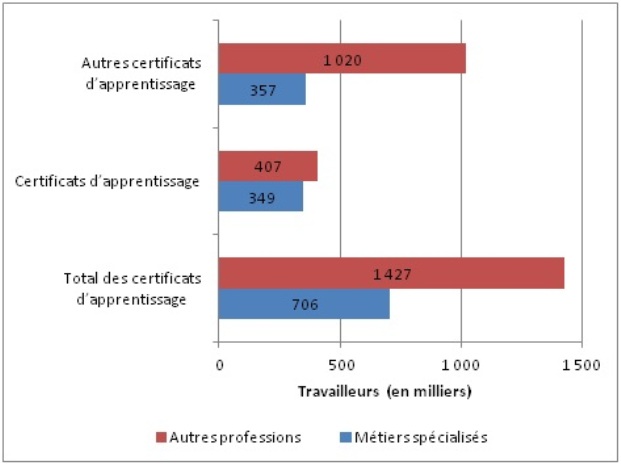
Description de l’image Graphique 6.8 Total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le total des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou professionnel travaillant dans un métier spécialisé ou une profession, selon le recensement de 2006. Les catégories incluent les autres certificats d’apprentissage, les certificats d’apprentissage et le total des certificats d’apprentissage.
Parmi les travailleurs ayant « un autre certificat d’apprentissage », 1 020 000 travaillaient dans d’autres professions et 357 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.
Parmi les travailleurs ayant un certificat d’apprentissage, 407 000 travaillaient dans d’autres professions et 349 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.
Parmi les travailleurs ayant soit un certificat d’apprentissage, soit « un autre certificat d’apprentissage », 1 427 000 travaillaient dans d’autres professions et 706 000 travaillaient dans des métiers spécialisés.
6.3.3 Certificats d’apprentissage et d’écoles de métiers dans les 10 principaux métiers
Le graphique 6.9 montre les niveaux d’instruction des travailleurs dans les dix principaux métiers, selon les données du Recensement de 2006. C’est dans le métier de coiffeurs/barbiers que l’on trouve la plus forte proportion d’apprentis ou de détenteurs de certificats professionnels, et le plus faible pourcentage de travailleurs qui ont, au mieux, un diplôme d’études secondaires. Les cuisiniers se trouvent à l’extrême opposé. C’est dans ce groupe que l’on compte le plus faible pourcentage de travailleurs qui ont un certificat professionnel ou d’apprenti et le plus grand pourcentage qui ont, au mieux, un diplôme d’études secondaires. Les pourcentages à chaque niveau sont semblables dans la majorité des métiers liés à la mécanique ou à la construction, à l’exception des charpentiers, chez qui le niveau d’instruction est généralement plus bas.
Graphique 6.9 Niveaux d’instruction dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, en 2006 [Source : Recensement de 2006]
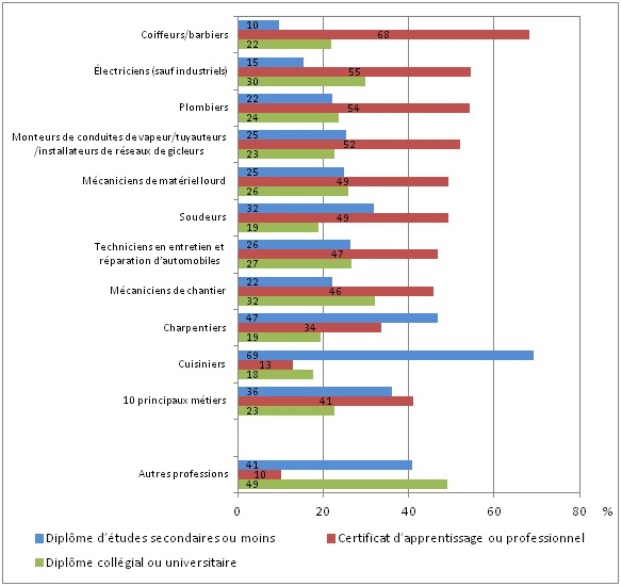
Description de l’image Graphique 6.9 Niveaux d’instruction dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, en 2006 [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction des travailleurs dans les dix principaux métiers du Sceau rouge, selon le recensement de 2006. Les niveaux d’instruction sont : diplôme d’études secondaires ou moins; certificat d’apprentissage ou professionnel, et diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des coiffeurs et les barbiers, 10 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 68 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 22 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des électriciens (sauf industriels), 15 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 55 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 30 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des plombiers, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 54 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 24 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des monteurs de conduites de vapeur, les tuyauteurs et les installateurs de réseaux de gicleurs, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 52 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 23 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des mécaniciens de matériel lourd, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 49 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 26 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des techniciens en entretien et réparation d’automobiles, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 47 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 27 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des mécaniciens de chantier, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 46 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 32 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des charpentiers, 47 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 34 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 19 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des cuisiniers, 69 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 13 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 18 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des travailleurs dans les 10 principaux métiers, 36 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 41 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 23 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Pour ce qui est des travailleurs des autres professions, 41 % avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, 10 % avaient un certificat d’apprentissage et professionnel et 49 % avaient un diplôme collégial ou universitaire.
Le graphique 4.1 (page 147) indique que la proportion de travailleurs qui détient un certificat professionnel ou d’apprentissage a été assez constante depuis le milieu des années 1990. Le graphique 6.10 montre la même tendance dans l’ensemble des dix métiers les plus populaires, à l’exception des cuisiniers, puisque ce métier représente de toute évidence une exception parmi les dix principaux métiers. La tendance générale est semblable dans les deux cas, incluant l’importante hausse du nombre de reconnaissances professionnelles accordé au début des années 1990. Depuis cette époque, ces proportions n’ont pas beaucoup changé, ce qui indique que la proportion de travailleurs certifiés qui quittent les métiers est très semblable à celle des travailleurs certifiés qui commencent un métier. Même au cours des dernières années, où le nombre de finissants a augmenté, le nombre de travailleurs a été insuffisant pour augmenter la proportion de personnes de métier qui obtiennent un certificat.
Graphique 6.10 Pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers dans les dix principaux métiers, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
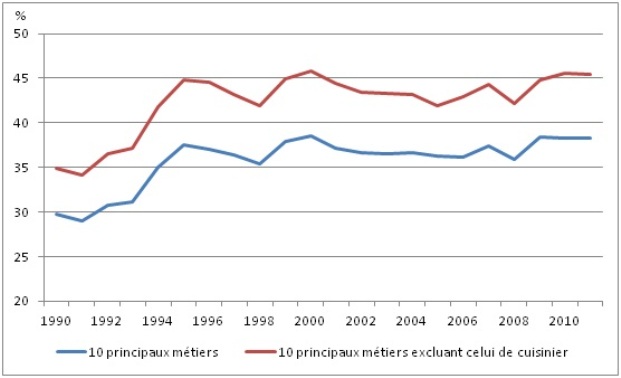
Description de l’image Graphique 6.10 Pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers dans les dix principaux métiers, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans les dix principaux métiers et dans les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, de 1990 à 2011. Il y a une ligne représentant les dix principaux métiers et une autre représentant les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier.
Pour les dix principaux métiers, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 29,7 % en 1990 et avait augmenté à 38,6 % en 2000. Le pourcentage était de 37,1 % en 2001; 36,6 % en 2002; 36,5 % en 2003; 36,7 % en 2004; 36,3 % en 2005; 36,1 % en 2006; 37,4 % en 2007; 35,9 % en 2008; 38,4 % en 2009; 38,3 % en 2010, et 38,3 % en 2011.
Pour les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage était de 34,9 % en 1990 et avait augmenté à 45,9 % en 2000. Le pourcentage était de 44,4 % en 2001; 43,5 % en 2002; 43,3 % en 2003; 43,1 % en 2004; 41,9 % en 2005; 43,0 % en 2006; 44,3 % en 2007; 42,2 % en 2008; 44,8 % en 2009; 45,6 % en 2010, et 45,5 % en 2011.
Le changement principal qui s’est produit au cours de la période d’examen est lié aux pourcentages de travailleurs qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires (graphique 4.1, page 147). Une distribution est présentée dans le tableau 6.11 pour les dix principaux métiers et le reste des métiers. On a aussi inclus une représentation graphique pour les dix principaux métiers, à l’exception de celui de cuisinier, puisque c’est dans ce métier que l’on compte la plus grande proportion de travailleurs sans diplôme d'études secondaires. Dans tous les cas, on a observé un déclin constant du pourcentage de travailleurs qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires. En réalité, le pourcentage de travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires était plus élevé dans les dix principaux métiers que dans le reste des métiers. Cependant, quand on exclut les cuisiniers, les pourcentages dans les neuf principaux métiers restants sont comparables à ceux de l'ensemble des autres métiers.
Graphique 6.11 Pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
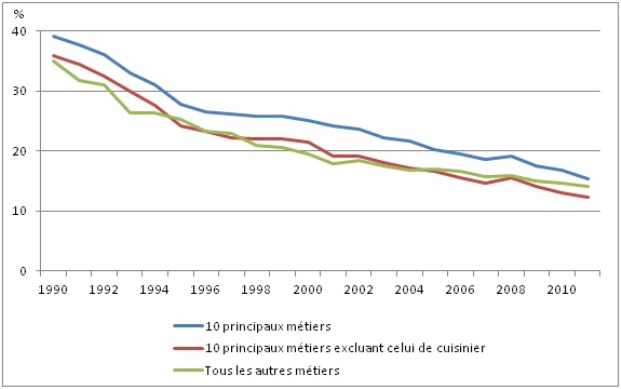
Description de l’image Graphique 6.11 Pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires pour les dix principaux métiers, les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, et tous les autres métiers, de 1990 à 2011. Une ligne représente les dix principaux métiers, une autre les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier et une dernière tous les autres métiers.
Pour les dix principaux métiers, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 39,1 % en 1990 et avait diminué à 25,0 % en 2000. Le pourcentage était de 24,1 % en 2001; 23,7 % en 2002; 22,2 % en 2003; 21,6 % en 2004; 20,2 % en 2005; 19,5 % en 2006; 18,6 % en 2007; 19,0 % en 2008; 17,5 % en 2009; 16,8 % en 2010, et 15,4 % en 2011.
Pour les dix principaux métiers excluant celui de cuisinier, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 35,9 % en 1990 et avait diminué à 21,5 % en 2000. Le pourcentage était de 19,1 % en 2001; 19,2 % en 2002; 18,0 % en 2003; 17,2 % en 2004; 16,5 % en 2005; 15,5 % en 2006; 14,7 % en 2007; 15,5 % en 2008; 14,0 % en 2009; 13,0 % en 2010, et 12,3 % en 2011.
Pour tous les autres métiers, le pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés n’ayant pas de diplôme d’études secondaires était de 35,0 % en 1990 et avait diminué à 19,5 % en 2000. Le pourcentage était de 17,9 % en 2001; 18,5 % en 2002; 17,5 % en 2003; 16,8 % en 2004; 17,0 % en 2005; 16,6 % en 2006; 15,8 % en 2007; 16,0 % en 2008; 15,0 % en 2009; 14,6 % en 2010, et 14,1 % en 2011.
Les chiffres présentés dans le graphique 6.11 reflètent en réalité les tendances en éducation, selon lesquelles le taux de réussite des études secondaires a augmenté rapidement, au point où très peu d’élèves n’obtiennent désormais pas leur diplôme d’études secondaires. À mesure que les personnes de métier âgées quittent le marché du travail, la proportion de travailleurs qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires devrait continuer à baisser. Ce phénomène ne change pas beaucoup la situation chez les apprentis et les détenteurs de certificat professionnel. En effet, le résultat est qu’un plus grand nombre de diplômés du secondaire intègrent les métiers, mais le nombre de travailleurs qui commencent un métier pour lequel ils ont un certificat pertinent n’a pas changé.
6.3.4 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers par province
Le graphique 6.12 montre les tendances du pourcentage de la population active qui détient un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers en fonction de la province, pour l’année 2010. On remarque d’importantes variations, d’un sommet de 25 % à Terre-Neuve-et-Labrador à un plancher de 6,2 % en Ontario. On ne remarque aucune tendance régionale marquée.
Le graphique 6.13 affiche la tendance temporelle associée à ces pourcentages pour les provinces choisies où l’on a observé le plus important changement au cours de la période de 22 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé d’importantes fluctuations au cours des dernières années. On a noté une baisse au cours de la première partie de la décennie passée, suivie d’une augmentation au cours des dernières années, bien que moins importante que celle des années 1990. En Saskatchewan, on a observé une hausse dans les années 1990, suivie d’une stabilisation. Au Québec, la tendance est généralement à la hausse, alors que celle de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse est à la baisse. Dans les provinces dont les données ne sont pas affichées, on a observé des tendances assez stables, semblables à celles de l’ensemble du Canada.
Graphique 6.12 Pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011 [Source : EPA]
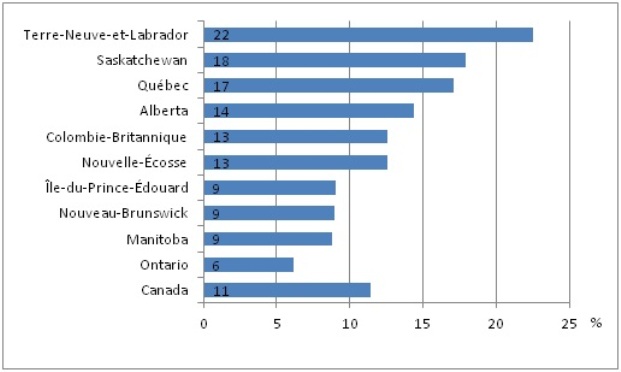
Description de l’image Graphique 6.12 Pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier selon la province, en 2011.
Le pourcentage de la population active titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 22,5 % à Terre-Neuve-et-Labrador; 17,9 % en Saskatchewan; 17,1 % au Québec; 14,4 % en Alberta; 12,6 % en Colombie-Britannique; 12,6 % en Nouvelle-Écosse; 9,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard; 8,9 % au Nouveau-Brunswick; 8,8 % au Manitoba; 6,2 % en Ontario, et 11,4 % au Canada.
Graphique 6.13 Tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces/territoires choisis, de 1990 à 2011[Source : EPA]
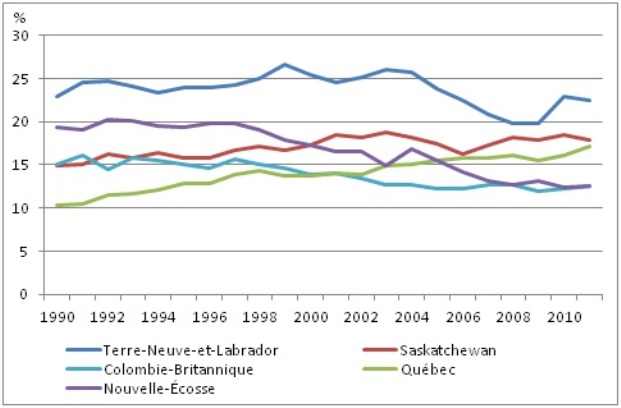
Description de l’image Graphique 6.13 Tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces/territoires choisis, de 1990 à 2011[Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les tendances du pourcentage des travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier dans des provinces choisies, de 1990 à 2011. Chaque province est représentée par sa propre ligne.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 23 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à 25,4 % de 1990 à 2000. Le pourcentage était de 24,5 % en 2001; 25,1 % en 2002; 26 % en 2003; 25,8 % en 2004; 23,8 % en 2005; 22,5 % en 2006; 20,8 % en 2007; 19,8 % en 2008; 19,8 % en 2009; 22,9 % en 2010, et 22,5 % en 2011.
En Saskatchewan, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 14,9 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à atteindre 25,4 % de 1990 à 2001. Le pourcentage était de 18,1 % en 2002; 18,8 % en 2003; 18,2 % en 2004; 17,4 % en 2005; 16,2 % en 2006; 17,3 % en 2007; 18,1 % en 2008; 17,8 % en 2009; 18,5 % en 2010, et 17,9 % en 2011.
En Colombie-Britannique, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 15,1 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à 14 % de 1990 à 2001. Le pourcentage était de 13,5 % en 2002; 12,7 % en 2003; 12,7 % en 2004; 12,3 % en 2005; 12,3 % en 2006; 12,7 % en 2007; 12,7 % en 2008; 11,9 % en 2009; 12,3 % en 2010, et 12,6 % en 2011.
En Nouvelle-Écosse, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 19,4 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à 16,5 % en 2001. Le pourcentage était de 16,6 % en 2002; 15,0 % en 2003; 16,8 % en 2004; 15,6 % en 2005; 14,1 % en 2006; 13,1 % en 2007; 12,7 % en 2008; 13,1 % en 2009; 12,5 % en 2010, et 12,6 % en 2011.
Au Québec, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier était de 14,9 % en 1990 et a augmenté légèrement jusqu’à atteindre 25,4 % en 2001. Le pourcentage était de 13,89 % en 2002; 15,0 % en 2003; 15,1 % en 2004; 15,5 % en 2005; 15,8 % en 2006; 15,9 % en 2007; 16,1 % en 2008; 15,6 % en 2009; 16,1 % en 2010, et 17,1 % en 2011.
6.3.5 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers par niveau de compétences
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a créé une matrice qui fournit un aperçu de la structure complète de la classification par profession selon le niveau et le type de compétences (http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/ english/noc/2011/pdf/Matrix.pdf). Le tableau 6.14 montre que plus de 50 % des détenteurs de certificat d’apprenti ou d’une école de métiers pratiquent un métier classé dans le niveau de compétence B (personnel technique ou auxiliaire). La majorité des autres membres de ce groupe se trouvent au niveau de compétences C (intermédiaire). Un nombre relativement faible de ces travailleurs occupe des postes de gestion ou des emplois de professionnels (A), ou encore des emplois de niveau de compétences inférieur (D). La tendance a été relativement stable au cours des dernières années, après un léger déclin dans le niveau de compétences B et une augmentation correspondante dans le niveau C dans les années 1990.
Graphique 6.14 Classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers [Source : EPA]
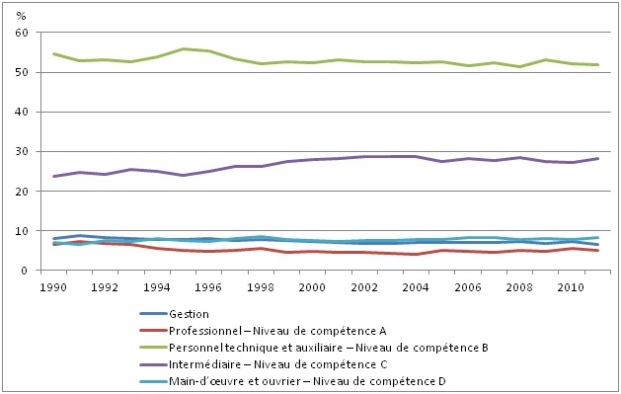
Description de l’image Graphique 6.14 Classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métiers [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la classification du niveau de compétence des personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier. Les niveaux de compétence sont : gestion; professionnel – niveau de compétence A; personnel technique et auxiliaire – niveau de compétence B; intermédiaire – niveau de compétence C, et main-d’œuvre et ouvrier – niveau de compétence D.
Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau gestion était de 8,1 % en 1990. Le pourcentage est resté relativement stable, diminuant pour atteindre 6,6 % en 2011.
Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau professionnel – niveau de compétence A était de 6,6 % en 1990 et a diminué légèrement jusqu’à atteindre 4,6 % en 2001. Le pourcentage est par la suite demeuré stable jusqu’en 2011 où il a atteint 5,1 %.
Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau personnel technique et auxiliaire – niveau de compétence B était de 54,6 % en 1990 et a diminué légèrement pour atteindre 52,4 % en 2000. Le pourcentage est ensuite demeuré stable jusqu’en 2011 où il était de 51,9 %.
Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau main-d’œuvre et ouvrier – niveau de compétence D était de 7 % en 1990. Il est resté stable et a connu une légère augmentation pour atteindre 8,2 % en 2011.
Le pourcentage de personnes titulaires d’un certificat d’apprentissage ou de métier appartenant au niveau intermédiaire – niveau de compétence C était de 23,7 % en 1990 et avait augmenté à 28,1 % en 2001. Le pourcentage était de 28,8 % en 2002; 28,7 % en 2003; 29,7 % en 2004; 27,5 % en 2005; 28,3 % en 2006; 27,6 % en 2007; 28,4 % en 2008; 27,5 % en 2009; 27,3 % en 2010, et 28,1 % en 2011.
6.3.6 Certificat d’apprenti ou d’une école de métiers selon les caractéristiques démographiquesNote de bas de page 50
Le graphique 6.15 montre que le pourcentage des membres de la population active qui ont un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers est distribué de façon assez égale entre les différents groupes d’âge, à l’exception de celui des 15 à 24 ans, dont les membres sont généralement trop jeunes pour avoir terminé une formation d’apprentissage. Les autres niveaux d’instruction affichent des variations un peu plus importantes. La proportion des personnes de 65 ans et plus est intéressante puisqu’elle est aussi élevée que celle de la majorité des autres groupes d’âge. Ce phénomène appuie l’argument formulé plus tôt selon lequel les proportions de remplaçants pour les travailleurs certifiés sont comparables à celles des personnes qui ont quitté les métiers, dans ce cas probablement principalement dû aux départs à la retraite. Les résultats dans le groupe des travailleurs âgés de 22 à 25 ans appuient aussi les résultats présentés plus tôt indiquant que la proportion des travailleurs qui ont un certificat d’apprenti ou d’une école de métiers ne change pas beaucoup, alors que celle des travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires est en baisse, et que la celle des travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire augmente.
Graphique 6.15 Niveaux d’instruction selon le groupe d’âge [Source : Recensement de 2006]
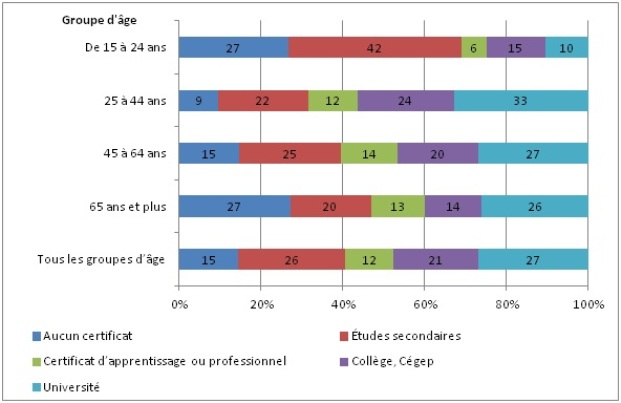
Description de l’image Graphique 6.15 Niveaux d’instruction selon le groupe d’âge [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction selon le groupe d’âge. Les groupes d’âge représentés sont : 15 à 24 ans; 25 à 44 ans; 45 à 64 ans; 65 ans et plus, et tous les âges. Les niveaux d’instruction sont : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; collège ou Cégep, et université.
Pour ce qui est des 15 à 24 ans, 27 % n’avaient aucun certificat, 42 % avaient un diplôme d’études secondaires, 6 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 15 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 10 % avaient un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des 25 à 44 ans, 9 % n’avaient aucun certificat, 22 % avaient un diplôme d’études secondaires, 12 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 24 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 33 % avaient un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des 45 à 64 ans, 15 % n’avaient aucun certificat, 25 % avaient un diplôme d’études secondaires, 14 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 20 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 27 % avaient un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des 65 ans et plus, 27 % n’avaient aucun certificat, 20 % avaient un diplôme d’études secondaires, 13 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 14 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 26 % avaient un diplôme universitaire.
Pour ce qui est de tous les âges, 15 % n’avaient aucun certificat, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires, 12 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 21 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 27 % avaient un diplôme universitaire.
Les résultats présentés plus tôt (p. ex., le graphique 4.1, page 147) montrent que les femmes représentent une très faible proportion des apprentis dans les métiers, à l’exception des métiers de coiffeur et de cuisinier. La proportion des femmes dans les métiers augmente lentement. Partant de très bas dans les dix principaux métiers, elle augmente à un taux quelque peu plus élevé que dans les autres métiers. Cette partie extrapole ces résultats en se penchant sur la proportion des femmes sur le marché du travail qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, ou d’autres types de titres de compétences.
Le graphique 6.16 montre que l’on compte beaucoup moins de femmes que d’hommes parmi les Canadiens qui sont sur le marché du travail et qui ont un certificat d’apprentis ou professionnel. D’autre part, on compte plus de femmes que d’hommes chez les diplômés collégiaux et universitaires. On remarque aussi que moins de femmes que d’hommes n’ont pas de certificat. Le pourcentage de diplômés du secondaire est environ le même chez les deux sexes.
Le graphique 6.17 montre la distribution des femmes dans quelques métiers sur une période donnée. La tendance observée est semblable à celle affichée plus tôt chez les apprentis. On remarque en effet une plus grande proportion de cuisiniers sur le marché du travail que dans le nombre d'inscriptions à un apprentissage. En plus des coiffeurs et cuisiniers, on compte chez les boulangers, les peintres et décorateurs ainsi que les magasiniers et commis aux pièces au moins 10 % de femmes. La proportion de femmes dans les autres métiers demeure très faible (2 % ou moins) et n’est donc pas affichée. Au fil du temps, la proportion des femmes qui sont coiffeuses a augmenté légèrement, alors que la représentation des femmes dans le métier de cuisinier a baissé légèrement. Dans les autres métiers, la proportion des femmes boulangères et peintres/décoratrices a augmenté, alors qu’elle a baissé un peu chez les magasiniers et commis aux pièces dans les années antérieures pour ensuite demeurer stable au cours des dernières années. On a remarqué que le dernier métier est assez important où, semblable à celui des cuisiniers, on ne compte qu’une faible proportion d’apprentis.
Graphique 6.16 Niveaux d’instruction selon le sexe [Source : Recensement 2006]
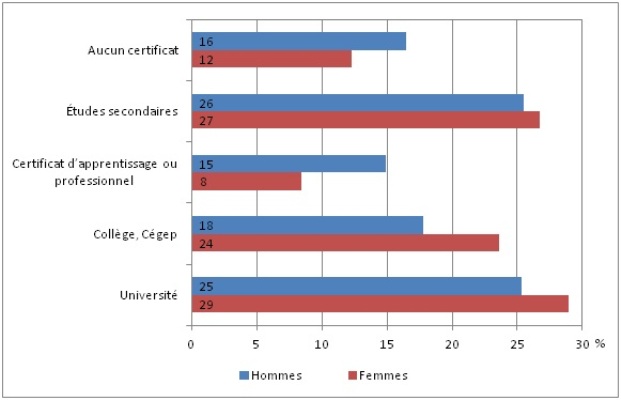
Description de l’image Graphique 6.16 Niveaux d’instruction selon le sexe [Source : Recensement 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant les niveaux d’instruction atteints selon le sexe, d’après le recensement de 2006. Les niveaux d’instruction atteints sont : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; collège ou Cégep, et université.
Pour ce qui est des hommes, 16 % n’avaient aucun certificat, 26 % avaient un diplôme d’études secondaires, 15 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 18 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 25 % avaient un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des femmes, 12 % n’avaient aucun certificat, 27 % avaient un diplôme d’études secondaires, 8 % avaient un certificat d’apprentissage ou professionnel, 24 % avaient un diplôme d’un collège ou d’un Cégep, et 29 % avaient un diplôme universitaire.
Graphique 6.17 Pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
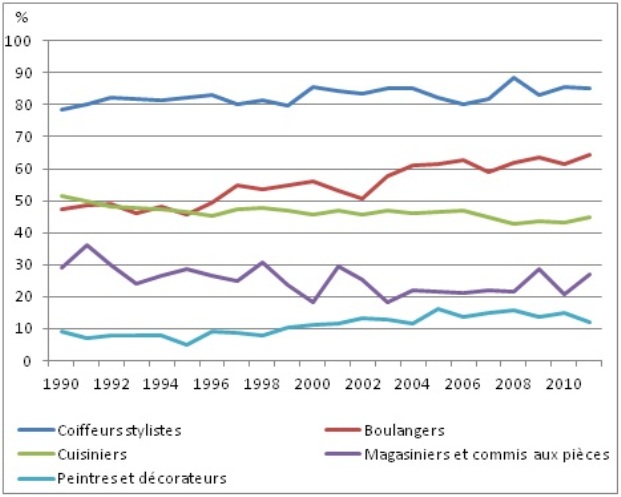
Description de l’image Graphique 6.17 Pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de femmes dans des métiers sélectionnés, de 1990 à 2011. Ces derniers incluent les métiers de coiffeur-styliste et barbier; boulanger; cuisinier; magasinier et commis aux pièces, ainsi que peintre et décorateur.
Le pourcentage de femmes dans le métier de coiffeur-styliste et barbier était de 79 % en 1990 et avait augmenté légèrement à 84 % en 2001. Le pourcentage était de 82 % en 2002; 80 % en 2003; 83 % en 2004; 88 % en 2005; 83 % en 2006; 86 % en 2007; 88 % en 2008; 83 % en 2009; 86 % en 2010, et 85 % en 2011.
Le pourcentage de femmes dans le métier de boulanger était de 47 % en 1990 et avait augmenté à 53 % en 2001. Le pourcentage était de 50 % en 2002; 58 % en 2003; 61 % en 2004; 62 % en 2005; 63 % en 2006; 59 % en 2007; 62 % en 2008; 64 % en 2009; 62 % en 2010, et 64 % en 2011.
Le pourcentage de femmes dans le métier de cuisinier était de 51 % en 1990 et avait diminué légèrement à 46 % en 2001. Le pourcentage était de 47 % en 2002; 46 % en 2003; 46 % en 2004; 47 % en 2005; 47 % en 2006; 45 % en 2007; 43 % en 2008; 44 % en 2009; 43 % en 2010, et 45 % en 2011.
Le pourcentage de femmes dans le métier de magasinier et commis aux pièces était de 29 % en 1990 et est resté stable jusqu’en 2001. Le pourcentage était de 25 % en 2002; 18 % en 2003; 22 % en 2004; 22 % en 2005; 21 % en 2006; 22 % en 2007; 22 % en 2008; 29 % en 2009; 21 % en 2010, et 27 % en 2011.
Le pourcentage de femmes dans le métier de peintre et décorateur était de 9 % en 1990 et avait augmenté légèrement à 11 % en 2001. Le pourcentage était de 13 % en 2002; 13 % en 2003; 11 % en 2004; 16 % en 2005; 15 % en 2006; 15 % en 2007; 16 % en 2008; 14 % en 2009; 15 % en 2010, et 12 % en 2011.
Le graphique 3.35 (page 136) indique que les immigrants sont sous-représentés chez les apprentis par rapport à leur proportion dans l’ensemble de la population. Les résultats affichés dans le tableau 6.18 aident à expliquer ce phénomène. Les immigrants sont quelque peu sous-représentés dans les métiers et chez les détenteurs de certificat d’apprentissage par rapport aux travailleurs nés au Canada. Par contre, la proportion d’immigrants qui ont fait des études universitaires est beaucoup plus élevée que chez les travailleurs nés au Canada. Les données de l’EPA de 2006Note de bas de page 51 à 2011 montrent qu’environ 13 % de tous les immigrants travaillaient dans les métiers au cours de cette période, ce qui est comparable à la proportion chez l’ensemble des Canadiens. En raison du manque de données détaillées sur les immigrants, il est difficile d’obtenir des renseignements précis sur la correspondance entre les certificats d’apprentissage/professionnels et les métiers et entre les métiers et les certificats.
Graphique 6.18 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant [Source : Recensement de 2006]
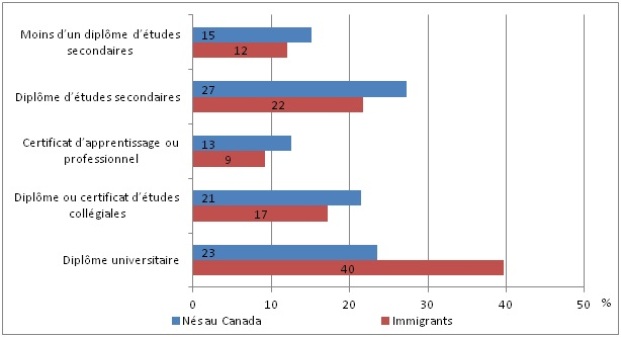
Description de l’image Graphique 6.18 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant la distribution des niveaux d’instruction selon le statut d’immigrant, soit né au Canada ou immigrant. Les niveaux d’instruction incluent : moins d’un diplôme d’études secondaires; diplôme d’études secondaires; certificat d’apprentissage ou professionnel; diplôme ou certificat d’études collégiales, et diplôme universitaire.
Pour ce qui est des personnes nées au Canada, 15 % ont moins d’un diplôme d’études secondaires, 27 % ont un diplôme d’études secondaires, 13 % ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, 21 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 23 % ont un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des immigrants, 12 % ont moins d’un diplôme d’études secondaires, 22 % ont un diplôme d’études secondaires, 9 % ont un certificat d’apprentissage ou professionnel, 17 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 40 % ont un diplôme universitaire.
Il est impossible d’obtenir des renseignements détaillés sur les apprentis autochtones en raison de l’importante quantité de renseignements manquants pour cet aspect du SIAI. Par contre, les niveaux d’instruction sont accessibles grâce au Recensement de 2006. Le tableau 6.19 présente un portrait différent pour les individus d’identité autochtone par rapport à celui des femmes et des immigrants. La proportion d’Autochtones qui ont un certificat d’apprenti ou professionnel est un peu plus élevée que celle du reste de la population. Pour les autres niveaux d’instruction, on remarque de plus grandes différences entre les deux groupes, avec les Autochtones comptant une plus grande proportion de personnes n’ayant pas de certificat et une faible proportion de celles ayant un diplôme universitaire. Les données de l’EPA de 2007 à 2011 montrent qu’environ 22 % des Autochtones travaillaient dans les métiers au cours de cette période. En raison de limites relatives aux données, il est difficile d’obtenir des renseignements détaillés sur la correspondance entre les certificats d’apprentissage/professionnels et les professions et entre les professions et les certificats.
Graphique 6.19 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone [Source : Recensement de 2006]
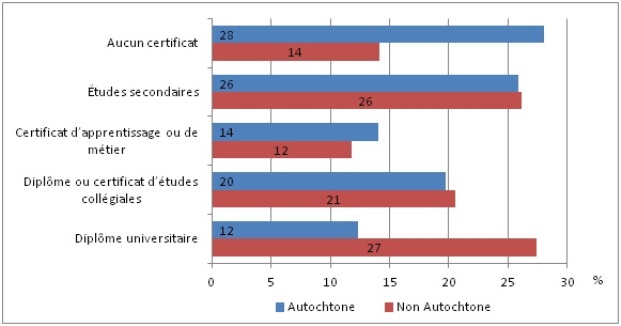
Description de l’image Graphique 6.19 Distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique à barres illustrant la distribution des niveaux d’instruction selon le statut autochtone. Les niveaux d’instruction incluent : aucun certificat; études secondaires; certificat d’apprentissage ou de métier; diplôme ou certificat d’études collégiales, et diplôme universitaire.
Pour ce qui est des Autochtones, 28 % n’ont aucun certificat, 26 % ont un diplôme d’études secondaires, 14 % ont un certificat d’apprentissage ou de métier, 20 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 12 % ont un diplôme universitaire.
Pour ce qui est des non-Autochtones, 14 % n’ont aucun certificat, 26 % ont un diplôme d’études secondaires, 12 % ont un certificat d’apprentissage ou de métier, 21 % ont un diplôme ou certificat d’études collégiales et 27 % ont un diplôme universitaire.
6.4 L’offre : source de personnes de métier
6.4.1 Inscription et réussite des programmes d’apprentissage dans le contexte du marché du travail
Puisque les apprentis ne sont pas identifiés de façon explicite dans le Recensement ou l’Enquête sur la population active, il est difficile de déterminer si les apprentis devraient être considérés comme faisant partie de la population active, comme des stagiaires ou comme des étudiants, dont la contribution à la productivité de l’employeur n’est apportée qu’après l’achèvement du programme. Une récente étude réalisée par le Forum canadien sur l'apprentissage (FCA, 2009) indique, qu’au Canada, il y a un important bénéfice net associé à l’embauche d’apprentis et qu’on retire un dollar quarante-sept, en moyenne, sur chaque dollar investi dans l’apprentissage. Certains gains sont associés à l’embauche d’apprentis dans tous les métiers, mais leur importance varie beaucoup d’un métier à l’autre.
À vrai dire, aucune des sources de données n’identifie explicitement les apprentis ou ne les associe à leur métier précis. Ni le Recensement ou l’EPA ne propose une catégorie qui permet d’identifier les apprentis, et le SIAI ne propose pas de variable pour identifier les métiers. Pour cette section, les apprentis sont considérés comme faisant partie de la population active, et donc comme source de travailleurs. En réalité, certains coefficients de réduction pourraient être nécessaires pour tenir compte de la possibilité que certains apprentis pourraient ne pas travailler, ou travailler dans une profession qui n’est pas le métier pour lequel ils ont un certificat. Étant donné que la principale préoccupation est ici liée aux tendances, la proportion exacte d’apprentis qui travaillent dans leur métier est moins importante que la façon dont cette situation change au fil du temps.
Puisque la proportion d’apprentis par rapport à la population active totale varie beaucoup selon les métiers, et parce que plusieurs métiers ne comptent qu’un petit nombre d’apprentis, la présente analyse est limitée aux dix principaux métiers.Note de bas de page 52 Le graphique 6.20 montre les apprentis inscrits comme un pourcentage de la main-d’œuvre totale dans ces métiers. La caractéristique la plus frappante de ces données est la croissance rapide du ratio d’apprentis inscrits dans les métiers de tuyauteurs, où le nombre d’apprentis représente désormais plus de la moitié de la main-d’œuvre totale. Ce phénomène s’explique surtout par l’augmentation du nombre d’inscriptions chez les apprentis, qui a augmenté d’environ 140 % depuis 2001, à un moment où la population active dans ce secteur n’a augmenté que d’environ 35 %. La croissance de la proportion d’apprentis par rapport à la main-d’œuvre a aussi été très rapide pour les métiers de charpentier et d’électricien. Le nombre d’apprentis a plus que doublé alors que la main-d’œuvre a augmenté d’environ 33 % depuis 2001. Dans chacun de ces métiers, le nombre d’apprentis représente maintenant environ 35 % de la main-d’œuvre totale.
Les ratios dans l’ensemble des autres métiers affichent une hausse depuis environ 2000, ce qui indique qu’au fil du temps, les apprentis ont commencé à apporter une plus grande contribution à la main-d’œuvre en général. Par contre, à l’exception des techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles et des mécaniciens de machinerie lourde, le pourcentage d’apprentis demeure inférieur à 20 %, et à 10 % chez les cuisiniers et boulangers.
Graphique 6.20 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
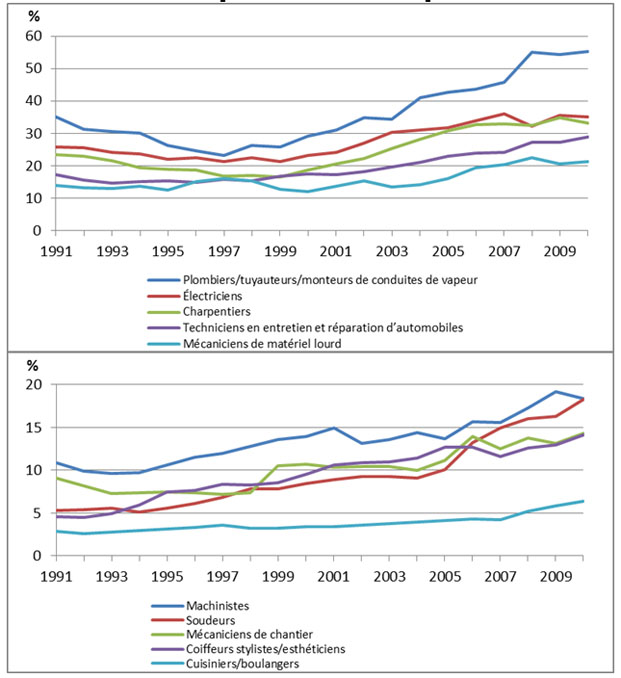
Description de l’image Graphique 6.20 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
Il s’agit de deux graphiques linéaires simples illustrant le taux d’inscription à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les dix principaux métiers, de 1991 à 2010.
Le taux d’inscription pour les plombiers était de 35 % en 1991 et avait diminué à 29 % en 2000. Le taux d’inscription pour les plombiers était de 21 % en 2001; 35 % en 2002; 34 % en 2003; 41 % en 2004; 43 % en 2005; 44 % en 2006; 46 % en 2007; 55 % en 2008; 54 % en 2009, et 55 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les électriciens était de 26 % en 1991 et avait diminué à 23 % en 2000. Le taux d’inscription pour les électriciens était de 24 % en 2001; 27 % en 2002; 30 % en 2003; 31 % en 2004; 32 % en 2005; 34 % en 2006; 36 % en 2007; 32 % en 2008; 36 % en 2009, et 35 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les charpentiers était de 23 % en 1991 et avait diminué à 19 % en 2000. Le taux d’inscription pour les charpentiers était de 21 % en 2001; 22 % en 2002; 25 % en 2003; 28 % en 2004; 31 % en 2005; 33 % en 2006; 33 % en 2007; 32 % en 2008; 25 % en 2009, et 33 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 17 % en 1991 et est resté stable jusqu’en 2000 où il était de 18 %. Le taux d’inscription pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 17 % en 2001; 18 % en 2002; 20 % en 2003; 21 % en 2004; 23 % en 2005; 24 % en 2006; 24 % en 2007; 27 % en 2008; 27 % en 2009, et 29 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les mécaniciens de matériel lourd était de 14 % en 1991 et avait diminué à 12 % en 2000. Le taux d’inscription pour les mécaniciens de matériel lourd était de 14 % en 2001; 15 % en 2002; 13 % en 2003; 14 % en 2004; 16 % en 2005; 19 % en 2006; 20 % en 2007; 23 % en 2008; 21 % en 2009, et 21 % en 2010.
Tel qu’illustré dans le second graphique, le taux d’inscription pour les machinistes était de 11 % en 1991 et avait augmenté à 14 % en 2000. Le taux d’inscription pour les machinistes était de 15 % en 2001; 13 % en 2002; 14 % en 2003; 14 % en 2004; 14 % en 2005; 16 % en 2006; 16 % en 2007; 17 % en 2008; 19 % en 2009, et 18 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les soudeurs était de 5 % en 1991 et avait augmenté à 8 % en 2000. Le taux d’inscription pour les soudeurs était de 9 % de 2001 à 2004; 10 % en 2005; 13 % en 2006; 15 % en 2007; 16 % en 2008; 15 % en 2009, et 18 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les mécaniciens de chantier était de 9 % en 1991 et avait augmenté à 11 % en 2000. Le taux d’inscription pour les mécaniciens de chantier était de 10 % de 2001 à 2004; 13 % en 2005; 13 % en 2006; 12 % en 2007; 13 % en 2008; 13 % en 2009, et 14 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les coiffeurs-stylistes était de 5 % en 1991 et avait augmenté à 10 % en 2000. Le taux d’inscription pour les coiffeurs-stylistes était de 11 % de 2001 à 2004; 13 % en 2005; 13 % en 2006; 12 % en 2007; 13 % en 2008; 13 % en 2009, et 14 % en 2010.
Le taux d’inscription pour les cuisiniers et boulangers était de 3 % en 1991 et est demeuré stable à 3 % jusqu’en 2000. Le taux d’inscription était de 3 % en 2001; 4 % de 2002 à 2007; 5 % en 2008; 6 % en 2009, et 6 % en 2010.
Si les apprentis font partie de la population active, les finissants des programmes d’apprentissage ne peuvent être considérés comme source de travailleurs. Il serait préférable de considérer les finissants comme une addition au bassin de compagnons d’apprentissage. Selon les qualifications des travailleurs qui quittent le marché du travail, ces gains pourraient contribuer à améliorer la proportion générale de travailleurs accrédités. Il est utile de percevoir les finissants de programmes d’apprentissage comme une proportion de l’ensemble de la population active afin de donner une idée de ce potentiel.
Le graphique 6.21 fournit ces résultats pour les mêmes métiers comme dans le graphique 6.19. Le modèle observé est semblable à celui associé aux inscriptions. On compte suffisamment de nouveaux apprentis certifiés pour remplacer une proportion croissante de la main-d’œuvre dans la plupart des métiers, mais avec de grandes variations dans les proportions entre les différents métiers. Encore une fois, c’est dans les métiers de tuyauteurs et d’électriciens qu’on enregistre les plus grandes proportions. Ces secteurs ont connu une croissance rapide au cours des dernières années. La croissance a aussi été importante pour les métiers de soudeur, de charpentier et de mécaniciens de machinerie lourde. Dans les cinq autres métiers, les proportions et les taux de croissance sont plus faibles, comme l’indique le deuxième encadré du graphique 6.20. La question la plus importante demeure à savoir si ces nombres sont suffisants pour répondre à la demande actuelle et future. Cette question est abordée dans une autre partie de ce document.
Graphique 6.21 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
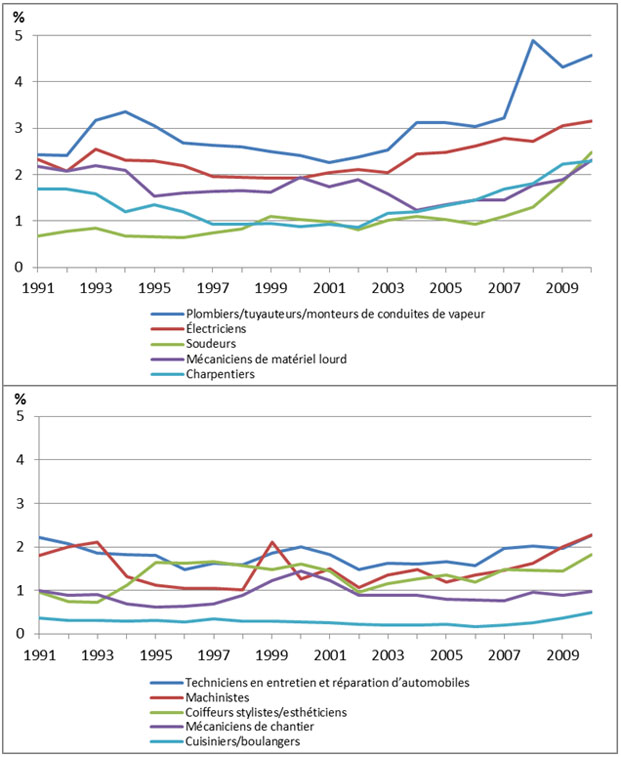
Description de l’image Graphique 6.21 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les 10 principaux métiers, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
Il s’agit de deux graphiques linéaires simples illustrant la réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les dix principaux métiers, de 1991 à 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les plombiers était de 2,4 % en 1991 et est restée stable jusqu’en 2000. Le taux était de 2,3 % en 2001; 3,4 % en 2002; 2,5 % en 2003; 3,1 % en 2004; 3,1 % en 2005; 3 % en 2006; 3,2 % en 2007; 4,9 % en 2008; 4,3 % en 2009, et 4,6 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les électriciens était de 2,3 % en 1991 et avait diminué à 1,93 % en 2000. Le taux était de 2 % en 2001; 2,1 % en 2002; 2 % en 2003; 2,5 % en 2004; 2,5 % en 2005; 2,6 % en 2006; 2,8 % en 2007; 2,7 % en 2008; 3,1 % en 2009, et 3,2 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les soudeurs était de 0,7 % en 1991 et avait augmenté à 1 % en 2000. Le taux était de 1 % en 2001; 0,8 % en 2002; 1 % en 2003; 1,1 % en 2004; 1 % en 2005; 0,9 % en 2006; 1,1 % en 2007; 1,3 % en 2008; 1,9 % en 2009, et 2,5 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les mécaniciens de matériel lourd était de 2,2 % en 1991 et avait diminué à 1,94 % en 2000. Le taux était de 1,7 % en 2001; 1,9 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,2 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,5 % en 2006; 1,5 % en 2007; 1,8 % en 2008; 1,9 % en 2009, et 2,3 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les charpentiers était de 1,7 % en 1991 et avait diminué à 0,9 % en 2000. Le taux était de 1,7 % en 2001; 1,9 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,2 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,5 % en 2006; 1,7 % en 2007; 1,8 % en 2008; 2,2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 2,2 % en 1991 et avait augmenté à 2 % en 2000. Le taux était de 1,8 % en 2001; 1,5 % en 2002; 1,6 % en 2003; 1,6 % en 2004; 1,6 % en 2005; 1,6 % en 2006; 2 % en 2007; 2 % en 2008; 2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les machinistes était de 1,8 % en 1991 et avait diminué à 1,3 % en 2000. Le taux était de 1,5 % en 2001; 1,1 % en 2002; 1,4 % en 2003; 1,5 % en 2004; 1,2 % en 2005; 2,4 % en 2006; 1,5 % en 2007; 1,6 % en 2008; 2 % en 2009, et 2,3 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les coiffeurs-stylistes était de 1 % en 1991 et avait augmenté à 1,6 % en 2000. Le taux était de 1,4 % en 2001; 1 % en 2002; 1,2 % en 2003; 1,3 % en 2004; 1,4 % en 2005; 1,2 % en 2006; 1,5 % de 2007 à 2009, et 1,5 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les mécaniciens de chantier était de 1 % en 1991 et avait augmenté à 1,5 % en 2000. Le taux était de 1,2 % en 2001; 0,9 % de 2002 à 2004; 0,8 % de 2005 à 2007; 1 % en 2008; 0,9 % en 2009, et 1 % en 2010.
La réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale pour les cuisiniers était de 0,4 % en 1991 et avait diminué à 0,3 % en 2000. Le taux était de 0,3 % en 2001; 0,2 % de 2002 à 2007; 0,3 % en 2008; 0,4 % en 2009, et 0,5 % en 2010.
6.4.2 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite selon la province
Le graphique 6.22 montre les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre totale dans les métiers par province.Note de bas de page 53 Ici encore, la tendance de l’augmentation des ratios est apparente dans la majorité des provinces, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. L’augmentation rapide des ratios suivie d’une baisse de 1997 à 2007 est une conséquence d’une importante hausse du nombre d’inscriptions suivie d’une baisse au cours de cette période. Cette tendance n’est observée dans aucune autre province/territoire. Même au cours des dernières années, par contre, le ratio enregistré à Terre-Neuve-et-Labrador demeure plus élevé que dans la majorité des autres provinces/territoires. C’est en Alberta et, dans une moindre mesure, au Québec, qu’on observe les augmentations les plus rapides des inscriptions aux programmes d’apprentissage par rapport au marché du travail. On a aussi observé en Ontario une plus forte augmentation du nombre d’inscriptions que dans les autres provinces de 2007 à 2010, mais le point de référence de cette province était plus bas que celui des provinces dont il était mention plus haut.
Graphique 6.22 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, par province/territoire, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
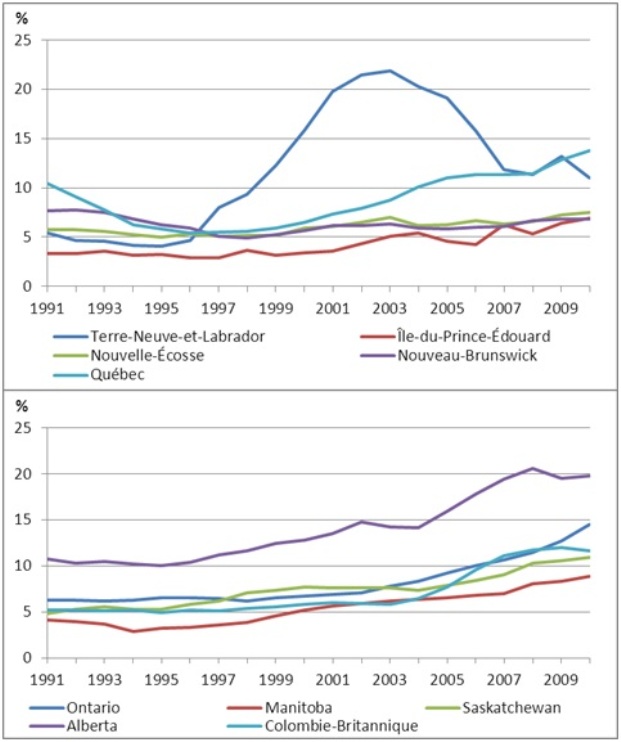
Description de l’image Graphique 6.22 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés, par province/territoire, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés par province, de 1991 à 2010.
À Terre-Neuve-et-Labrador, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 5,4 % en 1991 et avaient augmenté à 15,9 % en 2000. Le pourcentage était de 19,8 % en 2001; 21,4 % en 2002; 21,9 % en 2003; 20,3 % en 2004; 19,2 % en 2005; 15,8 % en 2006; 11,8 % en 2007; 11,3 % en 2008; 13,2 % en 2000, et 11 % en 2010.
À l’Île-du-Prince-Édouard, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 3,4 % en 1991 et sont restées stables jusqu’en 2000. Le pourcentage était de 3,6 % en 2001; 4,3 % en 2002; 5,1 % en 2003; 5,4 % en 2004; 4,6 % en 2005; 4,3 % en 2006; 6,2 % en 2007; 5,3 % en 2008; 6,4 % en 2009, et 6,9 % en 2010.
En Nouvelle-Écosse, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 5,8 % en 1991 et sont restées stables jusqu’en 2000. Le pourcentage était de 6,1 % en 2001; 6,5 % en 2002; 7 % en 2003; 6,2 % en 2004; 6,2 % en 2005; 6,7 % en 2006; 6,3 % en 2007; 6,6 % en 2008; 7,2 % en 2009, et 7,5 % en 2010.
Au Nouveau-Brunswick, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 7,7 % en 1991 et avaient diminué à 5,7 % en 2000. Le pourcentage était de 6,1 % en 2001; 6,1 % en 2002; 6,3 % en 2004; 5,9 % en 2005; 6 % en 2006; 6,1 % en 2007; 6,7 % en 2008; 7,8 % en 2009, et 7,9 % en 2010.
Au Québec, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 10,5 % en 1991 et avaient diminué à 6,5 % en 2000. Le pourcentage était de 7,3 % en 2001; 7,9 % en 2002; 8,8 % en 2003; 10,1 % en 2004; 11 % en 2005; 11,3 % en 2006; 11,3 % en 2007; 11,5 % en 2008; 12,8 % en 2009, et 13,7 % en 2010.
En Ontario, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 6,3 % en 1991 et sont restées stables, atteignant 6,7 % en 2000. Le pourcentage était de 6,9 % en 2001; 7,1 % en 2002; 7,8 % en 2003; 8,4 % en 2004; 9,3 % en 2005; 10,1 % en 2006; 10,7 % en 2007; 11,5 % en 2008; 12,7 % en 2009, et 14,5 % en 2010.
Au Manitoba, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 4,1 % en 1991 et avaient augmenté à 5,2 % en 2000. Le pourcentage était de 5,6 % en 2001; 6 % en 2002; 6,2 % en 2003; 6,3 % en 2004; 6,6 % en 2005; 6,8 % en 2006; 7 % en 2007; 8,1 % en 2008; 8,3 % en 2009, et 8,8 % en 2010.
En Saskatchewan, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 4,8 % en 1991 et avaient augmenté à 7,7 % en 2000. Le pourcentage était de 7,6 % de 2001 à 2003; 7,4 % en 2004; 7,9 % en 2005; 8,5 % en 2006; 9 % en 2007; 10,3 % en 2008; 10,5 % en 2009, et 10,9 % en 2010.
En Alberta, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 10,7 % en 1991 et avaient augmenté à 12,8 % en 2000. Le pourcentage était de 13,5 % en 2001; 14,8 % en 2002; 14,2 % en 2003; 14,1 % en 2004; 16 % en 2005; 17,8 % en 2006; 19,4 % en 2007; 20,6 % en 2008; 19,5 % en 2009, et 19,8 % en 2010.
En Colombie-Britannique, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la population active totale dans les métiers spécialisés étaient de 5,2 % en 1991 et avaient augmenté à 5,8 % en 2000. Le pourcentage était de 6 % en 2001; 6 % en 2002; 5,8 % en 2003; 6,5 % en 2004; 7,7 % en 2005; 9,6 % en 2006; 11,1 % en 2007; 11,7 % en 2008; 12 % en 2009, et 11,6 % en 2010.
6.4.3 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite dans le contexte de l’enseignement postsecondaire
Bien que les programmes d’apprentissage ne soient pas considérés par Statistique Canada comme faisant partie de l’enseignement postsecondaire, il est utile de se de comparer les inscriptions aux programmes d’apprentissage et la réussite celles aux programmes d’enseignement postsecondaire, puisque ces deux systèmes, du moins en théorie, puisent leurs participants dans le même bassin de jeunes.Note de bas de page 54 La comparaison des inscriptions aux programmes d’apprentissage à celles des programmes d’enseignement postsecondaire aide à déterminer si l’apprentissage gagne en popularité auprès des jeunes.
Le graphique 6.23 présente les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un pourcentage des inscriptions totales aux programmes d’enseignement postsecondaire, et la réussite des programmes d’apprentissage comme un pourcentage des diplômés de niveau postsecondaire. On remarque que l’augmentation des inscriptions aux programmes d’apprentissage depuis environ 2000 a dépassé considérablement celle des inscriptions aux programmes d’enseignement postsecondaire. En prenant en considération que l’apprentissage représente un choix de carrière tardif pour plusieurs individus, les résultats associés aux études postsecondaires suggèrent que certaines personnes pourraient avoir effectué une transition d’autres programmes de niveau postsecondaire vers l’apprentissage. Par contre, les données ne permettent pas de confirmer cette possibilité. La faible baisse du ratio en 2009 indique que la récession a eu une plus grande incidence sur les inscriptions à l’apprentissage que sur l’inscription aux programmes d’enseignement postsecondaire.
Les données associées à la réussite des programmes d’apprentissage sont différentes de celles des inscriptions. Les taux de réussite des programmes d’apprentissage affichent un faible déclin par rapport à la réussite des programmes d’enseignement postsecondaire dans les années 1990, suivi d’un ratio constant pour la majorité des années 2000, d’une légère augmentation en 2007 et 2008, et d’un plateau en 2009. Dans l’ensemble, le ratio le plus récent est environ le même que celui enregistré au début des années 1990. Ce phénomène est probablement lié aux résultats précédents sur les taux de réussite des programmes d’apprentissage, qui avaient baissé un peu vers la fin des années 1990, avant de se stabiliser au cours des dernières années.
Graphique 6.23 Apprentissage dans le contexte de l’éducation postsecondaire, de 1992 à 2010 [Source : SIAI/CANSIM]
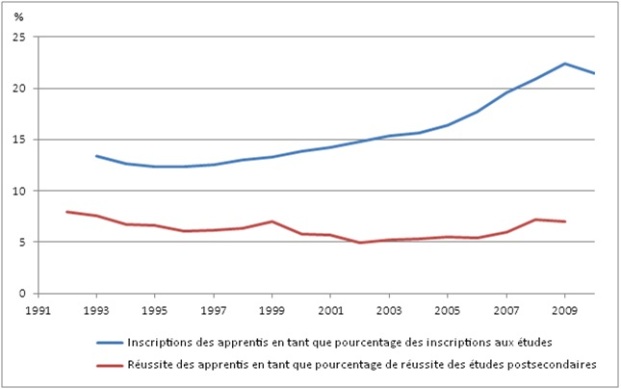
Description de l’image Graphique 6.23 Apprentissage dans le contexte de l’éducation postsecondaire, de 1992 à 2010 [Source : SIAI/CANSIM]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la réussite des apprentis en tant que pourcentage de réussite des études postsecondaires.
Les inscriptions des apprentis en tant que pourcentage des inscriptions aux études postsecondaires étaient de 13,4 % en 1993 et avaient augmenté à 13,9 % en 2000. Le taux était de 14,3 % en 2001; 14,8 % en 2002; 15,3 % en 2003; 15,7 % en 2004; 16,4 % en 2005; 17,7 % en 2006; 19,6 % en 2007; 20,9 % en 2007; 22,4 % en 2009, et 21,5 % en 2010.
La réussite des apprentis en tant que pourcentage de réussite des études postsecondaires était de 7,9 % en 1992 et avait diminué à 5,8 % en 2000. Le taux était de 5,7 % en 2001; 4,9 % en 2002; 5,2 % en 2003; 5,3 % en 2004; 5,5 % en 2005; 5,4 % en 2006; 6 % en 2007; 7,2 % en 2008, et 7 % en 2009.
6.4.4 Inscription aux programmes d’apprentissage et réussite selon le sexe
Le graphique 6.24 montre les inscriptions aux programmes d’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre spécialisée pour les hommes et les femmes. Dans chacun des cas, le pourcentage est basé sur la proportion d’apprentis par rapport aux personnes de métier selon le sexe. Bien que les femmes ne représentent qu’un très petit pourcentage des apprentis et de la main-d’œuvre spécialisée, le pourcentage de femmes apprenties par rapport aux femmes de la main-d’œuvre spécialisée augmente plus rapidement que celui des hommes. Comme il a été indiqué plus tôt dans ce rapport, ce phénomène s’explique surtout par une augmentation du nombre d’apprenties dans des métiers autres que les dix principaux.
La même tendance de réussite des programmes d’apprentissage est présentée dans le graphique 6.25. Bien que les finissants des programmes d’apprentissage ne représentent qu’un faible pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers, ce pourcentage a presque doublé au cours de la dernière décennie, et la proportion des femmes est maintenant semblable à celle des hommes. Ces proportions ne sont pas directement comparables à celles des dix principaux métiers présentées dans le graphique 6.20 parce que les numérateurs et les dénominateurs des ratios englobent un ensemble de métiers beaucoup plus large. Ce que ces résultats indiquent, par contre, est que les proportions associées aux métiers autres que les dix principaux sont beaucoup plus faibles que dans les dix métiers les plus populaires.
Graphique 6.24 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers spécialisés, selon le sexe, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/ENA]
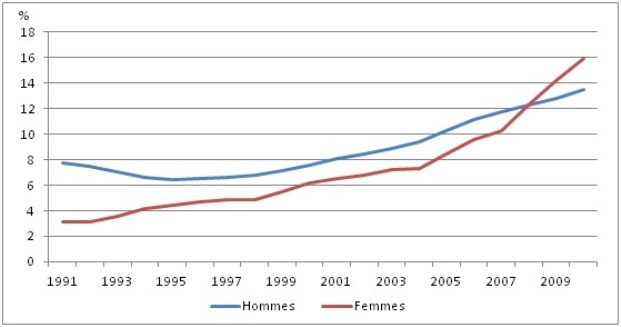
Description de l’image Graphique 6.24 Inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers spécialisés, selon le sexe, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/ENA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers spécialisés selon le sexe, de 1991 à 2010.
Pour ce qui est des hommes, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers spécialisés étaient de 8 % en 1991, avaient diminué à 6 % en 1996, puis avaient augmenté à 8 % en 2000. Le taux était de 8 % en 2001; 8 % en 2002; 9 % en 2003; 9 % en 2004; 10 % en 2005; 11 % en 2006; 12 % en 2007; 12 % en 2008; 13 % en 2009, et 13 % en 2010.
Pour ce qui est des femmes, les inscriptions à l’apprentissage comme un pourcentage de la main-d’œuvre dans les métiers spécialisés étaient de 3 % en 1991 et avaient augmenté à 6 % en 2000. Le taux était de 7 % de 2001 à 2004; 8 % en 2005; 10 % en 2006; 10 % en 2007; 12 % en 2008; 14 % en 2009, et 16 % en 2010.
Graphique 6.25 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés, selon le sexe, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
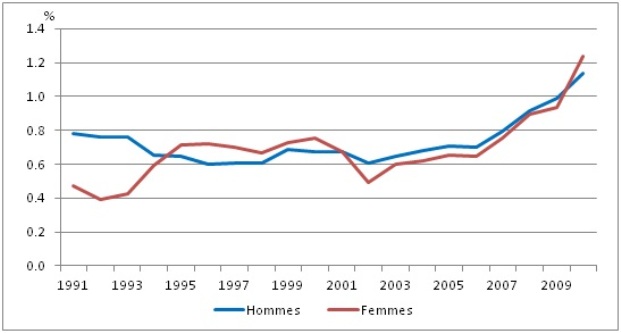
Description de l’image Graphique 6.25 Réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés, selon le sexe, de 1991 à 2010 [Source : CANSIM/EPA]
Il s’agit d’un graphique illustrant la réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés selon le sexe, de 1991 à 2010.
Pour ce qui est des hommes, la réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés était de 0,8 % en 1991 et avait diminué à 0,7 % en 2000. Le taux était de 0,7 % en 2001; 0,6 % en 2002; 0,6 % en 2003; 0,7 % de 2004 à 2007; 0,8 % en 2007; 0,9 % en 2008; 1,0 % en 2009, et 1,1 % en 2010.
Pour ce qui est des femmes, la réussite de l’apprentissage comme un pourcentage de la population active dans les métiers spécialisés était de 0,5 % en 1991 et avait augmenté à 0,8 % en 2000. Le taux était de 0,7 % en 2001; 0,5 % en 2002; 0,6 % en 2003; 0,6 % en 2004; 0,7 % en 2005; 0,6 % en 2006; 0,8 % en 2007; 0,9 % en 2008; 0,9 % en 2009, et 1,2 % en 2010.
6.4.5 Inscription à l’apprentissage chez les immigrants
Les sources de données comme l’EPA et le SIAI ne fournissent pas le nombre d’immigrants qui se sont inscrits à un programme d’apprentissage et qui l’ont terminé. Les données de Citoyenneté et Immigration Canada fournissent des renseignements sur le nombre d’immigrants inscrits en fonction de leur niveau de compétence. Une analyse précédente (partie 6.3.5) indique que la majorité des emplois qui nécessitent un niveau de compétence B nécessitent aussi des certificats d’apprentissage ou professionnels. En calculant la proportion d’immigrants qui ont ce niveau de compétence, il devrait être possible d’avoir un aperçu de la correspondance entre les compétences des immigrants et les compétences associées aux métiers. Ce calcul est présenté dans le graphique 6.26, qui montre que le pourcentage des travailleurs qui ont un niveau de compétence B est un peu plus important que la proportion de la main-d’œuvre à ce niveau de compétence. Par contre, étant donné l’important pourcentage des travailleurs pour qui le niveau de compétence n’est pas fourni, ces données sont plutôt imprécises.
Le Recensement de 2006 fournit certains renseignements additionnels sur les titres de compétences des immigrants dans les métiers. Le graphique 6.27 illustre la répartition des immigrants établis et des nouveaux immigrants par rapport aux personnes nées au pays. On remarque que les nouveaux immigrants sont moins susceptibles d’avoir des titres de compétences dans les métiers que les immigrants établis. Combinées aux résultats présentés dans le graphique 6.17 pour tous les niveaux d’instruction, ces données suggèrent que les nouveaux immigrants sont plus susceptibles d’avoir un diplôme universitaire que des titres de compétences dans les métiers.
Graphique 6.26 Pourcentage des nouveaux travailleurs étrangers, selon le niveau de compétences, de 2001 à 2010
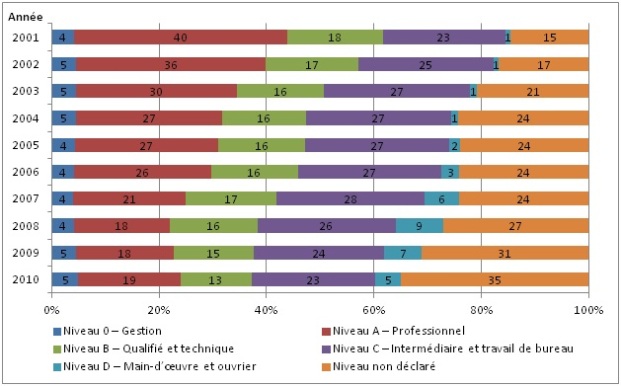
Description de l’image Graphique 6.26 Pourcentage des nouveaux travailleurs étrangers, selon le niveau de compétences, de 2001 à 2010
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage des nouveaux travailleurs étrangers selon le niveau de compétence, de 2001 à 2010. Les niveaux de compétence inclus sont : niveau 0 – gestion; niveau A – professionnel; niveau B – qualifié et technique; niveau C – intermédiaire et travail de bureau; niveau D – main-d’œuvre et ouvrier, et niveau non déclaré.
Le pourcentage de travailleurs étrangers ayant un niveau de compétence 0 – gestion était de 4 % en 2001; 5 % de 2002 à 2004; 4 % de 2005 à 2008; 5 % en 2009, et 5 % en 2010.
Le pourcentage de travailleurs étrangers ayant un niveau de compétence A – professionnel était de 40 % en 2001; 36 % en 2002; 30 % en 2003; 27 % en 2004; 27 % en 2005; 26 % en 2006; 21 % en 2007; 28 % en 2008; 28 % en 2009, et 19 % en 2010.
Le pourcentage de travailleurs étrangers ayant un niveau de compétence B – qualifié et technique était de 18 % en 2001; 17 % en 2002; 16 % de 2003 à 2006; 17 % en 2007; 16 % en 2008; 15 % en 2009, et 15 % en 2010.
Le pourcentage de travailleurs étrangers ayant un niveau de compétence C – intermédiaire et travail de bureau était de 23 % en 2001; 25 % en 2002; 27 % de 2003 à 2006; 28 % en 2007; 26 % en 2008; 24 % en 2009, et 23 % en 2010.
Le pourcentage de travailleurs étrangers ayant un niveau de compétence D – main-d’œuvre et ouvrier était de 1 % de 2001 à 2004; 2 % en 2005; 3 % en 2006; 9 % en 2008; 7 % en 2009, et 5 % en 2010.
Le pourcentage de travailleurs étrangers de niveau non déclaré était de 15 % en 2001; 17 % en 2002; 21 % en 2003; 24 % de 2004 à 2007; 27 % en 2008; 31 % en 2009, et 35 % en 2010.
Graphique 6.27 Pourcentage d’immigrants et de personnes nées au Canada titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage en 2006 [Source : Recensement de 2006]
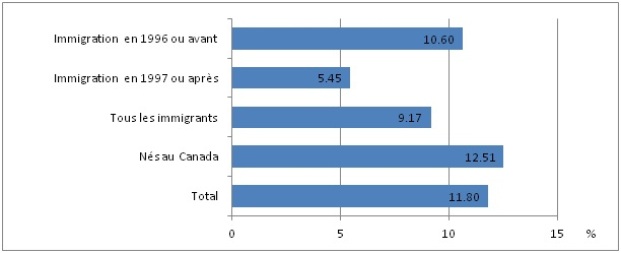
Description de l’image Graphique 6.27 Pourcentage d’immigrants et de personnes nées au Canada titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage en 2006 [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un graphique en barres illustrant le pourcentage d’immigrants et de personnes nées au Canada titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage. Cinq catégories sont représentées : immigration en 1996 ou avant; immigration en 1997 ou après; tous les immigrants; immigrants nés au Canada, et total de tous les groupes.
Le pourcentage d’immigrants ayant immigré en 1996 ou avant titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage était de 10,6 %.
Le pourcentage d’immigrants ayant immigré en 1997 ou après titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage était de 5,5 %.
Le pourcentage de tous les immigrants titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage était de 9,2 %.
Le pourcentage des personnes nées au Canada titulaires d’un certificat de métier ou d’apprentissage était de 12,5 %.
Le pourcentage des personnes de tous les groupes combinés ayant un certificat de métier ou d’apprentissage était de 11,8 %.
6.5 L’offre et la demande : le rôle de l’apprentissage dans les métiers sur le marché du travail
La question générale associée à ce chapitre est la suivante : quelle est l’incidence de l’apprentissage sur le marché du travail? Bien qu’il soit impossible de fournir une réponse complète à cette question, on peut se faire une idée grâce aux données accessibles. Les graphiques 6.20 et 6.21 de la partie 6.4.1 fournissent un aperçu de l’incidence de l’apprentissage sur le marché du travail. Ils montrent que la proportion d’apprentis et de finissants par rapport à la population active a augmenté au cours des dernières années. La contribution des apprentis au marché du travail est en hausse. Bien que la proportion de finissants des programmes d’apprentissage soit aussi en train d’augmenter, la tendance chez les finissants est moins évidente, puisque ces derniers ne sont pas considérés comme une source de travailleurs pour l’ensemble du marché du travail, mais seulement comme source de travailleurs accrédités.
Dans la mesure où le nombre de nouveaux travailleurs accrédités au cours d’une année est plus grand que le nombre de travailleurs accrédités qui quittent le marché du travail, les finissants de programmes d’apprentissage (et les travailleurs qualifiés) contribuent à augmenter la proportion de la population active qui détient un certificat. Puisque cette proportion n’a pas augmenté (voir les graphiques 6.7 et 6.10), on peut conclure que, jusqu’à maintenant, le nombre de nouveaux travailleurs accrédités a été tout juste suffisant pour remplacer les travailleurs qui quittent le marché du travail et permettre une croissance.
Quoi qu’il en soit, la grande vague d’inscriptions aux programmes d’apprentissage et l’augmentation des certificats accordés qui en découle (en tenant compte du délai entre l’inscription au programme et la réussite) améliorent les chances que la longue période de stabilité dans les proportions des travailleurs certifiés change au cours des quelques prochaines années. Ce phénomène nous amène à nous demander s’il est possible de prévoir les conséquences de ces changements. Ressources humaines et Développement des compétences Canada prépare régulièrement des projections sur l’offre et de la demande en main-d’œuvre selon les catégories larges de compétences et selon les métiers grâce à des modèles créés par le Système de projections des professions au Canada (SPPC). Ces projections sont utilisées ici pour fournir un portrait d’ensemble de l’offre et de la demande en travailleurs dans les métiers choisis. Les projections du SPPC sont complétées par des projections des inscriptions à l’apprentissage et de la réussite des programmes d’apprentissage. Ensemble, ces projections visent à répondre à la question posée au début de cette partie, selon les limites imposées par les données accessibles et les hypothèses pertinentes.
Comme il a été indiqué plus tôt, cette partie ne se veut pas être une étude complète de l’offre et de la demande en personnes de métier sur le marché du travail. Une telle étude nécessiterait l’accès à des sources de données auxquelles nous n’avions pas ici accès, incluant des sondages auprès des employeurs ainsi que des analyses plus précises de la répartition par âge des travailleurs, de l’incidence de l’immigration sur le marché du travail et des facteurs économiques et démographiques. Néanmoins, le mandat de ce chapitre est de rapprocher les volets de l’offre et de la demande en travailleurs, afin de se pencher brièvement sur ce que la prochaine décennie peut avoir en réserve pour le marché des métiers et sur la façon dont l’apprentissage s’intègre à l’ensemble des métiers sur le marché du travail.
Les projections du SPPC jouent un rôle important dans le récent rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes (2012) cité dans la revue de la littérature. Une version du tableau pertinent contenu dans ce rapport pour les métiers choisis est présentée dans l’annexe (tableau A6.1). Les résultats montrent plusieurs métiers accompagnés d’un équilibre entre l’offre et la demande au cours de la période donnée. On prévoit une grave pénurie de travailleurs dans les métiers d’électriciens, de même que des pénuries moins importantes dans divers métiers de mécaniciens et chez les machinistes. On prévoit cependant des excédents de travailleurs chez les cuisiniers, les plombiers, tuyauteurs et monteurs d'installations au gaz, les charpentiers et ébénistes, les ferronniers, le personnel de maçonnerie et de plâtrage et les autres métiers de la construction.
Il est important de remarquer que, outre les risques habituels associés aux projections, ces projections sont d’envergure nationale et ne reflètent pas les fluctuations régionales ou locales en matière d’offre et de demande. Les projections régionales sont encore moins fiables puisque les nombres sont beaucoup plus petits et que les incidences de la situation économique sont relativement plus importantes. Par exemple, les tendances régionales sont plus susceptibles de refléter l’incidence sur le marché du travail de grands projets de construction. Il est très probable que l’on remarque des pénuries et des excédents de travailleurs à l’échelle locale, compte non tenu de ce que révèle le portrait national. Les résultats présentés dans les autres volets de cette étude ont montré que les personnes de métier ne sont pas aussi mobiles que l’on pourrait croire. Cette caractéristique pourrait avoir une conséquence évidente sur l’offre et la demande en travailleurs à l’échelle régionale.
Ces projections ne révèlent rien concernant le rôle que jouent les apprentis comme source de travailleurs pour le marché du travail, parce que la catégorie des chercheurs d’emploi n’est pas divisée en sources de travailleurs. De plus, bien que ces projections abordent la question de l’offre et de la demande, elles ne fournissent pas de renseignements sur la disponibilité des travailleurs certifiés. Les importants avantages de salaire accordés aux travailleurs dans plusieurs métiers démontrent que les travailleurs certifiés sont plus recherchés que les travailleurs qui n’ont pas de certificat. Il est donc approprié d’examiner la contribution des nouveaux apprentis de même que celle des nouveaux travailleurs accrédités (apprentis et travailleurs qualifiés) afin d’obtenir un portrait représentatif de l’offre en travailleurs dans les métiers.
Le graphique 6.28 montre la projection les taux des nouvelles inscriptions aux programmes d’apprentissage et des réussites de 2000 à 2010 ainsi que des projections jusqu’à 2020 dans des métiers choisis qui correspondent le plus possible aux professions pour lesquelles il existe des projections du SPPC.Note de bas de page 55 Les projections du SPPC allant de 2012 à 2020 sont aussi fournies.
Graphique 6.28 Projection des nouvelles inscriptions à l’apprentissage, des réussites et des possibilités d’emploi dans des métiers choisis, de 2010 à 2020 [Source : SIAI/SPPC]
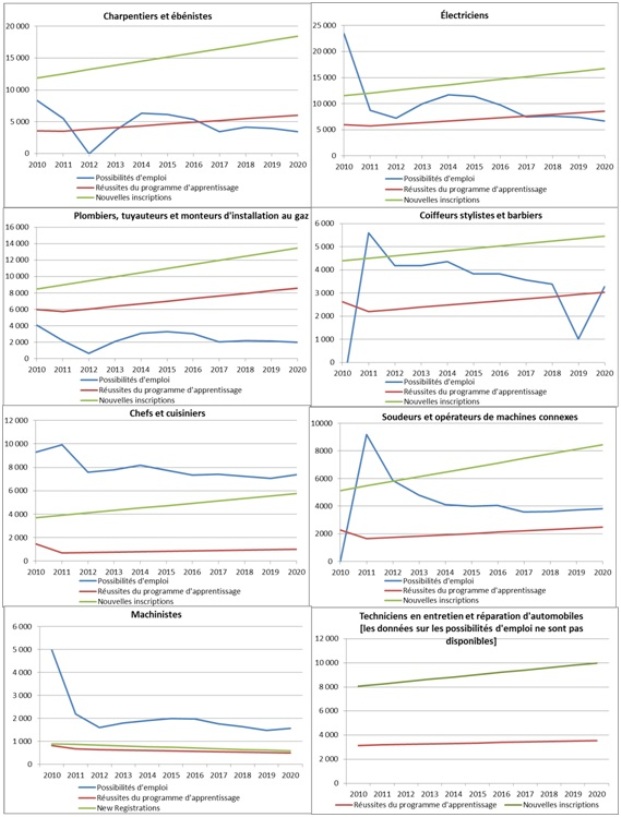
Description de l’image Graphique 6.28 Projection des nouvelles inscriptions à l’apprentissage, des réussites et des possibilités d’emploi dans des métiers choisis, de 2010 à 2020 [Source : SIAI/SPPC]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant la projection des nouvelles inscriptions à l’apprentissage, des réussites et des possibilités d’emploi pour dix métiers choisis, de 2010 à 2020. Chaque métier est représenté par son propre graphique.
Pour les métiers de charpentier et d’ébéniste, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 8 316 en 2010; 5 513 en 2011; 0 en 2012; 3 637 en 2013; 6 338 en 2014; 6 118 en 2015; 5 362 en 2016; 3 472 en 2017; 4 156 en 2018; 3 989 en 2019, et 3 469 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 3 564 en 2010 et devrait augmenter graduellement à 6 037 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 11 890 en 2010, nombre qui devrait augmenter à un rythme constant et atteindre 18 414 en 2020.
Pour le métier d’électricien, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 23 455 en 2010; 8 690 en 2011; 7 245 en 2012; 10 007 en 2013; 11 718 en 2014; 11 363 en 2015; 9 749 en 2016; 7 445 en 2017; 7 606 en 2018; 7 394 en 2019, et 6 707 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 5 955 en 2010 et devrait augmenter graduellement à 8 574 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 11 536 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 16 735 en 2020.
Pour les métiers de plombier, de tuyauteur et de monteur d’installations au gaz, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 4 073 en 2010; 2 189 en 2011; 638 en 2012; 2 107 en 2013; 3 085 en 2014; 3 307 en 2015; 3 045 en 2016; 2 014 en 2017; 2 170 en 2018; 2 134 en 2019, et 1 990 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 3 717 en 2010 et devrait augmenter graduellement à 6 220 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 8 457 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 13 454 en 2020.
Pour les métiers de coiffeur-styliste et de barbier, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 0 en 2010; 5 591 en 2011; 4 173 en 2012; 4 181 en 2013; 4 464 en 2014; 3 822 en 2015; 3 834 en 2016; 3 560 en 2017; 3 379 en 2018; 1 023 en 2019, et 3 274 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 2 634 en 2010 et devrait augmenter graduellement à 3 028 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 4 392 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 5 462 en 2020.
Pour les métiers de chef et de cuisinier, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 9 287 en 2010; 9 932 en 2011; 7 592 en 2012; 7 795 en 2013; 8 171 en 2014; 7 758 en 2015; 7 325 en 2016; 7 397 en 2017; 7 229 en 2018; 7 062 en 2019, et 7 366 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 1 464 en 2010 et devrait diminuer à 1 004 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 3 717 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 5 751 en 2020.
Pour les métiers de soudeur et d’opérateur de machines à souder et à braser, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 25 en 2010; 9 185 en 2011; 5 870 en 2012; 4 796 en 2013; 4 120 en 2014; 4 003 en 2015; 4 051 en 2016; 3 573 en 2017; 3 898 en 2018; 3 726 en 2019, et 3 805 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 2 277 en 2010 et devrait augmenter graduellement jusqu’à 2 482 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 5 127 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 8 437 en 2020.
Pour le métier de machiniste, le nombre prévu d’offres d’emploi est de 4 967 en 2010; 2 188 en 2011; 1 608 en 2012; 1 800 en 2013; 1 903 en 2014; 1 993 en 2015; 1 975 en 2016; 1 768 en 2017; 1 640 en 2018; 1 480 en 2019, et 1 562 en 2020. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 816 en 2010 et devrait diminuer graduellement pour atteindre 490 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 894 en 2010 et devrait diminuer à un rythme constant pour atteindre 585 en 2020.
Pour le métier de technicien en entretien et réparation d’automobiles, les données concernant les possibilités d’emploi ne sont pas disponibles. Le nombre prévu de réussites des programmes d’apprentissage est de 3 145 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 3 559 en 2020. Le nombre prévu de nouvelles inscriptions est de 8 060 en 2010 et devrait augmenter à un rythme constant pour atteindre 9 979 en 2020.
Ces résultats doivent être interprétés avec prudence pour plusieurs raisons. D’abord, ils ne tiennent pas compte du fait que certains apprentis sont en chômage ou ne travaillent pas dans leur champ d’études. Cette proportion ne devrait pas être très élevée chez les nouveaux inscrits puisque ce groupe devrait avoir eu un emploi pour être inscrit. De plus, les projections linéaires ne reflètent pas les variations d'une année sur l'autre, principalement durant les périodes de récession, comme l’illustre la baisse du nombre d’inscriptions en 2009 et la hausse en 2010. Dans l’ensemble, par contre, la tendance générale des inscriptions a été à la hausse. Quoi qu’il en soit, il reste à voir si le taux de croissance de la dernière décennie peut être maintenu durant la décennie prochaine. Les projections sur les finissants sont probablement plus précises que celles concernant les nouveaux inscrits, puisque la majorité des apprentis qui achèveront leur programme au cours des prochaines années seront ceux qui sont déjà inscrits à un programme. Finalement, il est nécessaire d’avoir un certain excédent de travailleurs afin de contrebalancer les limites associées à la mobilité de la main-d’œuvre et à d’autres facteurs qui contribuent au déséquilibre entre l’offre et la demande en travailleurs. Tous ces facteurs représentent des risques à la fiabilité des projections.
Pourtant, les résultats indiquent certaines tendances générales qui permettent de comprendre comment l’offre et la demande en travailleurs devraient évoluer. D’abord, l’excédent apparemment important de nouveaux inscrits pour les possibilités d’emploi dans les métiers de charpentier et d’ébéniste est lié au fait que ce secteur a connu une forte augmentation de la proportion de nouveaux inscrits, ce dont les projections tiennent compte. Dans le cas des charpentiers et ébénistes, l’écart important entre la projection des inscriptions et du nombre de finissants suggère que ce groupe professionnel continuera de compter une grande proportion de travailleurs qui n’ont pas de certificat. L’excédent projeté dans ce secteur est cohérent avec celui présenté dans le tableau A6.1.
La tendance dans les métiers de tuyauteurs est semblable à celle des charpentiers et ébénistes, et elle est aussi associée à un écart important dans le nombre d’inscriptions et d’apprentis qui réussissent dans ce secteur. Dans ce cas, l’écart entre le nombre d’inscriptions et de réussites est plus faible, et le nombre de candidats qui réussissent le programme excède le nombre de possibilités d’emplois dans le secteur pour la totalité de la période. Cette tendance est aussi cohérente avec celle illustrée dans le tableau A6.1.
La situation chez les électriciens est un peu plus équilibrée. On y observe un excédent de nouveaux inscrits, mais une pénurie de finissants pour la majorité de la période étudiée. Puisque la certification est obligatoire dans la majorité des provinces et territoires pour les métiers d’électriciens, la demande en travailleurs accrédités devrait être plus forte que dans plusieurs autres métiers. En effet, les projections du SPPC indiquent dans l’ensemble une pénurie au cours de la période étudiée. En tenant pour acquis que l’augmentation du nombre des inscriptions et des réussites continuera, l’offre en travailleurs dans les métiers d’électriciens devrait s’améliorer plus tard au cours de la décennie.
Les tendances chez les coiffeurs/barbiers et les soudeurs sont semblables. On y observe un excédent de nouveaux apprentis et une pénurie de finissants pour la majorité de la période étudiée. Par contre, à en juger par la différence des avantages salariaux offerts dans les deux groupes, la demande en finissants devrait être plus forte chez les soudeurs que les coiffeurs/barbiers. Aucun de ces deux groupes n’a été identifié dans le tableau A6.1. Le tableau indique cependant un léger excédent dans l’ensemble des métiers liés au travail du métal.
Les deux secteurs pour lesquels le graphique 6.28 montre une pénurie évidente sont ceux des chefs et des cuisiniers ainsi que des machinistes. Le métier de machiniste est aussi le seul à ne pas afficher de croissance du nombre de nouveaux apprentis ou de finissants. Le tableau A6.1 montre une faible pénurie de machinistes au cours de la période de projection. Ici encore, à en juger par l’important avantage de salaire offert aux machinistes accrédités, une pénurie de travailleurs qui ont un certificat dans ce métier semble probable.
La situation des cuisiniers et des chefs est unique. Le tableau 6.28 montre une pénurie importante de nouveaux apprentis et de finissants dans ce domaine. Par contre, le tableau A6.1 prévoit un excédent dans le secteur. Le problème sous-jacent est que très peu de travailleurs dans ce métier détiennent un certificat et que la reconnaissance professionnelle n’accorde pas ou presque pas d’avantage sur le salaire. Le scénario le plus probable pour ce métier est que les postes continueront d’être accordés à des travailleurs qui n’ont pas de certificat, et que l’apprentissage ne jouera qu’un petit rôle sur le marché du travail dans ce secteur.
Durant la majorité de la période, on a observé chez les coiffeurs/barbiers un excédent de nouveaux apprentis et une pénurie de finissants. C’est dans ce secteur que l’on enregistre déjà la plus grande proportion de travailleurs certifiés parmi tous les métiers. Il est possible que l’on atteigne un point de saturation du nombre de travailleurs accrédités. La période d’apprentissage est habituellement courte dans ce métier (en général deux ans), et le nombre d’heures de travail nécessaire pour réussir le programme est plus faible que dans la majorité des autres métiers. Puisqu’il n’y a pratiquement aucun avantage de salaire associé à la reconnaissance professionnelle, il est difficile de prétendre que la demande en travailleurs accrédités est beaucoup plus forte que celle en travailleurs qui n’ont pas de reconnaissance.
6.6 Facteurs macroéconomiques liés à l’emploi dans les métiers et aux inscriptions à l’apprentissage
Le nombre de travailleurs embauchés dans les métiers et le nombre d’apprentis inscrits qui terminent leur programme sont probablement influencés par plusieurs variables au niveau macroéconomique associées à la situation économique dans son ensemble. Comme dans les chapitres précédents, ces effets ont été examinés grâce à des analyses de régression. À cette fin, un fichier de données a été compilé en fonction des valeurs annuelles pour un certain nombre de facteurs au niveau macro-économique comme variables indépendantes, du nombre d’inscriptions à l’apprentissage et du niveau d’emploi des travailleurs accrédités comme résultats. On avait accès à des données couvrant une période de 22 ans, soit de 1990 à 2010, ce qui représente 22 « cas » dans le fichier. Bien qu’il s’agisse d’un petit nombre de cas et que les données soient très cumulatives, il a été jugé utilise de recourir un modèle de régression pour chacune des variables dépendantes.
Plus particulièrement, les variables de résultat/variables dépendantes étaient :
- le nombre annuel de travailleurs embauchés qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel ;
- le nombre annuel d’inscriptions aux programmes d’apprentissage.
La première variable est considérée comme une mesure de la demande et la deuxième de l’offre.
Pour le nombre d’employés, les variables indépendantes étaient :
- taux horaire de salaire moyen dans les métiers ;
- indice des prix à la consommation ;
- part du PIB générée par la construction ;
- récession (code 1 pour une année de récession, autrement code 0) ;
- nombre de finissants avec un certificat d’apprentissage ou professionnel ;
- durée (en année, avec les codes 1 à 22).
Pour les inscriptions à l’apprentissage, les variables indépendantes étaient :
- taux horaire de salaire moyen dans les métiers ;
- taux de chômage moyen dans les métiers ;
- récession ;
- durée.
Dans les deux cas, le modèle représentait environ 98 % de la variance des résultats. En revanche, par exemple, les modèles du revenu d’emploi des chapitres 4 et 5 représentaient environ 25 % de la variance, ce qui est beaucoup plus fréquent, puisqu’il est impossible d’intégrer à un seul modèle tous les facteurs qui pourraient être liés à des résultats sur le plan professionnel.
De tels résultats indiquent habituellement qu’il y a une forte corrélation entre les différentes variables indépendantes ainsi qu’avec les résultats. Un examen de la matrice de corrélation parmi les variables indépendantes ainsi que les indices de « colinéarité » créés par le programme informatique ont confirmé que c’était bel et bien le cas. En effet, toutes les variables du modèle représentent des « approximations » de la croissance économique (ou l’opposé dans le cas de la variable de la récession). Elles sont donc des mesures du même phénomène sous-jacent. On doit ajouter à cette difficulté le fait que, avec seulement 22 cas à analyser, le niveau d’erreur associé aux coefficients du modèle était assez élevé, ce qui rendait les coefficients observés très instables. Finalement, ce type de résultat est commun lors de l’utilisation de données macroéconomiques, étant donné la forte agrégation de données.
En raison de ces limites, les détails des modèles ne sont pas présentés ici. Les résultats des modèles sont présentés en annexe aux tableaux A6.2 et A6.3. Dans le respect de ces limites, les modèles suggèrent tout de même que l’emploi dans les métiers et les inscriptions à l’apprentissage sont directement proportionnels à la croissance économique et inversement proportionnels à la récession. Ces données sont cohérentes avec les résultats précédents qui indiquaient que les inscriptions à l’apprentissage et l’emploi dans les métiers avaient baissé durant la récession en 2009, alors qu’ils avaient été en croissance durant l’ensemble de la période de croissance économique de 2000 à 2010. Ces données montrent aussi que les projections présentées plus tôt devraient être fortement influencées par la conjoncture économique qui sera en place durant le reste de cette décennie.
Par rapport à la demande, le nombre de réussites des programmes était aussi significatif, ce qui appuie l’hypothèse selon laquelle des taux de réussite stables pourraient être associés à la stabilité du rythme (environ 11 %) auquel les Canadiens reçoivent un certificat d’apprentissage ou professionnel. Quant à l’offre, les programmes incitatifs gouvernementaux et la croissance de la main-d’œuvre spécialisée ont aussi été jugés significatifs. Il pourrait donc s’agir d’une explication potentielle de la croissance du nombre d’inscriptions à des programmes d’apprentissage au Canada.
6.7 Résumé et conclusions
6.7.1 Les métiers dans le contexte de l’ensemble de la main-d’œuvre
- Il n’y a pas une définition normalisée de ce que représentent les métiers. Selon les définitions plus générales, qui incluent certains métiers où l’on retrouve peu ou pas d’apprentis, les métiers représentent environ 17 % de la population active. Selon la définition plus pointue de « principaux » métiers d’apprentissage, les métiers représentent environ 11 % de la population active. Après avoir connu une légère baisse au cours des années 1990, ces pourcentages ont été stables durant la dernière décennie.
- Les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel affichent un meilleur taux de participation au marché du travail, un meilleur taux d’emploi et un taux de chômage inférieur à celui des travailleurs ayant une éducation secondaire ou moins. Mais les travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel affichent une moins bonne participation au marché du travail, un moins bon taux d’emploi et un taux de chômage plus élevé que les travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
- Les taux de chômage dans les métiers ont affiché une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, à l’exception de la période de récession de 2009.
6.7.2 La demande
- Environ 11 % des travailleurs détiennent une certaine forme de certificat d’apprentissage ou professionnel. Ce pourcentage a été stable au cours de la dernière décennie, après avoir connu une légère baisse dans les années 1990. La proportion des travailleurs dans les dix principaux métiers, par rapport à la main-d’œuvre totale, a connu un léger déclin durant une période de 20 ans.
- Environ le tiers des travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel pratique un métier. Cette proportion a augmenté légèrement au cours des dernières années.
- Environ 35 % des personnes de métier ont un certificat d’apprentissage ou professionnel. Ce pourcentage a augmenté un peu au cours des dernières années.
- La proportion de travailleurs qui ont un certificat tend à être plus élevée dans les dix métiers principaux, où la moyenne est d’environ 40 %. On observe cependant d’importantes variations entre les différents métiers, de 68 % chez les coiffeurs à 13 % chez les cuisiniers.
- Près de 15 % des personnes de métier n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires. Cette proportion a chuté de façon importante au cours des 20 dernières années. Les taux de reconnaissance professionnelle affichent d’importantes variations entre les provinces/territoires, de 25 % à Terre-Neuve-et-Labrador à 6,2 % en Ontario. Les tendances temporelles varient aussi entre les provinces/territoires. Certaines sont à la hausse alors que d’autres sont à la baisse.
- Les certificats d’apprentissage et professionnels sont distribués de façon assez égale entre les différents groupes d’âge.
- Dans l’ensemble de la population active, moins de femmes que d’hommes détiennent un certificat d’apprentissage ou professionnel, mais plus de femmes que d’hommes ont un diplôme collégial ou universitaire.
- Les femmes sont concentrées dans un petit nombre de métiers, surtout ceux de coiffeur et de cuisinier. La proportion de femmes augmente lentement. Les femmes étaient très peu représentées dans les dix principaux métiers, mais leur proportion augmente plus rapidement dans les autres métiers.
- Chez les immigrants, on compte une moins grande proportion de travailleurs qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel et une plus grande proportion de travailleurs qui ont un diplôme collégial ou universitaire par rapport aux travailleurs nés au Canada.
- La proportion de personnes qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel est un peu plus élevée chez les personnes d’identité autochtone que chez le reste de la population. On compte aussi chez les personnes d’identité autochtone une plus grande proportion de travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Dans ce groupe, la proportion de personnes qui ont un diplôme universitaire est encore plus petite. Également, les personnes d’identité autochtone sont aussi plus susceptibles de travailler dans les métiers que le reste de la population.
6.7.3 L’offre : sources de personnes de métier
- Les inscriptions à l’apprentissage ont beaucoup augmenté par rapport à l’ensemble du marché du travail dans les métiers au cours de la dernière décennie. Cette hausse est particulièrement prononcée dans les métiers de tuyauteurs, d’électriciens et de charpentiers, mais elle est très inférieure à la moyenne chez les cuisiniers.
- Une tendance semblable est observée par rapport à la réussite des programmes d’apprentissage, où la croissance la plus rapide a été observée au cours des dernières années, en tenant compte de l’écart entre la hausse des inscriptions et la réussite.
- Les inscriptions à l’apprentissage ont beaucoup augmenté par rapport aux inscriptions aux programmes de niveau postsecondaire. Toutefois, les taux de réussite ont varié beaucoup plus. Un faible déclin avait été observé dans les années 1990, suivi d’une période de stabilité, puis d’une hausse au cours des dernières années.
- Les variations dans le nombre d’inscriptions sont aussi évidentes entre les différentes provinces. En Alberta et au Québec, les inscriptions ont augmenté à un rythme plus rapide qu’ailleurs. La province de Terre-Neuve-et-Labrador est la seule où l’on a observé une importante augmentation du nombre d’inscriptions par rapport à la population active au début des années 2000, suivie d’une baisse presque aussi importante vers la fin de cette même décennie.
- Le taux de croissance des inscriptions par rapport au marché du travail est plus fort chez les femmes que chez les hommes. Le taux de réussite est cependant le même chez les deux sexes.
- Les nouveaux immigrants sont moins susceptibles de détenir un certificat d’apprentissage ou professionnel que les personnes nées au Canada ou les immigrants établis.
- Les travailleurs autochtones sont plus susceptibles de détenir un certificat d’apprentis ou professionnel que le reste de la population active. On compte aussi chez les personnes d’identité autochtone une plus grande proportion d’individus qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires, et une proportion encore plus petite de personnes qui ont un diplôme universitaire. Aussi, les personnes d’identité autochtone sont plus susceptibles que le reste de la population de travailler dans les métiers.
6.7.4 Projections sur l’offre et la demande
Des projections par rapport à l’offre et la demande à l’échelle nationale sont présentées. Elles sont fondées sur le modèle du SPPC et sur des prévisions du nombre d’inscriptions et de réussites jusqu’en 2020. Il est important de savoir qu’il ne s’agit pas d’une analyse complète. Puisqu’elle est limitée à quelques grands métiers, elle ne tient pas compte des variations régionales et locales, et elle ne prend pas en considération des employeurs particuliers ou des exigences professionnelles particulières. Par contre, l’analyse offre un portrait général de la façon dont la réussite des programmes d’apprentissage s’intègre à l’offre générale en travailleurs. Ces projections visent à réunir les aspects de l’offre et de la demande associés aux métiers et à l’apprentissage.
Les résultats de la projection sont variables. On remarque un surplus de travailleurs chez les charpentiers et ébénistes ainsi que chez les tuyauteurs. Ce surplus est lié au fait que ces secteurs ont connu une importante augmentation de la proportion du nombre de nouveaux inscrits. La situation des électriciens est un peu plus équilibrée. On remarque un surplus de nouveaux inscrits, mais une pénurie de finissants pour la majorité de la période. On observe aussi un excédent de nouveaux apprentis chez les soudeurs, ainsi qu’une pénurie de finissants pour la majorité de la période. L’important avantage de salaire accordé aux soudeurs qui ont un certificat indique que la demande dans ce secteur est principalement orientée vers les travailleurs qui ont une reconnaissance professionnelle. Durant la même période, on a observé une pénurie de machinistes, et on ne prévoit pas de croissance du nombre de nouveaux apprentis ou finissants. Ici encore, étant donné l’important avantage de salaire accordé aux machinistes qui ont une reconnaissance professionnelle, il est probable que l’on observe dans ce métier une pénurie de travailleurs accrédités.
La situation des chefs et des cuisiniers est unique. Les projections montrent une pénurie importante de nouveaux apprentis et de finissants. Par contre, les projections du SPPC mêmes indiquent un excédent dans ce secteur. Très peu de travailleurs dans ce métier ont une reconnaissance professionnelle, et on offre très peu ou pas davantage salarial à ces travailleurs.
Au cours de la majorité de la période, on a enregistré un excédent de nouveaux apprentis chez les coiffeurs et une pénurie de finissants. Par contre, étant donné que les travailleurs qui ont une reconnaissance professionnelle ne reçoivent pratiquement aucun avantage de salaire, et que la proportion de travailleurs accrédités dans ce secteur est plus grande que dans tout autre métier, il est difficile de prétendre que la demande en travailleurs accrédités est beaucoup plus élevée que la demande en travailleurs qui n’ont pas de certificat.
6.7.5 Conclusions
Les résultats présentés dans ce chapitre appuient les conclusions suivantes :
- les métiers représentent une proportion assez importante de l’ensemble du marché du travail, allant d’environ 11 % à 17 %, selon les professions que l’on définit comme métier ;
- l’importance des métiers par rapport à l’ensemble du marché du travail est demeurée relativement stable au cours de la dernière décennie, malgré la multitude de définitions des métiers que l’on peut utiliser ;
- la proportion de personnes qui travaillent dans les métiers et ont une reconnaissance professionnelle est aussi demeurée stable ;
- il n’existe pas de façon de déterminer avec précision la proportion d’apprentis travaillant dans des métiers qui correspondent au programme d’apprentissage qu’ils ont suivi. Par contre, en tenant pour acquis que cette proportion est relativement élevée, ou du moins constante, les apprentis représentent une proportion croissante du marché du travail dans les métiers, puisque le nombre d’apprentis augmente beaucoup plus rapidement que la population active ;
- on peut dire la même chose des finissants des programmes d’apprentissage et des travailleurs qui ont récemment reçu la reconnaissance professionnelle. Bien que le nombre annuel de nouveaux finissants ne représente qu’une petite proportion des personnes de métier, leur nombre augmente, et on prévoit qu’il continue d’augmenter à mesure que les apprentis qui se sont inscrits à leur programme dernièrement compléteront leur formation ;
- bien que cette étude ne permette pas de déterminer de façon claire s’il y a une pénurie de personnes de métier, les projections indiquent que la réussite de l’apprentissage devrait être suffisante pour répondre à la demande dans certains métiers, si l’on tient pour acquis que la majorité des apprentis qui réussissent leur programme trouveront un travail dans leur métier. Il s’agit d’une hypothèse qui ne peut être évaluée de façon adéquate avec les données accessibles. Ce raisonnement s’applique aussi à l’échelle nationale, mais pas nécessairement à l’échelle régionale ou locale. Par contre, l’étude suggère que, dans certains secteurs, la question de pénurie de travailleurs qualifiés pourrait représenter un problème davantage local que national, et davantage lié à la mobilité qu’au nombre de travailleurs ;
- finalement, l’EPA et le Recensement risquent de sous-représenter l’importance et la contribution des Canadiens qui ont de l’expérience en apprentissage ou dans les métiers puisqu’ils n’identifient pas les travailleurs qui n’ont pas de certificat, mais qui ont suivi une formation dans les métiers ou un programme d’apprentissage dans des emplois connexes. Ces études n’identifient pas non plus les individus qui ont un certificat d’apprentissage ou professionnel en plus de titres de compétences associés à l’enseignement supérieur. Afin de comprendre la contribution complète de ces individus, les prochaines enquêtes devraient recueillir des renseignements plus détaillés sur les liens entre la formation et la profession.
Bibliographie du chapitre 6
Forum canadien sur l'apprentissage (2009). Évaluation des résultats des programmes d'apprentissage : Établir le bien-fondé de la poursuite et de la réussite d'un programme d'apprentissage. Ottawa : Auteur
Notes
- Note de bas de page 45
-
Statistique Canada ne considère pas les apprentis comme des étudiants de niveau postsecondaire, mais tient un compte séparé des inscriptions à l’apprentissage et des réussites des programmes d’apprentissage grâce au SIAI. Par contre, il est approprié de considérer les apprentis comme des étudiants de la perspective de la demande, puisque les apprentis se trouvent essentiellement dans le même bassin de jeunes.
- Note de bas de page 46
-
Des détails sur tous ces programmes sont présentés sur le site Web du Sceau rouge à l’adresse suivante : http://www.sceau-rouge.ca/c.4nt.2nt@-fra.jsp?cid=24.
- Note de bas de page 47
-
La CNP-S fait référence à la Classification nationale des professions pour statistiques de Statistique Canada, utilisée dans le Recensement et dans l’EPA. Cette classification comprend dix désignations principales en chiffre, dont chacune est associée à un code de trois chiffres. La CNP-4 fait référence aux codes de quatre chiffres de la Classification nationale des professions pour les professions individuelles et qui sont utilisées dans le SIAI.
- Note de bas de page 48
-
Les individus qui ont un certificat professionnel ou d’apprenti ne travaillent pas nécessairement dans les métiers. Comme l’ont démontré d’autres résultats présentés dans ce rapport, plusieurs des personnes qui travaillent dans ces professions n’ont pas ces titres de compétences, et plusieurs des personnes qui ont un certificat d’apprenti ou professionnel ne travaillaient pas dans les métiers. De plus, ni le Recensement ni l’EPA ne sont en mesure de déterminer le nombre d’individus qui ont un certificat d’apprenti ou professionnel en plus d’autres titres de compétences.
- Note de bas de page 49
-
L’EPA ne fait pas de distinction entre les individus qui ont un certificat d’apprenti inscrit et ceux qui ont d’autres types de certificats professionnels. Par contre, le Recensement de 2006 indique qu’environ la moitié des personnes qui ont un certificat d’une école de métier l’ont obtenu par l’entremise de programmes d’apprentis inscrits.
- Note de bas de page 50
-
Encore une fois, il est important de souligner que la majorité des résultats présentés dans cette partie sont fondés sur des titres de compétence, et non sur des professions. Ces données ne devraient pas être jugées représentatives des individus qui travaillent réellement dans les métiers.
- Note de bas de page 51
-
Les renseignements sur les immigrants dans l’EPA remontent à 2006.
- Note de bas de page 52
-
Les métiers présentés ici sont un peu différents de ceux des autres parties de ce rapport, parce que le CANSIM utilise une catégorie de « métiers principaux » plutôt que les codes individuels de la CNP comme ceux utilisés dans l’EPA. Puisque la correspondance n’est pas parfaite pour certains métiers, il est important de se concentrer sur les tendances temporelles plutôt que sur les données précises.
- Note de bas de page 53
-
Dans le calcul de ces ratios, les inscriptions dans tous les métiers représentaient le numérateur, et la main-d’œuvre, définie comme CNP-S, de même que quelques autres métiers d’autres catégories de la CNP représentaient le dénominateur. Ce calcul amène à des ratios inférieurs à ceux des dix principaux métiers, mais il n’influence pas les tendances temporelles.
- Note de bas de page 54
-
Il est important de se rappeler qu’en moyenne, les apprentis sont plus âgés, au moment de leur inscription, que la plupart des étudiants de niveau postsecondaires, au moment de leur inscription initiale, et que certains apprentis auraient au moins déjà entrepris certaines études de niveau postsecondaire.
- Note de bas de page 55
-
Il est impossible de fournir une répartition complète des dix principaux métiers ou des autres métiers parce que les catégories de projections du SPPC ne correspondent pas directement aux codes de la CNP-4 du SIAI.
- Date modified:

