3.0 Définition des résultats, descriptions et données comparatives
3.1 Introduction
3.1.1 Objectif
L’objectif principal de ce chapitre est de définir un ensemble de résultats appropriés pour les métiers, de trouver des mesures et des sources de données pour ces résultats, comparer les résultats des finissants, des personnes ayant partiellement terminé leur programme et de celles ayant abandonné, par métier et par province/territoire. Plus précisément, les objectifs du chapitre sont les suivants :
- déterminer un ensemble normalisé de résultats liés à l’éducation, à la formation et au marché du travail, ainsi qu’un ensemble de résultats sociodémographiques ;
- concevoir des indicateurs pour ces résultats, avec un accent tout particulier sur les indicateurs de réussite d’un programme d’apprenti ;
- trouver des sources de données pour ces indicateurs ;
- comparer les résultats entre les finissants, les personnes ayant partiellement terminé leur programme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés ;
- comparer les résultats des divers métiers et des provinces et territoires ;
- examiner les avantages qu’apporte la mention Sceau rouge.
3.1.2 Contexte : définition et classification des résultats
Un résultat peut être défini comme tout élément découlant d’un événement d’intérêt et ayant des liens plausibles avec cet évènement. Dans cette étude, les événements initiaux sont l’inscription en tant qu'apprenti ou, pour certains aspects, la reconnaissance professionnelle en tant que travailleur qualifié ou l’entrée dans les métiers par l’entremise d’un autre parcours. Idéalement, il devrait y avoir un lien de causalité. C’est-à-dire que l’élément ne devrait pas seulement découler de l’événement, mais il devrait également être déterminé uniquement en vertu de celui-ci. Un excellent exemple est la réussite d’un programme d’apprenti qui doit suivre l’inscription et qui n’aurait pas lieu sans celle-ci. Or, plusieurs résultats d’intérêts sont plutôt considérés comme des liens corrélationnels. Par exemple, le revenu annuel au cours de l’année suivant la réussite peut être lié à la réussite, mais il peut également être lié à plusieurs autres facteurs.
Certaines méthodes analytiques, plus particulièrement des analyses de régression multiple, peuvent aider à déterminer la contribution relative de divers facteurs aux résultats et, dans le cas présent, aider à séparer les incidences d’éléments liés à l’apprentissage (comme le fait de réussir ou non) des facteurs externes comme l’âge et le sexe. De tels modèles seront dorénavant utilisés dans ce rapport. Cette section se limite à une relation à deux variables entre le statut d’apprenti et les résultats, avec des ventilations par province/territoire, ainsi que par métier, le cas échéant. Par exemple, la relation entre la réussite d’un programme d’apprenti et le revenu annuel peut être étudiée dans l’ensemble du Canada, par province/territoire et par groupe précis de métiers.
Aux fins de la présente étude, une variable est considérée comme un résultat uniquement si l’on peut démontrer qu’elle peut être perçue comme une mesure de la réussite, ou de l’échec, d’un programme d’apprenti. La réussite ou l’échec est un exemple de variable nominale (dichotomique), soit une mesure évidente du succès. Le revenu, que l’on peut mesurer de maintes manières comme nous le démontrerons sous peu, peut être considéré comme une mesure continue du succès aussi longtemps que nous jugeons qu’un salaire élevé témoigne d’un grand succès. Bien qu’il soit possible de débattre de cette dernière hypothèse, il est généralement assez bien accepté que des revenus plus élevés sont des indicateurs d’un grand succès.
Grâce à l’énoncé initial des objectifs pour cette composante, deux types généraux de résultats furent établis : les résultats sur le marché du travail et les résultats sociaux. Les chercheurs y ont ajouté une troisième catégorie : les résultats en matière de formation. Cette dernière catégorie permet à la réussite et autres facteurs connexes comme la reconnaissance professionnelle, la poursuite à long terme des études et la qualification professionnelle d’être considérés comme des résultats immédiats de l’apprentissage. Selon cette approche, l’inscription à un programme d’apprenti, ou plus généralement l’entrée sur le marché des métiers, est le point de départ des analyses. Tous les résultats subséquents sont qualifiés de résultats. Cette approche reconnaît ceux qui entament une carrière dans les métiers par l’entremise d’un parcours autre que l’apprentissage et, plus particulièrement, offre une analyse du parcours de travailleurs qualifiés menant à la reconnaissance professionnelle.
Sur le plan conceptuel, le modèle peut être représenté par le diagramme qui suit. Les parcours directs à partir des points de départ jusqu’aux résultats à long terme visent à démontrer que ces résultats ne sont pas nécessairement liés à la réussite ou à la reconnaissance professionnelle. En effet, les différences entre les résultats à long terme chez les finissants/titulaires de certificats et les personnes qui ne sont ni finissants et qui ne détiennent pas de certificats représentent l’un des principaux points d’intérêts de cette étude. La flèche bidirectionnelle entre les résultats sur le marché du travail et les résultats sociodémographiques vise à souligner que l’un ne dépend pas forcément de l’autre.
Points de départ Résultats en matière de formation Résultats à long terme
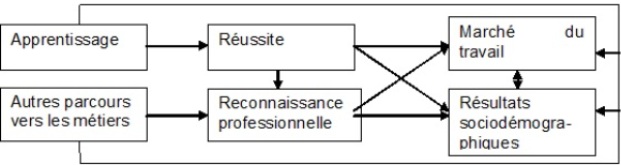
Description de l’image of Points de départ Résultats en matière de formation Résultats à long terme
Il s’agit d’un organigramme illustrant les parcours des points de départ jusqu’aux résultats à long terme. Il y a trois catégories principales : les points de départ, les résultats en matière de formation et les résultats à long terme. Chaque catégorie contient deux groupes. Les deux points de départ sont l’apprentissage et les autres parcours vers les métiers; les deux résultats en matière de formation sont la réussite et la reconnaissance professionnelle, et les deux résultats à long terme sont le marché du travail et les résultats sociodémographiques.
L’apprentissage mène à la réussite, soit un résultat en matière de formation, ainsi qu’au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, c’est-à-dire les deux résultats à long terme.
Les autres parcours vers les métiers mènent à la reconnaissance professionnelle, soit un résultat en matière de formation, ainsi qu’au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, c’est-à-dire les deux résultats à long terme.
Les deux résultats en matière de formation, la réussite et la reconnaissance professionnelle, mènent au marché du travail et aux résultats sociodémographiques, soit les deux résultats à long terme.
Pour tous ces résultats, il est nécessaire d’élaborer des définitions opérationnelles pouvant être exprimées en termes mesurables. Par exemple, « revenu » est un indicateur évident de résultats sur le marché du travail. Malgré tout, le revenu peut être mesuré à l’aide d’une multitude de méthodes, entre autres à l’aide des gains horaires, des gains annuels, des gains tirés d’un emploi et des gains d’emploi autonome. Des choix doivent donc être faits parmi les résultats afin de réduire la complexité des analyses et le chevauchement des résultats. La section suivante présente les mesures utilisées dans ce rapport.
3.1.3 Questions de recherche
Les questions de recherche dans ce chapitre découlent directement des objectifs mentionnés dans la section 3.1.1.
- De tous les résultats possibles en matière d’apprentissage et de formation dans les métiers, lesquels devraient faire l’objet d’une analyse détaillée?
- Quels indicateurs de ces résultats sont disponibles dans les sources de données? Comment sont-ils définis d'un point de vue opérationnel dans ces sources?
- En quoi ces résultats varient-ils parmi tous les métiers et au sein des provinces et territoires?
- Avoir la mention Sceau rouge est-il un atout? Si oui, quel est cet atout?
3.1.4 Résultats en matière de formation
Les deux résultats en matière d’apprentissage les plus évidents sont la réussite et la reconnaissance professionnelle, comme le démontre le modèle ci-dessus. Bien qu’au premier coup d’œil ces deux résultats semblent former une seule variable (c.-à-d., la reconnaissance professionnelle suit immédiatement la réussite pour la plupart des apprentis) ils doivent être traités indépendamment dans certaines parties de l’analyse. Par exemple, grâce à l’ENA de 2007, nous avons découvert que certains participants répondaient à toutes les exigences d’un programme d’apprenti sans avoir toutefois entrepris les dernières démarches menant à la reconnaissance professionnelle. Ce groupe de personnes comprend celles qui ne se sont pas présentées à l’examen menant à la reconnaissance professionnelle ou celles qui n’ont pas réussi cet examen. De plus, la reconnaissance professionnelle peut également être atteinte par l’entremise de la qualification professionnelle. Il ne faut pas non plus oublier la réussite partielle et, plus particulièrement, la poursuite à long terme d’un programme d’apprenti. Cette dernière situation peut être considérée comme un résultat, voir même un résultat positif, pour les personnes ayant acquis le niveau de compétences requis pour leur emploi actuel et pour qui la reconnaissance professionnelle n’est pas une exigence ou un objectif.
Plus particulièrement, les résultats en matière de formation sont généralement regroupés ainsi :
- réussite
- reconnaissance professionnelle
- après avoir terminé un programme d’apprenti
- avec ou sans la mention Sceau rouge
- après avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle
- avec ou sans la mention Sceau rouge
- après avoir terminé un programme d’apprenti
- réussite partielle (poursuite d’un programme)
- normal (respecter ou presque la durée nominale prévue du programme)
- long terme (bien plus que la durée nominale prévue – dans un délai spécifique)
- décrochage
Ces groupes se retrouvent dans la base de données du SIAI et peuvent être examinés directement en tant que résultats en matière d’apprentissage. Ils sont également liés aux résultats sur le marché du travail par l’entremise de la base de données conjointe du SIAI/FFT1. Ces données nous permettent d’utiliser les résultats en matière de formation comme point de départ pour l’analyse des résultats sur le marché du travail. Notre capacité à lier ces groupes aux résultats sociodémographiques est restreinte, car le SIAI ne fournit que très peu de données sur ce dernier type de résultat. De plus, un grand nombre de données ne sont pas disponibles pour certaines des variables.
3.1.5 Résultats sur le marché du travail
Grâce aux sources de données disponibles, il est possible de répartir les résultats sur le marché du travail en fonction des groupes détaillés suivants :
- participation au marché du travail
- participation
- emploi
- chômage
- revenu
- revenu total
- revenu tiré d’un emploi
- revenu d’emploi autonome
- recours à l’assurance-emploi
- autre revenu (p. ex., soutien du revenu, revenu sous forme de transferts gouvernementaux, revenu de placement)
- mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre
- vers l’extérieur (province/territoire fournissant la main-d’œuvre)
- vers l’intérieur (province/territoire accueillant la main-d’œuvre)
Ce ne sont pas toutes ces variables qui seront examinées en détail dans cette étude. Par exemple, puisque les taux d’emploi et les taux de chômage sont étroitement corrélés, et ce, de manière négative, l’étude se penche principalement sur les taux de chômage. De plus, le revenu total pour la plupart des gens de métiers est le résultat de gains tirés d’un emploi, de gains d’emploi autonome et de prestations d’assurance-emploi. Peu ont recours à d’autres sources de revenus, et c’est pourquoi l’étude met l’accent sur ces trois premières sources et non sur les autres.
Les mesures de certaines de ces variables sont disponibles dans plus d’une source. Chacune de ces sources présente de légères différences quant à la manière dont le résultat est mesuré et les sous-groupes possibles. Par exemple, le Recensement de 2006 fournit une mesure ponctuelle du revenu annuel total. Cette mesure facilite une répartition par niveau de scolarité, avec des groupes distincts pour ceux ayant un certificat d’apprenti inscrit et d’autres types de certificats dans les métiers. En revanche, l’Enquête sur la population active ne fournit que les salaires horaires et les salaires hebdomadaires, sans distinguer entre les certificats d’apprenti et autres types de certificats dans les métiers. Elle offre par contre des données chronologiques qui permettent d’effectuer un suivi des revenus sur une période de plus de 20 ans pour les groupes d’intérêts
Le fichier du SIAI/FFT1 offre une répartition du revenu selon plusieurs sources. Il permet également d’effectuer un suivi chronologique, mais uniquement pour les participants du SIAI pour une année donnée, et non pas pour l’ensemble de la population active. Les données ne peuvent donc être comparées à celles du Recensement ou de l’EPA, mais elles peuvent être utiles pour effectuer une comparaison des divers groupes définis. En effet, ce fichier apporte une contribution unique à nos connaissances du marché du travail grâce aux précisions apportées par les données de l'impôt sur le revenu par rapport aux données auto déclarées des autres sources.
3.1.6 Résultats sociodémographiques
Cette catégorie vise à bien illustrer les divers résultats liés à l’engagement social, aux attitudes et aux tendances démographiques découlant d’une participation à un programme d’apprenti. Bien que cela puisse inclure nombre de variables, notre examen dans ce domaine se limite à celles incluses dans les sources de données disponibles. D’autres sources, dont l’Enquête sociale générale, furent consultées brièvement, mais certains facteurs, entre autres un accès restreint, un temps limité et l’absence d’un lien clair avec l’apprentissage, nous empêchèrent d’utiliser ces ressources.
Les variables furent examinées en fonction des groupes suivants :
- attitudes
- satisfaction à l’égard de l’expérience en tant qu’apprenti (ENA)
- satisfaction au travail
- données démographiques (participation des groupes cibles sélectionnés)
- dans les programmes d’apprenti
- dans la main-d’œuvre des métiers
3.1.7 Sources de données
Les données de ce chapitre proviennent des sources de données du premier chapitre. Les sources principales furent l’ENA de 2007 et les fichiers couplés du SIAI/FFT1/BDIM. Certains résultats furent également tirés du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM), une base de données qui comprend des statistiques sommaires des niveaux de scolarité et des résultats sur le marché du travail par profession.
3.2 Éducation et résultats en matière de formation
3.2.1 Niveaux de scolarité de la population active
Avant d’examiner plus en détail les résultats découlant de la réussite et de la reconnaissance professionnelle, il est intéressant de s’attarder brièvement aux tendances relatives au niveau de scolarité, plus particulièrement aux certificats d'une école de métiers, dans l’ensemble de la population active. Le graphique 3.1 présente les résultats des séries chronologiques de l’Enquête sur la population active. Il démontre que le nombre de travailleurs salariés sans baccalauréat, certificat ou diplôme décline de plus en plus au fil du temps, tandis que le pourcentage de travailleurs salariés détenant un certificat d’une école de métiers demeure semblablement le même, soit environ 12 % de la population active. Pendant cette même période, le pourcentage de travailleurs titulaires d’un certificat, d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un baccalauréat a augmenté. Le déclin du nombre de personnes sans certificat est donc contrebalancé par l’augmentation du nombre de personnes titulaires de certificats d’études collégiales ou universitaires. Le nombre de personnes détenant un certificat d’une école de métiers n’influence en rien la donne.
Graphique 3.1 Pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du niveau de scolarité, de 1990 à 2011[Source : EPA]
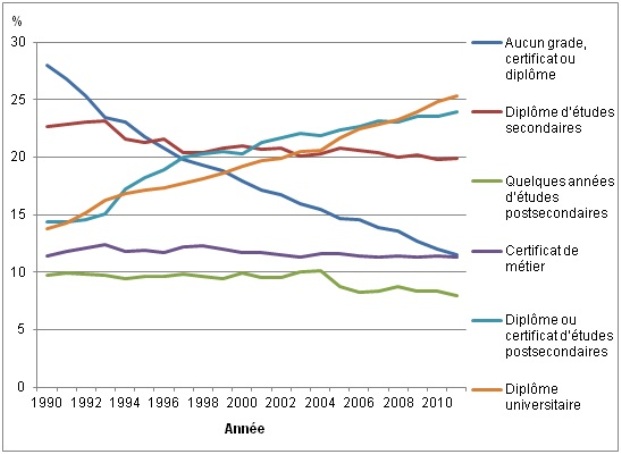
Description de l’image Graphique 3.1 Pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du niveau de scolarité, de 1990 à 2011[Source : EPA]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de la population totale ayant un emploi en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint. Les années couvertes par le graphique vont de 1990 à 2011. Il y a six catégories dans ce graphique multilignes : aucun grade, certificat ou diplôme; diplôme d’études secondaires; quelques années d’études postsecondaires; certificat de métier; diplôme ou certificat d’études postsecondaires, et diplôme universitaire.
Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme était de 28,0 % en 1990. Cette proportion a graduellement diminué de 1990 à 2000 pour atteindre 18,0 % en 2000. La proportion a continué de diminuer entre 2000 et 2011. Le pourcentage était de 17,1 % en 2001; 16,7 % en 2002; 16, 0 % en 2003; 15,4 % en 2004; 14,7 % en 2005; 14,6 % en 2006; 13,9 % en 2007; 13,6 % en 2008; 12,7 % en 2009; 12,0 % en 2010; et 11,6 % en 2011.
Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires était stable à environ 23 % de 1990 à 1993. La proportion a commencé à diminuer en 1994 pour atteindre 21,6 %, et a continué de diminuer pour atteindre un taux d’environ 20 % en 2003. Le pourcentage est resté stable à environ 20 % de 2003 à 2011.
Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient quelques années d’études postsecondaires était constant à tout juste moins de 10 % de 1990 à 2004. La proportion a diminué de 2004 à 2011; de 10,1 % en 2004 à 8,0 % en 2011. Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de personnes qui ont un certificat de métier était de 11,4 % en 1990. Le taux est demeuré stable à environ 12 % de 1990 à 2011, alors que le taux était de 11,3 %.
Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui avaient un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires était de 14,4 % en 1990, et il a augmenté à 17,3 % en 1994. La proportion a continué d’augmenter de 1994 à 2005 pour atteindre un taux de 22,4 %. Le pourcentage était de 22,7 % en 2006; 23,2 % en 2007; 23,0 % en 2008; 23,5 % en 2009; 23,5 % en 2010, et 24,0 % en 2011. Parmi la population totale ayant un emploi, le pourcentage de travailleurs qui ont un diplôme universitaire a augmenté de façon constante de 1991 à 2011; passant de 13,8 % en 1990 à 25,3 % en 2011.
L’Enquête sur la population active ne fait pas de distinction entre les travailleurs titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit et ceux détenant un autre type de certificats dans les métiers (comme ceux remis par un collège ou une école de métiers). Cette distinction peut être faite à l’aide du Recensement de 2006, comme le démontre le tableau 3.2. Les travailleurs dans les métiers sont séparés de ceux dans les autres professions, ce qui nous permet ainsi d’observer qu’en 2005, environ 17 % des travailleurs dans les métiers avait un certificat d’apprenti inscrit et qu’un nombre égal avait un autre type de certificat dans les métiers. Une ventilation plus complète des métiers révèle qu’environ 40 % des travailleurs ont tout au plus un diplôme d’études secondaires, et que 27 % sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires. Puisque le Recensement ne tient compte que du plus haut niveau de scolarité atteint, il est impossible de déterminer combien de personnes au sein de ce dernier groupe (études collégiales ou universitaires) sont également titulaires d’un certificat d’une école de métiers ou d’un certificat d’apprenti.
Graphique 3.2 Niveau de scolarité : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]
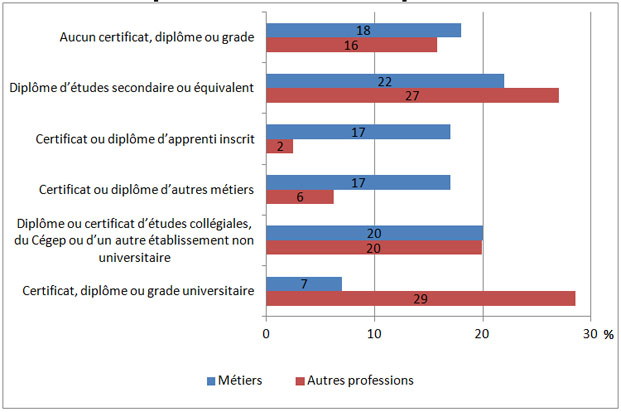
Description de l’image Graphique 3.2 Niveau de scolarité : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un diagramme à barres horizontales illustrant le plus haut niveau d’éducation atteint par les travailleurs dans les métiers et d’autres professions à partir des données du recensement de 2006. Il y a deux catégories : les métiers et les autres professions.
Parmi les travailleurs des métiers, 18 % n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme; 22 % avaient un diplôme d’études secondaire ou l’équivalent; 17 % avaient un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 17 % avaient un certificat ou un diplôme d’un autre métier; 20 % avaient un diplôme ou certificat d’études collégiales, du Cégep ou d’un autre établissement non universitaire, et 7 % avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.
Parmi les travailleurs dans l’ensemble des autres professions, 16 % n’avaient aucun grade, certificat ou diplôme; 27 % avaient un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 2 % avaient un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 6 % avaient un certificat ou un diplôme d’un autre métier; 20 % avaient un diplôme ou certificat d’études collégiales, et 29 % avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire.
3.2.2 Réussite
Le graphique 2.1 de la page 35 témoigne d’une hausse rapide du nombre total d’inscriptions, de nouvelles inscriptions et de finissants au cours des quelques dernières années. On observe un délai entre le moment de l’inscription et la réussite puisque les programmes d’apprenti sont généralement d’une durée de deux à cinq ans (la plupart sont de quatre). Le nombre de finissants dans une année donnée ne devrait donc pas être comparé directement au nombre total d’inscriptions pour cette même année, car le nombre total d’apprentis au sein du système est toujours plus important que le nombre d’apprentis susceptibles de réussir, et ce, encore plus particulièrement quand les inscriptions annuelles ne cessent de croître. Une autre approche plus conventionnelle utilisée pour analyser les finissants, soit comparer le nombre de finissants au nombre d’inscriptions d’une année précédente précise (p. ex., quatre ans plus tôt), n’est pas non plus une méthode adéquate, car plusieurs apprentis mettent plus de temps à poursuivre le programme que la période nominale prévue. Les finissants d’une année donnée peuvent s’être inscrits à tout moment lors des années précédentes. Il est à noter que les cohortes des premières années étaient beaucoup plus petites.
La meilleure méthode pour analyser les taux de réussite consiste à faire le suivi de chaque individu au fil des ans, de leur inscription à leur réussite. Cette méthode nous permet de calculer directement les taux de réussite pour chaque année d’inscription et toute année subséquente. Il s’agit essentiellement de la méthode utilisée par Statistique Canada (Desjardins et Paquin, 2010 ; Morissette, 2008 ; et Prasil, 2005) dans le cadre d’une série d’études de cohortes réalisées à l’aide de données de la SIAI sur les années d’inscription. En pratique, la méthode fut quelque peu compromise par le manque de données sur certaines années d’inscriptions dans des provinces et territoires. Par exemple, le rapport de Sandril (2005) se basa uniquement sur les résultats de trois provinces. La plus récente étude de Desjardins et Paquin (2010) utilisa les données recueillies auprès de six provinces. Somme toute, ces études démontrèrent que près de la moitié des apprentis dans une cohorte annuelle complètent leur programme dans l’espace de dix ans, et que peu demeurent dans le système après cette période.
Dans le cadre de sa toute dernière étude, Statistique Canada s’est penché sur les taux de réussite des cohortes de 1994 et 1995. Afin d’être en mesure de fournir des résultats un peu plus à jour, nous avons également ciblé les cohortes d’entrées de 1994 à 2003, effectuant un suivi de leurs progrès jusqu’en 2009, la dernière année couverte par le SIAI. Il fut nécessaire d’avoir recours à une très longue période de données afin de tenir compte du nombre d’apprentis qui demeurent dans le programme plus longtemps que la durée nominale prévue. Pour ses études de cohortes, Statistique Canada utilisa des prévisions détaillées sur dix ans, ce que nous avons également fait par souci de cohérence. Nous avons aussi présenté les taux de réussite sur six ans, car nous pouvons ainsi inclure les plus récentes cohortes. De plus, cette période est la limite jugée acceptable pour la poursuite à long terme d’un programme dans le chapitre 5 de ce rapport.
Une fois de plus, les résultats ne sont fournis que pour six provinces, comme ce fut le cas avec la plus récente étude des cohortes de Statistique Canada. Les chiffres présentés pour chacune de ces provinces sont donc exacts, représentant la cohorte entière pour chaque année d’inscription. Une fois la moyenne provinciale calculée, les résultats devraient être assez représentatifs du taux national de réussite puisque ces six provinces comptent à elles seules plus de 90 % des apprentis. Les taux de réussite pourraient toutefois être différents dans les provinces et territoires non inclus.
Le graphique 3.3 présente les résultats pour les années d’inscriptions de 1994 à 2003 Note de bas de page 11 sous forme de pourcentage de réussite, sur des périodes de six et dix ans suivant l’inscription. Les taux sur dix ans en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario étaient à la baisse, passant d’une moyenne de 50 % à une moyenne de près de 40 % au début des années 2000. Les taux se stabilisèrent ensuite à ce niveau de 2000 à 2003. La tendance au Manitoba était sensiblement la même, avec un taux plus élevé (de 65 % à environ 54 %), et de plus grandes fluctuations, sans doute en raison du plus petit nombre d’apprentis. Le Québec enregistra une amélioration avec un faible taux de près de 20 % dans les années 1990 qui passa à 30 % au cours des dernières années. Finalement, le Nouveau-Brunswick enregistra aussi des améliorations, passant d’environ 45 % à 50 %, avec quelques fluctuations en raison de son petit nombre d’apprentis.
Graphique 3.3 Pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003, dans six provinces [Source : SIAI]
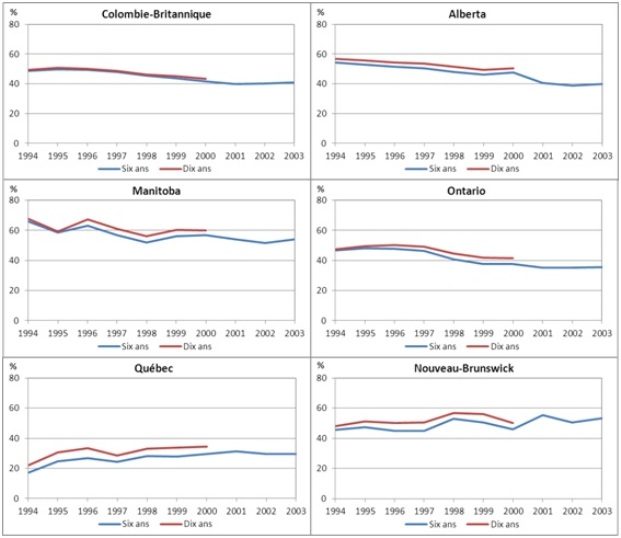
Description de l’image Graphique 3.3 Pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003, dans six provinces [Source : SIAI]
Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le pourcentage de réussite en 2009 pour les cohortes de 1994 à 2003. Les données de six provinces sont présentées : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Chaque province est présentée dans un graphique distinct et une ligne illustre le pourcentage de réussite après six ans et une autre ligne illustre le pourcentage de réussite après dix ans. Les années couvertes par les graphiques vont de 1994 à 2003.
En Colombie-Britannique, les taux de réussite après six ans et après dix ans de la cohorte de 1994 étaient environ au même niveau, soit 49 %. Les taux de réussite ont diminué de façon constante pour chaque cohorte subséquente jusqu’à la cohorte de 2000, année pour laquelle le taux de réussite après six ans était de 41,47 % et celui après dix ans était de 43,36 %. Pour les cohortes de 2000 à 2003, il n’y a que des données pour le pourcentage de réussite six ans après l’inscription. Le taux est constant à tout juste plus de 40 % pour les cohortes de 2000 à 2003.
En Alberta, le taux de réussite après six ans était de 54 % et celui après dix ans était de 57 % pour la cohorte de 1994. Les deux taux de réussite ont diminué de manière constante pour chaque cohorte subséquente jusqu’à la cohorte de 1999, qui a connu un taux de réussite après six ans de 46,26 % et un taux de réussite après dix ans de 49,39 %. Pour les cohortes de 2000 à 2003, il n’y a que les données pour le taux de réussite de six ans après l’inscription. Le taux de réussite après six ans a diminué pour atteindre 40,49 % en 2001 et il est ensuite demeuré constant pour les cohortes de 2001 et 2002, à environ 39 %.
Au Manitoba, les taux de réussite après six ans et après dix ans de la cohorte de 1994 étaient environ au même niveau, soit 66 %. Les taux ont diminué à environ 59 % en 1995. En 1996, les pourcentages ont augmenté à environ 63 % pour ce qui est du taux de réussite après six ans et à environ 67 % pour celui après dix ans. Les pourcentages ont ensuite diminué de manière constante jusqu’en 1998, année où le taux de réussite après six ans était d’environ 52 % et où celui après dix ans étaient de 56 %. Pour la cohorte de 1999, environ 56 % ont terminé leur apprentissage après six ans et 60 % l’ont terminé après dix ans. De 2000 à 2003, le taux de réussite après dix ans a diminué pour atteindre environ 54 %.
Au Nouveau-Brunswick, le taux de réussite après six ans était d’environ 46 % et celui après dix ans était de 48 % pour la cohorte de 1994. L’écart entre les deux taux s’est légèrement accentué de 1994 à 1997, alors que les taux de réussite après six ans et après dix ans atteignaient respectivement environ 45 % et 50 %. Le taux de réussite après six ans a augmenté à environ 53 %, et celui après dix ans à 57 % en 1998. En 2000, les taux de réussite après six ans et après dix ans ont ensuite diminué à environ 46 % et 50 %, respectivement. Pour la cohorte de 2001, le taux de réussite après 10 ans est de 55 %. Pour la cohorte de 2002, le taux de réussite après dix ans est de 50,50 %. Pour la cohorte de 2003, le taux de réussite après dix ans est de 53,29 %.
Au Québec, l’écart entre les deux taux est demeuré constant de 1994 à 2000. Pour la cohorte de 1994, 17 % ont terminé leur apprentissage après six ans et 22 % l’ont terminé après dix ans. En 1996, le taux de réussite après six ans augmente à environ 27 % et celui après dix ans augmente à 33 %. En 1997, les taux de réussite après six ans et dix ans diminuent respectivement à 24 % et 29 %. En 2000, les taux de réussite après six ans et dix ans augmentent de façon constante à environ 30 % et 35 %, respectivement. Le taux de réussite après six ans est demeuré constant à environ 30 % pour les cohortes de 2000 à 2003.
En Ontario, pour la cohorte de 1994, les taux de réussite après six ans et dix ans étaient d’environ 46 %. Les taux sont demeurés constants jusqu’en 1997, année où le taux de réussite après six ans était d’environ 46 % et celui après dix ans était d’environ 49 %. En 2000, les taux de réussite après six ans et après dix ans ont respectivement diminué à environ 38 % et à 42 %. Le taux de réussite après six ans est demeuré constant à environ 35 % de 2000 à 2003.
3.2.3 Reconnaissance professionnelle des apprentis
Le nombre de certificats remis à l’échelle nationale a déjà été donné (graphique 2.1, page 35). Cette section offre une répartition des certificats remis aux apprentis par province/territoire et par métier. Dans le système du SIAI, le nombre d’apprentis recevant un certificat chaque année est essentiellement le même que le nombre de finissants.Note de bas de page 12 Les taux de réussite sont donc directement liés au nombre de certificats. Puisque le nombre de certificats remis est une donnée disponible dans toutes les régions et que le nombre de finissants témoigne d’une variation absolue et non relative, sans délai, il est utile d’analyser ces chiffres par province/territoire et par métier.Note de bas de page 13
Le graphique 3.4 présente une répartition des certificats d’apprentis par province/territoire. La période ne couvre que les années 2000 à 2010 afin de simplifier les graphiques. Les chiffres actuels, et par conséquent les échelles graphiques, variant considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, l’accent est principalement mis sur la tendance au fil du temps.
En général, les tendances provinciales et territoriales sont semblables aux tendances nationales du graphique 2.1. L’importante augmentation du nombre de certificats observée au cours des dernières années est particulièrement évidente dans certains territoires et certaines provinces. Les seules exceptions sont le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où l’augmentation fut plus lente et plus stable. La Colombie-Britannique est unique, car elle seule a enregistré un léger déclin au début de la décennie, suivi d’une augmentation plus importante qu’à l’habitude lors des années suivantes.
Graphique 3.4 Certificats remis à des apprentis selon les provinces/territoires, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]
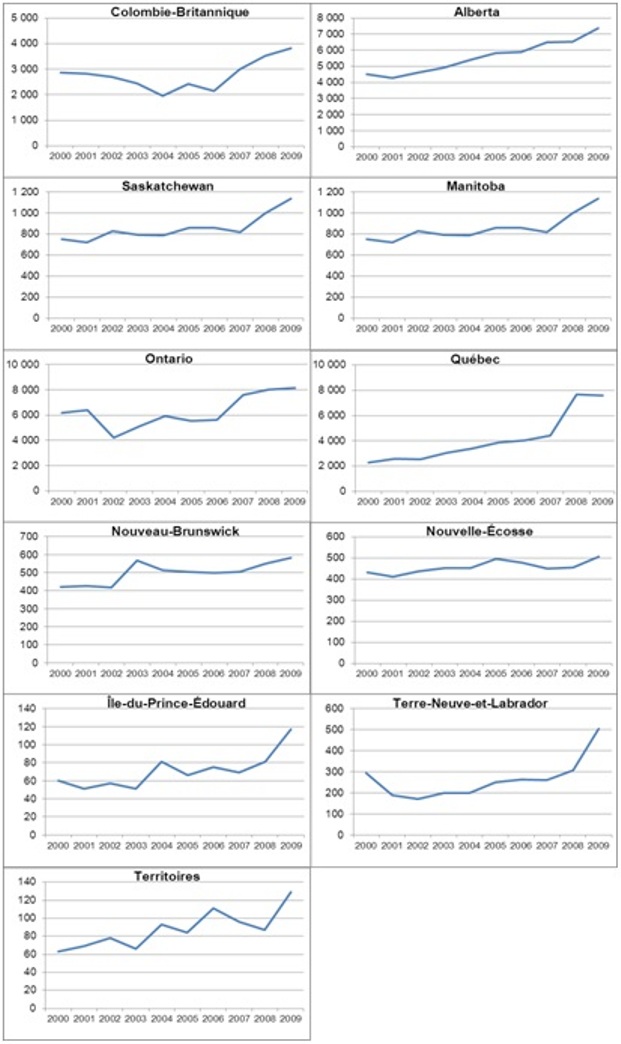
Description de l’image Graphique 3.4 Certificats remis à des apprentis selon les provinces/territoires, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]
Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le nombre de certificats remis à des apprentis selon la province ou le territoire. Les années couvertes par les graphiques vont de 2000 à 2010. Les données de 11 provinces sont présentées : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires. Chaque province et territoire est présenté dans un graphique linéaire simple distinct et illustre le nombre de certificats remis dans l’axe des y et l’année dans l’axe des x.
Le nombre de certificats remis aux apprentis en Colombie-Britannique était de 2 862 en 2000, puis il a diminué graduellement à 1944 en 2004. Il y a eu une petite augmentation pour atteindre 2 427 en 2005, et elle a été suivie par une diminution à 2 148 en 2006. Le nombre a ensuite augmenté à un rythme constant pour atteindre environ 3 819 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis en Alberta était de 4 509 en 2000 et il a augmenté de manière constante pour atteindre environ 7 365 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis en Saskatchewan a été plutôt constant à environ 800 de 2000 à 2007, et il y a ensuite eu une rapide augmentation, de 2007 à 2009, pour atteindre environ 1 137 certificats remis.
Le nombre de certificats remis aux apprentis au Manitoba a augmenté de 540 en 2000 à 813 en 2004. Ce nombre a ensuite diminué à 744 en 2005, pour ensuite augmenter de manière constante pour atteindre 984 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis en Ontario était de 6 189 en 2000; 6 375 en 2001; 4 194 en 2002; 5 091 en 2003; 5 931 en 2004; 5 526 en 2005; 5 619 en 2006; 7 575 en 2007; 8 001 en 2008, et 8 163 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis au Québec a augmenté de façon constante, passant de 2 286 en 2000 à 4 410 en 2007. Ce nombre a ensuite augmenté à 7 656 en 2008, et il a ensuite légèrement diminué à 7 578 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis au Nouveau-Brunswick était stable à environ 420 de 2000 à 2002, pour ensuite augmenter à 567 en 2003. Ce nombre a ensuite diminué à 513 en 2004, et il est demeuré stable jusqu’en 2007. Le nombre a augmenté à 549 en 2008, et à 582 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis en Nouvelle-Écosse était de 432 en 2000; 411 en 2001; 438 en 2002; 453 en 2003; 453 en 2004; 498 en 2005; 480 en 2006; 450 en 2007; 456 en 2008, et 507 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis à l’Île-du-Prince-Édouard était de 60 en 2000; 51 en 2001; 57 en 2002; 51 en 2003; 81 en 2004; 66 en 2005; 75 en 2006; 69 en 2007; 81 en 2008, et 117 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis à Terre-Neuve-et-Labrador était de 294 en 2000; 189 en 2001; 171 en 2002; 198 en 2003; 198 en 2004; 249 en 2005; 264 en 2006; 261 en 2007; 306 en 2008, et 504 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis dans les Territoires était de 63 en 2000; 69 en 2001; 78 en 2002; 66 en 2003; 93 en 2004; 84 en 2005; 111 en 2006; 96 en 2007; 87 en 2008, et 129 en 2009.
Le graphique 3.5 présente une répartition des dix métiers les plus importants. Il révèle d’importantes différences parmi les métiers. Voici certains des points saillants de ces résultats :
- le nombre de certificats d’apprenti pour les métiers d’électricien, de charpentier et de plombier/tuyauteur/monteur de conduites de vapeur a connu une croissance considérable et régulière au cours de la période observée ;
- le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de véhicules automobiles et de mécanicien de chantier a augmenté lentement pendant la plupart de la période observée ;
- le nombre de certificats pour les métiers de mécanicien de matériel lourd et de coiffeur-styliste/esthéticien a chuté au début de la décennie, puis a augmenté au cours des dernières années ;
- le nombre de certificats pour le métier de soudeur fut relativement stable au début de la décennie pour ensuite augmenter considérablement à partir de 2006 ;
- le métier de machiniste fut le seul à ne connaitre que des chutes pendant la période observée.
Graphique 3.5 Certificats remis à des apprentis selon le métier, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]
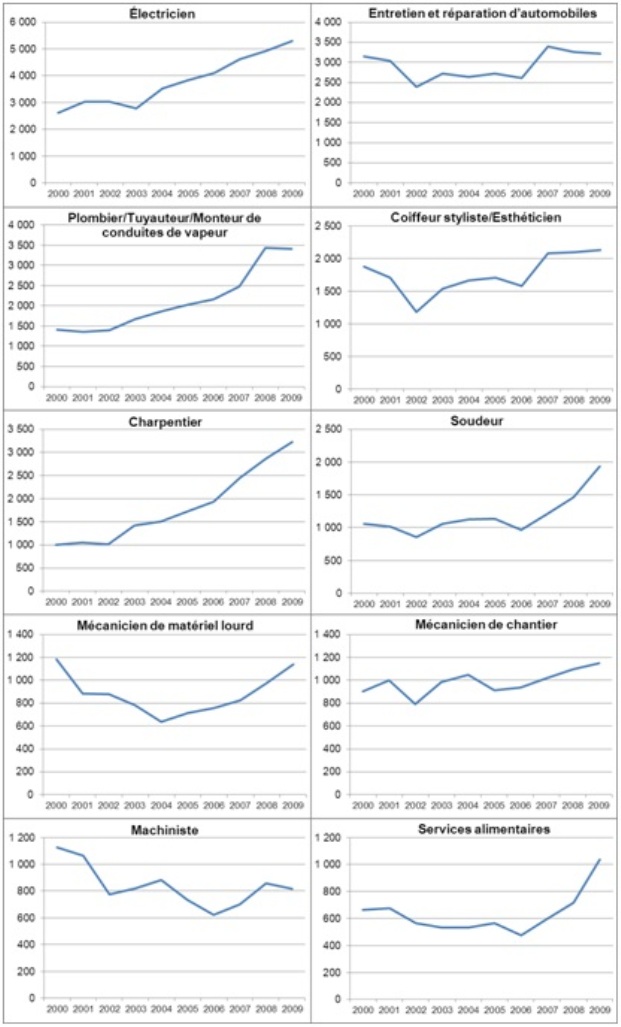
Description de l’image Graphique 3.5 Certificats remis à des apprentis selon le métier, de 2000 à 2010 [Source : Tableau CANSIM]
Il s’agit de graphiques illustrant le nombre de certificats remis aux apprentis selon le métier. Les années couvertes par les graphiques vont de 2000 à 2010. Dix métiers sont présentés : électricien; technicien en entretien et réparation d’automobiles; plombier, tuyauteur et monteur de conduites de vapeur; coiffeur-styliste et esthéticien; charpentier; soudeur; mécanicien de matériel lourd; mécanicien de chantier; machiniste, et services alimentaires. Chaque métier est présenté dans un graphique linéaire simple distinct.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier d’électricien était de 2 625 en 2000; 3 021 en 2001; 3 030 en 2002; 2 781 en 2003; 3 522 en 2004; 3 834 en 2005; 4 113 en 2006; 4 626 en 2007; 4 923 en 2008, et 5 292 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de technicien en entretien et réparation d’automobiles était de 3 153 en 2000; 3 036 en 2001; 2 394 en 2002; 2 721 en 2003; 2 640 en 2004; 2 727 en 2005; 2 613 en 2006; 3 396 en 2007; 3 258 en 2008, et 3 219 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de plombier, tuyauteur et monteur de conduites de vapeur était de 1 416 en 2000; 1 353 en 2001; 1 395 en 2002; 1 674 en 2003; 1 863 en 2004; 2 031 en 2005; 2 169 en 2006; 2 484 en 2007; 3 435 en 2008, et 3 414 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de coiffeur-styliste et esthéticien était de 1 878 en 2000; 1 707 en 2001; 1 185 en 2002; 1 539 en 2003; 1 665 en 2004; 1 707 en 2005; 1 581 en 2006; 2 088 en 2007; 2 103 en 2008, et 2139 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de charpentier était de 1 008 en 2000; 1 056 en 2001; 1 017 en 2002; 1 419 en 2003; 1 509 en 2004; 1 725 en 2005; 1 938 en 2006; 2 454 en 2007; 2 871 en 2008, et 3 222 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de soudeur était de 1 056 en 2000; 1 020 en 2001; 852 en 2002; 1 056 en 2003; 1 128 en 2004; 1 131 en 2005; 966 en 2006; 1 209 en 2007; 1 461 en 2008, et 1 938 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de mécanicien de matériel lourd était de 1 182 en 2000; 885 en 2001; 879 en 2002; 780 en 2003; 636 en 2004; 717 en 2005; 756 en 2006; 828 en 2007; 978 en 2008, et 1 140 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de mécanicien de chantier était de 903 en 2000; 1 002 en 2001; 792 en 2002; 987 en 2003; 1 050 en 2004; 915 en 2005; 936 en 2006; 1 020 en 2007; 1 098 en 2008, et 1 149 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier de machiniste était de 1 128 en 2000; 1 065 en 2001; 777 en 2002; 819 en 2003; 882 en 2004; 732 en 2005; 621 en 2006; 699 en 2007; 858 en 2008, et 816 en 2009.
Le nombre de certificats remis aux apprentis du métier des services alimentaires était de 663 en 2000; 675 en 2001; 564 en 2002; 534 en 2003; 534 en 2004; 567 en 2005; 474 en 2006; 597 en 2007; 717 en 2008, et 1 035 en 2009.
3.2.4 Poursuite d’un programme et décrochage
Ceux qui ne terminent pas leur programme au cours de la période allouée doivent le poursuivre ou décrocher. Tout comme avec les finissants, il est possible d’effectuer le suivi des persévérants et des décrocheurs grâce au SIAI. Plutôt que d’effectuer le suivi de ces trois groupes pour toutes les années depuis 1991, ils furent étudiés à partir de deux cohortes, soit celles de 2000 et 2003, jusqu’en 2009, la dernière année couverte par le SIAI. Nous avons pu dresser un portrait sur six et dix ans depuis leur année d’inscription.
Les résultats des six provinces disposant de données pour les années d’inscription sont présentés dans le graphique 3.6. Les graphiques sont comparables entre les provinces d’une cohorte, mais pas entre les deux cohortes. Néanmoins, cette dernière comparaison peut être considérée comme un indicateur approximatif des changements de situation entre la période de six ans et celle de dix ans.
Les pourcentages de réussite sont les mêmes que ceux du graphique 3.3 pour les mêmes années. Le taux de personnes poursuivant des études était relativement faible après six et dix ans dans quatre provinces, mais il était un peu plus élevé en Ontario et au Québec. En Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, plus de 50 % des apprentis avaient décroché après six ans. Il y avait bien peu de changements à ce pourcentage pour la cohorte de 2000 après dix ans. En Ontario et au Québec, les taux de poursuite d’un programme affichaient un net déclin de six à dix ans, les apprentis passant à la réussite ou au décrochage. La raison pouvant expliquer la baisse du taux de réussite au Nouveau-Brunswick après dix ans est qu’il ne s’agissait pas des mêmes cohortes.
Graphique 3.6 Pourcentage de réussite, de persévérance et de décrochage dans six provinces, cohortes de 2000 et 2003, jusqu’en 2009 [Source : SIAI]
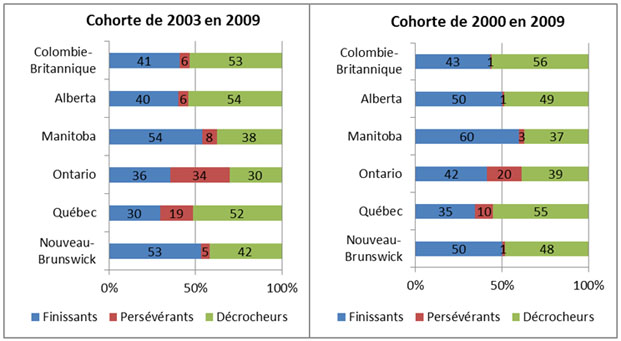
Description de l’image Graphique 3.6 Pourcentage de réussite, de persévérance et de décrochage dans six provinces, cohortes de 2000 et 2003, jusqu’en 2009 [Source : SIAI]
Il s’agit de diagrammes en barres cumulatifs illustrant les pourcentages de réussite, de persévérance et de décrochage pour les cohortes de 2000 et 2003, en 2009, dans les six provinces suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Il y a deux graphiques distincts, chaque cohorte a son propre graphique, et au sein de chaque graphique, il y a une barre pour chaque province totalisant 100 % des finissants, des persévérants et des décrocheurs.
En Colombie-Britannique, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 41 % étaient des finissants; 6 % étaient des persévérants, et 53 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 43 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 56 % étaient des décrocheurs.
En Alberta, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 40 % étaient des finissants; 6 % étaient des persévérants et 54 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 50 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 49 % étaient des décrocheurs.
Au Manitoba, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 54 % étaient des finissants; 8 % étaient des persévérants et 38 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 60 % étaient des finissants; 3 % étaient des persévérants, et 37 % étaient des décrocheurs.
En Ontario, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 36 % étaient des finissants; 34 % étaient des persévérants et 30 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 42 % étaient des finissants; 20 % étaient des persévérants, et 39 % étaient des décrocheurs.
Au Québec, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 30 % étaient des finissants; 19 % étaient des persévérants, et 52 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 35 % étaient des finissants; 10 % étaient des persévérants, et 55 % étaient des décrocheurs.
Au Nouveau-Brunswick, pour ce qui est de la cohorte de 2003 en 2009 : 53 % étaient des finissants; 5 % étaient des persévérants, et 42 % étaient des décrocheurs. Pour ce qui est de la cohorte de 2000 en 2009 : 50 % étaient des finissants; 1 % étaient des persévérants, et 48 % étaient des décrocheurs.
3.3 Résultats sur le marché du travail
3.3.1 Aperçu : métiers et professions non liées aux métiers
Les résultats sur le marché du travail retenus pour cette étude furent conçus pour représenter la participation à la population active et le revenu. La mobilité interprovinciale est également considérée comme un résultat, car l’un des principaux objectifs du Programme du Sceau rouge est de faciliter une telle mobilité. Chacun de ces types de résultat peut être mesuré de maintes façons. Par exemple, la participation au marché du travail peut être mesurée en fonction des taux d’emploi et de chômage, de la durée de la période de chômage et des périodes de retrait de la population active. Semblablement, il existe également plusieurs façons de mesurer le revenu. Les dossiers d'impôt qui sont inclus dans les fichiers couplés fournissent un revenu annuel à partir de plusieurs sources, y compris les gains tirés d’un emploi, d’emploi autonome, de prestations d’assurance-emploi et autres sources.
Les sources de données utilisées dans le cadre de ce rapport comportent d’importantes limites. Les niveaux de scolarité et les titres de compétences étant définis différemment dans les diverses bases de données, il est impossible de déterminer avec précision le parcours emprunté par les travailleurs pour entamer une carrière dans les métiers. Le SIAI englobe uniquement les apprentis et les travailleurs qualifiés d’une année donnée et ne fournit pas le nombre total de travailleurs ayant emprunté un parcours différent afin de travailler dans les métiers. De plus, les professions ne sont pas toujours définies avec cohérence en raison des différents niveaux d'agrégation et puisque les codes à quatre chiffres de la CNP ne sont pas disponibles pour toutes les sources de données. Néanmoins, il est possible de dresser un portrait assez complet des résultats comparatifs sur le marché du travail en consultant plusieurs sources.
On se penche tout d’abord sur la participation à la population active. L’indicateur précis utilisé est le taux de chômage. Le graphique 3.7 présente un aperçu des taux de chômage pour les principaux groupes de métiersNote de bas de page 14 et pour d’autres professions, de 2001 à 2011. Ce graphique permet de démontrer que le taux de chômage dans les métiers a été légèrement plus important que dans d’autres professions, atteignant une hausse supérieure à celle enregistrée dans les autres professions lors de la récession de 2009. Au sein des métiers, le chômage a toujours été plus élevé dans le secteur de la construction, nul doute en raison de la nature saisonnière des emplois. Dans le secteur des t la construction qui afficha le plus haut sommet en 2009, après avoir connu une baisse pendant quelques années. Les métiers de machiniste et de tôlier affichèrent également une importante augmentation du chômage en 2009, mais celle-ci fut contrebalancée par une baisse toute aussi importante en 2010 et 2011. C’est chez les métiers liés à la mécanique que le taux de chômage est généralement le plus faible et que les répercussions de la récession sont les moindres.
Graphique 3.7 Taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions, de 2001 à 2011 [Source : EPA]
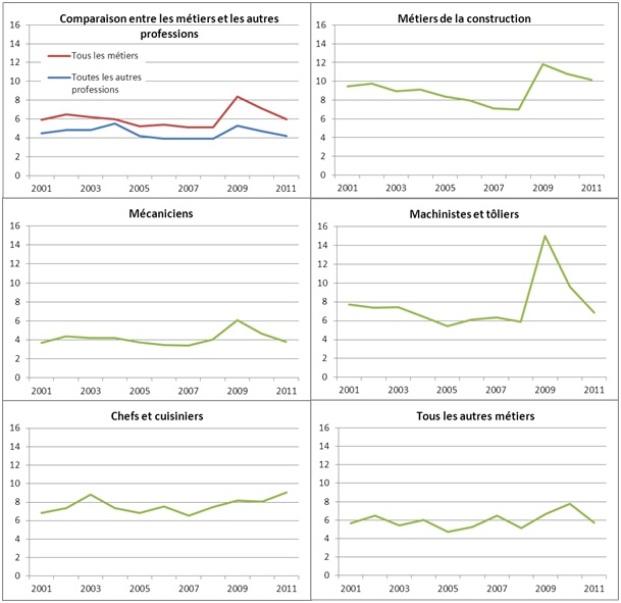
Description de l’image Graphique 3.7 Taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions, de 2001 à 2011 [Source : EPA]
Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant les taux de chômage pour des groupes de métiers choisis et d’autres professions. Les années couvertes par les graphiques vont de 2001 à 2011. Chaque groupe de métiers choisis est présenté dans un graphique distinct, et un graphique compare « tous les métiers » aux « autres professions ».
Le taux de chômage pour tous les métiers était de 5,9 % en 2001; 6,5 % en 2002; 6,2 % en 2003; 6,0 % en 2004; 5,2 % en 2005; 5,4 % en 2006; 5,1 % en 2007; 5,1 % en 2008; 8,4 % en 2009; 7,1 % en 2010, et 6,0 % en 2011.
Le taux de chômage pour toutes les autres professions était de 4,5 % en 2001; 4,8 % en 2002; 4,8 % en 2003; 5,5 % en 2004; 4,2 % en 2005; 3,9 % en 2006; 3,9 % en 2007; 3,9 % en 2008; 5,3 % en 2009; 4,7 % en 2010, et 4,2 % en 2011.
Le taux de chômage pour le groupe des métiers de la construction était de 9,5 % en 2001; 9,7 % en 2002; 8,9 % en 2003; 9,1 % en 2004; 8,4 % en 2005; 8,0 % en 2006; 7,1 % en 2007; 7,0 % en 2008; 11,8 % en 2009; 10,8 % en 2010, et 10,1 % en 2011.
Le taux de chômage pour le groupe des mécaniciens était de 7,8 % en 2001; 7,4 % en 2002; 7,4 % en 2003; 6,5 % en 2004; 5,4 % en 2005; 6,1 % en 2006; 6,3 % en 2007; 5,9 % en 2008; 15,0 % en 2009; 9,6 % en 2010, et 6,9 % en 2011.
Le taux de chômage pour le groupe des machinistes et tôliers était de 3,7 % en 2001; 4,4 % en 2002; 4,2 % en 2003; 4,2 % en 2004; 3,7 % en 2005; 3,5 % en 2006; 3,4 % en 2007; 4,0 % en 2008; 6,1 % en 2009; 4,7 % en 2010, et 3,8 % en 2011.
Le taux de chômage pour le groupe des chefs et cuisiniers était de 6,8 % en 2001; 7,3 % en 2002; 8,8 % en 2003; 7,4 % en 2004; 6,8 % en 2005; 7,5 % en 2006; 6,6 % en 2007; 7,5 % en 2008; 8,2 % en 2009; 8,1 % en 2010, et 9,1 % en 2011.
Le taux de chômage pour tous les autres métiers était de 5,7 % en 2001; 6,5 % en 2002; 5,4 % en 2003; 6,0 % en 2004; 4,7 % en 2005; 5,2 % en 2006; 6,5 % en 2007; 5,1 % en 2008; 6,7 % en 2009; 7,8 % en 2010, et 5,7 % en 2011.
Le Recensement de 2006 fournit de plus amples renseignements sur les résultats du marché du travail liés au niveau de scolarité. Des études menées par Boothy et Drewes (2010) et Gunderson et Krashinsky (2012) indiquent que les travailleurs détenant un certificat d’apprentissage touchent des avantages plus intéressants sur le plan du revenu que ceux n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires. Généralement, les avantages sont beaucoup plus intéressants chez les hommes que chez les femmes, mais le cas inverse est observé au sein de métiers traditionnellement dominés par les hommes. Somme toute, cet écart de revenu lié au sexe est principalement attribuable au fait que des femmes sont concentrées au sein de quelques métiers à faible revenu.
Dans ce rapport, nous optons pour une approche légèrement différente en comparant les revenus de ceux œuvrant dans les métiers à ceux œuvrant dans d’autres professions, mais ayant atteint le même niveau de scolarité. Nous cherchons donc à comparer les revenus des gens de métiers avec les revenus découlant d’autres professions à tous les niveaux de scolarité plutôt qu’à comparer les revenus des gens de métiers en fonction des différents niveaux de scolarité.
Le graphique 3.8Note de bas de page 15 affiche le revenu médian annuel pour les métiers et les professions en fonction des différents niveaux de scolarité, en s’appuyant sur les données du Recensement de 2006. Ces données démontrent qu’à tous les niveaux de scolarité inférieurs au baccalauréat, les personnes de métiers touchent un revenu médian plus important. Les résultats indiquent également que le revenu des personnes n’œuvrant pas dans les métiers augmente généralement en fonction de leur niveau de scolarité, c.-à-d., plus celui est élevé, plus leur revenu est élevé. La tendance observée chez les gens de métiers est différente. Bien qu’au départ des salaires plus élevés sont versés à ceux ayant un plus haut niveau de scolarité, l’inverse se produit après avoir obtenu un certificat d’apprenti inscrit.
Pour les personnes détenant un certificat d’études collégiales ou universitaires, le revenu augmente en fonction de la durée du programme. Toutefois, uniquement les personnes poursuivant un programme collégial de plus de deux ans touchent un salaire comparable à celui des personnes titulaires d’un certificat d’apprenti inscrit. Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat ou plus, la tendance est inversée, ce sont les travailleurs qui occupent une profession non liée aux métiers qui ont un revenu plus élevé. Dans les métiers, il est plus intéressant au niveau salarial d’avoir un certificat d’apprenti inscrit qu’un baccalauréat, peu importe la profession exercée. Ce n’est qu’une fois que le niveau de scolarité est supérieur au baccalauréat que le salaire médian dans les professions autres que les métiers dépasse celui des apprentis inscrits dans les métiers.
Graphique 3.8 Revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]
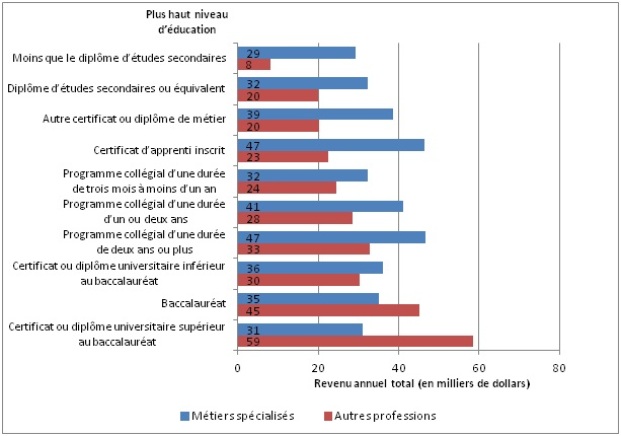
Description de l’image Graphique 3.8 Revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint : métiers et autres professions [Source : Recensement de 2006]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le revenu médian en fonction du plus haut niveau de scolarité atteint pour les métiers spécialisés et les autres professions, à partir des données du recensement de 2006.
Pour les travailleurs dans les métiers spécialisés, le revenu médian est de 31 000 $ pour ceux qui ont moins que le diplôme d’études secondaires; 32 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 40 000 $ pour ceux qui ont un autre certificat ou diplôme de métier; 47 000 $ pour ceux qui ont un certificat d’apprenti inscrit; 33 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de trois mois à moins d’un an; 41 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée d’un ou deux ans; 47 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de deux ans ou plus; 36 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat; 33 000 $ pour ceux qui ont un baccalauréat, et 27 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat.
Pour les travailleurs dans les professions autres que les métiers spécialisés, le revenu médian est de 13 000 $ pour ceux qui ont moins que le diplôme d’études secondaires; 19 000 pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 24 000 $ pour ceux qui ont un autre certificat ou diplôme de métier; 26 000 $ pour ceux qui ont un certificat d’apprenti inscrit; 27 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de trois mois à moins d’un an; 29 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée d’un ou deux ans; 34 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’un programme collégial d’une durée de deux ans ou plus; 31 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat; 40 000 $ pour ceux qui ont un baccalauréat, et 52 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat.
Somme toute, le graphique démontre que travailler dans les métiers apporte un avantage considérable sur le plan du revenu, plus particulièrement pour les personnes ayant un niveau de scolarité plus faible. Qui plus est, les résultats indiquent que les écarts salariaux liés à l’éducation découlent tout aussi bien de la profession exercée que du niveau de scolarité. Par exemple, les personnes de métiers n’ayant pas terminé leurs études secondaires ont un salaire médian deux fois plus élevé que les personnes travaillant dans d’autres professions. Les résultats démontrent également que réussir un programme d’apprenti inscrit ou tout autre programme collégial de plus de deux ans confère des avantages salariaux plus intéressants que tout autre parcours scolaire menant aux métiers. Selon le graphique, les personnes de métiers titulaires d’un certificat d’apprentissage gagnent plus que celles ayant les mêmes titres de compétences, mais travaillant dans une autre profession.
Plus de détails sont disponibles en étudiant le fichier de données complet du Recensement de 2006. Ce fichier offre une répartition par groupe professionnel plus précise que celle du fichier de microdonnées à grande diffusion. Le graphique 3.9 présente les salaires médians par niveau de scolarité pour les métiers retenus. Dans ce graphique, certains des groupes de scolarité ont été combinés afin de simplifier la présentation, étant donné que peu de gens de métiers ont poursuivi des études universitaires.
Graphique 3.9 Revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité : 10 principaux métiers [Source : Recensement de 2006, tableau personnalisé]
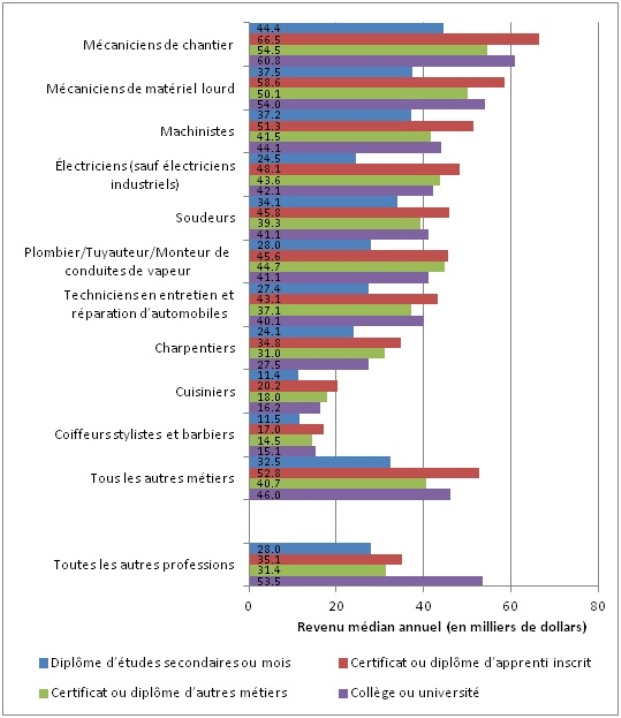
Description de l’image Graphique 3.9 Revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité : 10 principaux métiers [Source : Recensement de 2006, tableau personnalisé]
Il s’agit d’un diagramme en barres horizontal illustrant le revenu médian selon le plus haut niveau de scolarité des dix principaux métiers, à partir des données du recensement de 2006. Les barres représentant le revenu annuel médian pour chaque niveau de scolarité sont regroupées en fonction du métier.
Le revenu médian des mécaniciens de chantier était de 44 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 66 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 54 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 60 800 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des mécaniciens de matériel lourd était de 37 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 58 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 50 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 54 000 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des machinistes était de 37 200 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 51 300 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 41 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 44 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des électriciens (à l’exception des électriciens industriels) était de 24 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 48 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 43 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 42 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des soudeurs était de 34 100 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 45 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 39 300 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 41 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des plombiers, tuyauteurs et monteurs de conduites de vapeur était de 28 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 45 600 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 44 700 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 41 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des techniciens en entretien et réparation d’automobiles était de 27 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 43 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 37 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 40 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des charpentiers était de 24 100 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 34 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 31 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 27 500 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des cuisiniers était de 11 400 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 20 200 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 18 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 16 200 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des coiffeurs-stylistes et des barbiers était de 11 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 17 000 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 14 500 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 15 100 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des travailleurs de tous les autres métiers était de 32 500 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 52 800 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 40 700 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 46 000 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
Le revenu médian des travailleurs de toutes les autres professions était de 28 000 $ pour ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins; 35 100 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit; 31 400 $ pour ceux qui ont un certificat ou un diplôme d’autres métiers, et 53 500 $ pour ceux qui ont un diplôme collégial ou universitaire.
La caractéristique la plus évidente du graphique 3.9 est l’important écart dans les salaires parmi tous les métiers, peu importe le niveau de scolarité. Le revenu dépend donc plus du métier que de l’éducation reçue. On observe particulièrement qu’il est plus intéressant sur le plan du revenu pour les personnes de métiers d’obtenir un certificat d’apprenti que tout autre certificat scolaire, y compris un certificat d’études collégiales ou universitaires.
L’avantage salarial pour les détenteurs de certificat d’apprenti inscrit varie considérablement parmi tous les métiers. Il peut être jusqu’à quatre fois plus important chez les mécaniciens de chantier que chez les coiffeurs-stylistes/barbiers. Dans la plupart des métiers, l’avantage découlant d’un certificat d’apprenti inscrit est beaucoup plus important que celui découlant d’un certificat d’études secondaires ou même d’un certificat d’études collégiales ou universitaires. Puisque le Recensement ne permet pas de décerner les personnes ayant à la fois un certificat d’apprenti inscrit et un diplôme d’études collégiales ou universitaires, il se peut que des personnes ayant atteint le plus haut niveau de scolarité soient également des apprentis inscrits.
Dans la majorité des métiers, avoir des titres de compétences autres qu’un certificat d’apprenti inscrit est plus intéressant que de n’avoir qu’un diplôme d’études secondaires tout au plus. Semblablement, un diplôme d’études collégiales ou universitaires ne présente aucun avantage pour les personnes de métiers par rapport à un diplôme d’apprenti inscrit. Bien entendu, ce graphique ne nous permet pas de déterminer si ces diplômes d’études supérieures viennent compléter des certificats d’apprentissage ou les remplacer.
Les métiers diffèrent grandement des autres professions au sein desquelles il est plus avantageux de détenir des certificats d’études collégiales ou universitaires. Or, même dans les professions autres que les métiers, un certificat d’apprentissage présente plus davantage que tous les autres certificats, hormis ceux remis à la suite d’études collégiales ou universitaires.
3.3.2 Revenu d’emploi : groupes définis dans le SIAI
Cette section et les sections subséquentes présentent certains des résultats sur le marché du travail en fonction de la situation en matière d’apprentissage. Les données sont tirées des fichiers couplés du SIAI/FFT1. Les résultats sont donnés pour le SIAI de 2004, où le revenu est étudié de manière prospective de 2002 à 2009 en fonction de la « situation d’apprentissage » déclaréeNote de bas de page 16, et pour le SIAI de 2008, où il est étudié de manière rétrospective de 2009 à 2002. Les deux perspectives sont utiles, car la première méthode nous permet de nous pencher sur la trajectoire de revenu de ceux ayant reçu un certificat en 2004 par l’entremise d’un programme d’apprenti ou de la reconnaissance professionnelle. La deuxième nous permet de nous pencher sur la période pendant laquelle la plupart des individus étaient des apprentis ou pendant laquelle ils ont travaillé assez longtemps dans les métiers pour réussir un programme en 2008. Note de bas de page 17
Le graphique 3.10 dresse le portrait des projections jusqu’en 2009 pour les groupes définis dans le SIAI de 2004.Note de bas de page 18 Cependant, les résultats sont considérablement restreints, car ils ne sont valides que pour six provincesNote de bas de page 19. Des données individuelles n’étant pas disponibles en 2004 pour les autres provinces et territoires, ces résultats ne peuvent donc être comparés directement à ceux qui seront présentés plus tard pour le SIAI de 2008. Il n’y a notamment pas de données pour l’Alberta.
Ce graphique affiche une légère baisse du revenu de 2008 à 2009, probablement en raison de la récession. Les finissants et les travailleurs qualifiés avaient tous obtenu leur certificat en 2004. Les trajectoires de revenu pour ces deux groupes sont semblables, les finissants ayant un léger avantage jusqu’aux dernières années. Comme prévu, le revenu des autres groupes est plus faible. Malgré tout, la trajectoire pour les autres est à peu près similaire (voire légèrement inférieur) que pour les finissants et travailleurs qualifiés. C’est un peu surprenant puisque l’on s’attendait à ce que plusieurs persévérants et persévérants à long terme terminent le programme pendant cette période, ce qui aurait entrainé une hausse de la médiane des revenus plus remarquable que celle observée chez les finissants.
Graphique 3.10 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
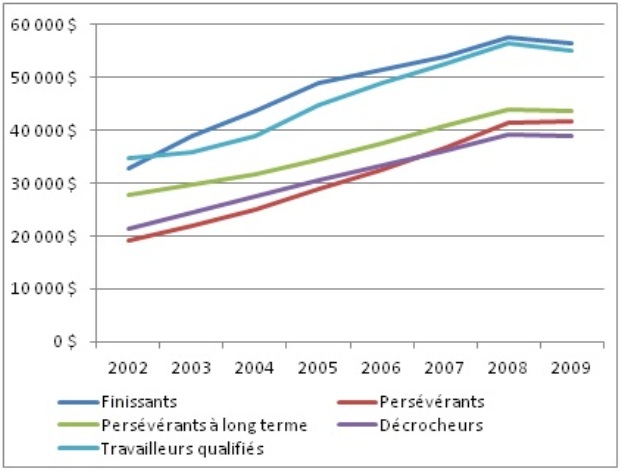
Description de l’image Graphique 3.10 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004. Cinq statuts sont présentés : finissants, persévérants, persévérants à long terme, décrocheurs et travailleurs qualifiés. Le revenu d’emploi médian de chaque catégorie a augmenté de façon constante de 2002 à 2008, et a ensuite diminué ou est resté stable en 2009.
Le revenu d’emploi médian des finissants était de 32 865 $ en 2002; 38 876 $ en 2003; 43 749 $ en 2004; 48 963 $ en 2005; 51 430 $ en 2006; 54 078 $ en 2007; 57 639 $ en 2008, et 56 574 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des persévérants était de 19 181 $ en 2002; 21 967 $ en 2003; 25 118 $ en 2004; 28 781 $ en 2005; 32 445 $ en 2006; 36 839 $ en 2007; 41 578 $ en 2008, et 41 737 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des persévérants à long terme était de 27 660 $ en 2002; 29 607 $ en 2003; 31 736 $ en 2004; 34 579 $ en 2005; 37 678 $ en 2006; 40 823 $ en 2007; 43 924 $ en 2008, et 43 601 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des décrocheurs était de 21 398 $ en 2002; 24 354 $ en 2003; 27 637 $ en 2004; 30 539 $ en 2005; 33 453 $ en 2006; 36 083 $ en 2007; 39 106 $ en 2008, et 38 956 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des travailleurs qualifiés était de 34 805 $ en 2002; 35 947 $ en 2003; 38 958 $ en 2004; 44 878 $ en 2005; 49 099 $ en 2006; 52 687 $ en 2007; 56 493 $ en 2008, et 55 239 $ en 2009.
Les trajectoires des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques au cours des premières années. Les persévérants gagnaient un peu plus que les décrocheurs après 2005. Bien entendu, certains de ces persévérants de 2004 auraient terminé leur programme au cours des années suivantes. Cependant, il n’est pas possible de distinguer ces finissants tardifs des autres persévérants.
Le graphique 3.11 présente les mêmes résultats de manière rétrospective à partir des données du SIAI de 2008 (selon les revenus de 2009). Note de bas de page 20 Lors des premières années, les travailleurs qualifiés avaient un revenu plus élevé que tous les autres groupes, ce qui était prévisible, car ces travailleurs ont dû œuvrer au sein de leur métier pendant de longues années avant de se présenter à l’examen. Pendant cette période, leurs gains étaient donc plus importants que ceux de tous les groupes d’apprentis. Le moment décisif fut en 2008-2009, lorsque les gains des finissants dépassèrent ceux des travailleurs qualifiés. Cette situation démontre que la réussite d’un programme d’apprenti confère immédiatement un avantage salarial venant s’ajouter à ceux dont jouissent déjà les personnes ayant de l’expérience considérable, mais pas encore de certificat de travailleur qualifié.
Graphique 3.11 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
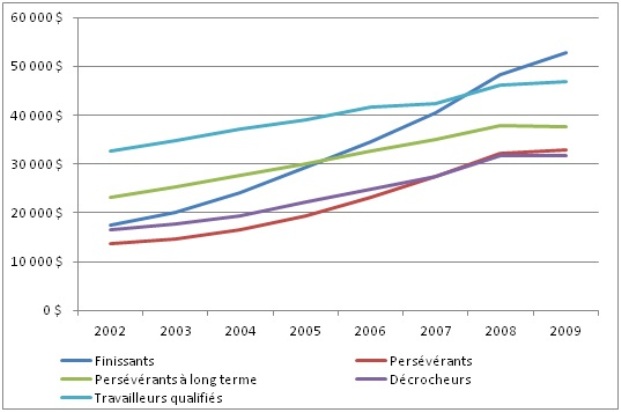
Description de l’image Graphique 3.11 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2008. Cinq statuts sont présentés : finissants, persévérants, persévérants à long terme, décrocheurs et travailleurs qualifiés. Le revenu d’emploi médian de chaque catégorie a augmenté de façon constante de 2002 à 2008. De 2008 à 2009, le revenu d’emploi médian de l’ensemble des catégories a diminué ou est demeuré essentiellement le même en 2009, à l’exception de celui des finissants qui a augmenté.
Le revenu d’emploi médian des finissants était tout juste inférieur à 20 000 $ en 2002; et il était de 20 074 $ en 2003; 24 160 $ en 2004; 29 437 $ en 2005; 34 603 $ en 2006; 40 428 $ en 2007; 48 325 $ en 2008, et 52 714 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des persévérants était de 13 644 $ en 2002; 14 672 $ en 2003; 16 432 $ en 2004; 19 386 $ en 2005; 23 070 $ en 2006; 27 534 $ en 2007; 32 150 $ en 2008, et 32 812 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des persévérants à long terme était tout juste inférieur à 25 000 $ en 2002; et il était de 25 356 $ en 2003; 27 683 $ en 2004; 30 113 $ en 2005; 32 575 $ en 2006; 35 103 $ en 2007; 37 843 $ en 2008, et 37 673 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des décrocheurs était de 16 494 $ en 2002; 17 731 $ en 2003; 19 345 $ en 2004; 22 099 $ en 2005; 24 801 $ en 2006; 27 534 $ en 2007; 31 780 $ en 2008, et 31 740 $ en 2009.
Le revenu d’emploi médian des travailleurs qualifiés était de 32 560 $ en 2002; 34 878 $ en 2003; 37 107 $ en 2004; 39 120 $ en 2005; 41 574 $ en 2006; 42 299 $ en 2007; 46 124 $ en 2008, et 46 800 $ en 2009.
Les tendances salariales chez les persévérants à long terme sont semblables à celles des travailleurs qualifiés, mais à un niveau moins élevé. Comparativement aux autres persévérants, le moment décisif fut en 2005, alors que les gains des apprentis poursuivant un parcours plus régulier ont dépassé les gains de ceux prenant plus de temps pour compléter le programme.
Les parcours des persévérants et des décrocheurs sont presque identiques, car ceux qui ont décroché en 2008 étaient principalement des persévérants lors des années précédentes. Il est intéressant de noter que les décrocheurs ont continué de gagner environ le même salaire que les persévérants dans les années suivant leur départ.
Finalement, le revenu de chacun des groupes, hormis le groupe des finissants, est demeuré sensiblement le même de 2008 à 2009. Le revenu des finissants n’a cessé de grimper au cours de ces deux années. Plus précisément, réussir un programme d’apprenti conféra un avantage immédiat d’environ 5 000 $ par rapport à un certificat de reconnaissance professionnelle lors de la récession. Le revenu de tous les autres groupes demeura le même pendant cette même période.
3.3.3 Revenu d’emploi par métier et par province/territoire
Cette section vient compléter les résultats précédents en se penchant sur les écarts dans les revenus d’emploi en fonction des métiers et des provinces et territoires. Afin de simplifier la présentation et de nous permettre de comparer l’ensemble des provinces et des territoires, les résultats ne sont présentés que pour les groupes définis dans le SIAI de 2008, en ayant recours à leur revenu de 2009.
Le graphique 3.12 présente la médiane des revenus en 2009 pour les dix principaux métiers, les autres métiers désignés Sceau rouge et tous les autres métiers des groupes définis en 2008. Le groupe des finissants représente le point de référence dans chacune des sections du graphique. Tout comme avec les résultats de l’EPA, les écarts salariaux entre les métiers sont la caractéristique la plus intéressante. Par exemple, chez les finissants, ceux occupant un poste au sein des cinq métiers les plus populaires gagnent trois fois que ceux dans les métiers présentant le plus faible revenu (coiffeurs-stylistes/barbiers) et deux fois plus que le deuxième métier à plus faible revenu (cuisiniers).
La tendance selon laquelle les finissants jouissent d’un avantage plus important sur le plan du revenu que les autres groupes est toujours vraie pour la majorité des métiers. Somme toute, les plus grands écarts sont entre les finissants et les deux types de persévérants et les décrocheurs. Cependant, les écarts sont relativement petits pour les cuisiniers et pour les coiffeurs-stylistes/barbiers par rapport aux autres métiers. Le métier au plus faible revenu offre donc moins d’avantages aux finissants. En fait, il n’est pas plus avantageux de réussir le programme que de le poursuivre à long terme pour les apprentis dans ces deux domaines.
L’écart le plus petit est entre les finissants et les travailleurs qualifiés. Ce n’est pas surprenant, car ces deux groupes ont atteint la reconnaissance professionnelle. Tous les métiers désignés Sceau rouge, hormis ceux expressément mentionnés, offrent des avantages salariaux par rapport aux métiers qui ne sont pas désignés Sceau rouge.
Graphique 3.12 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les métiers et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
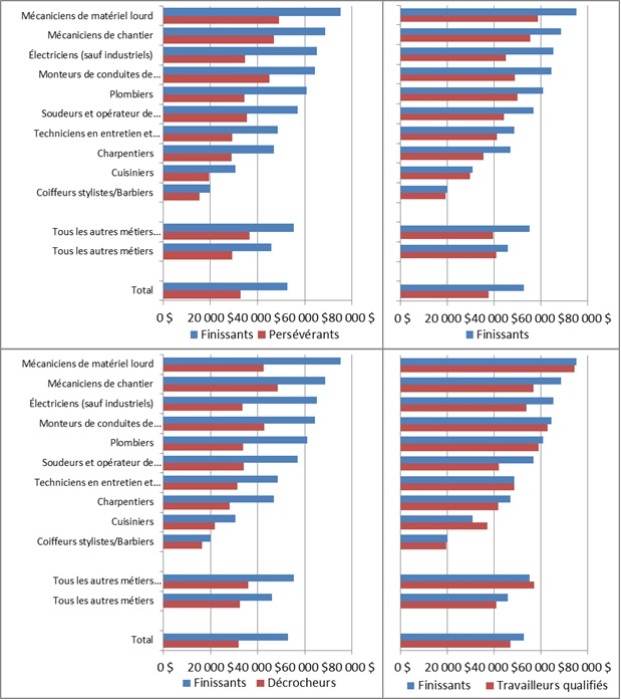
Description de l’image Graphique 3.12 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les métiers et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le revenu d’emploi médian selon le métier et le statut du SIAI de 2008 : les finissants par rapport aux autres groupes. Treize groupes de métiers sont examinés : mécanicien de matériel lourd; mécanicien de chantier; électricien (sauf industriel); monteur de conduites de vapeur, tuyauteur et installateur de réseaux de gicleurs; plombier; soudeur et opérateur de machines à souder et à braser; technicien en entretien et réparation d’automobiles; charpentier; cuisinier; coiffeur-styliste et barbier; tous les autres métiers désignés Sceau rouge; tous les autres métiers, ainsi que le total (la totalité des métiers). Quatre graphiques sont présentés et ils comparent tous le nombre de finissants avec les autres catégories de groupe pour tous les métiers examinés.
En 2009, les mécaniciens de matériel lourd avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 75 067 $ pour les finissants; 49 045 $ pour les persévérants; 58 577 $ pour les persévérants à long terme; 42 570 $ pour les décrocheurs, et 74 297 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les mécaniciens de chantier avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 68 596 $ pour les finissants; 46 983 $ pour les persévérants; 55 327 $ pour les persévérants à long terme; 48 486 $ pour les décrocheurs, et 56 642 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les électriciens (sauf industriels) avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 65 117 $ pour les finissants; 34 769 $ pour les persévérants; 45 015 $ pour les persévérants à long terme; 33 591 $ pour les décrocheurs, et 53 795 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les monteurs de conduites de vapeur, tuyauteurs et installateurs de réseaux de gicleurs avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 64 302 $ pour les finissants; 44 895 $ pour les persévérants; 48 814 $ pour les persévérants à long terme; 42 880 $ pour les décrocheurs, et 62 891 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les plombiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 60 884 $ pour les finissants; 34 475 $ pour les persévérants; 49 958 $ pour les persévérants à long terme; 33 690 $ pour les décrocheurs, et 59 022 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 56 840 $ pour les finissants; 35 607 $ pour les persévérants; 44 056 $ pour les persévérants à long terme; 33 953 $ pour les décrocheurs, et 41 992 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les techniciens en entretien et réparation d’automobiles avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 48 517 $ pour les finissants; 29 250 $ pour les persévérants; 41 249 $ pour les persévérants à long terme; 31 449 $ pour les décrocheurs, et 48 677 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les charpentiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 46 814 $ pour les finissants; 28 897 $ pour les persévérants; 35 420 $ pour les persévérants à long terme; 27 951 $ pour les décrocheurs, et 41 761 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les cuisiniers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 30 612 $ pour les finissants; 19 476 $ pour les persévérants; 29 525 $ pour les persévérants à long terme; 21 816 $ pour les décrocheurs, et 37 166 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les coiffeurs-stylistes et les barbiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 19 999 $ pour les finissants; 15 293 $ pour les persévérants; 19 150 $ pour les persévérants à long terme; 16 269 $ pour les décrocheurs, et 19 598 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les travailleurs de tous les autres métiers désignés Sceau rouge avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 55 228 $ pour les finissants; 36 591 $ pour les persévérants; 39 635 $ pour les persévérants à long terme; 35 921 $ pour les décrocheurs, et 56 902 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les travailleurs de tous les autres métiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 45 891 $ pour les finissants; 29 348 $ pour les persévérants; 40 963 $ pour les persévérants à long terme; 32 455 $ pour les décrocheurs, et 41 011 $ pour les travailleurs qualifiés.
En 2009, les travailleurs de tous les métiers avaient le revenu médian suivant pour chaque statut du SIAI de 2008 : 52 714 $ pour les finissants; 32 812 $ pour les persévérants; 37 673 $ pour les persévérants à long terme; 31 740 $ pour les décrocheurs, et 46 800 $ pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.13 présente les mêmes comparaisons, mais par province/territoire. Les tendances pour chaque groupe sont semblables à celles du graphique 3.10, c’est-à-dire que les finissants affichent généralement la médiane salariale la plus élevée. Cependant, dans plusieurs provinces et territoires, la médiane salariale pour les travailleurs qualifiés est comparable ou légèrement plus élevée que celle des finissants. Somme toute, l’écart entre les provinces et les territoires est plus petit que celui entre les métiers. Plus particulièrement, les écarts provinciaux et territoriaux sont minimes entre les persévérants et les persévérants à long terme. Cette situation découle probablement de leur statut d’apprenti, leurs salaires étant ainsi réglementés. Les revenus les plus élevés pour tous les groupes sont observés en Alberta et dans les Territoires. Les travailleurs en Saskatchewan et en Colombie-Britannique tendent à gagner également un salaire plus élevé que ceux dans les autres provinces et territoires.
Graphique 3.13 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les provinces et les territoires et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : lien entre le SIAI/ FFT1]
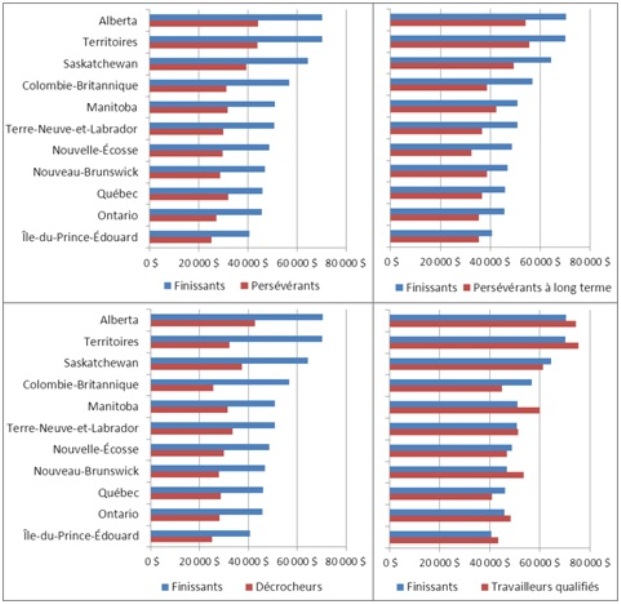
Description de l’image Graphique 3.13 Revenu d’emploi médian de 2009 selon les provinces et les territoires et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : lien entre le SIAI/ FFT1]
Il s’agit de diagrammes en barres illustrant le revenu d’emploi médian selon les provinces et les territoires ainsi que le statut du SIAI de 2008 : les finissants par rapport aux autres groupes. Quatre graphiques comparent les finissants aux autres catégories de groupes pour chaque province et territoire examiné.
En Alberta, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 70 446 $ pour les finissants; 44 082 $ pour les persévérants; 54 123 $ pour les persévérants à long terme; 42 707 $ pour les décrocheurs, et 74 356 $ pour les travailleurs qualifiés.
Dans les Territoires, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 70 211 $ pour les finissants; 43 963 $ pour les persévérants; 55 765 $ pour les persévérants à long terme; 32 228 $ pour les décrocheurs, et 75 417 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Saskatchewan, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 64 379 $ pour les finissants; 39 415 $ pour les persévérants; 49 524 $ pour les persévérants à long terme; 37 471 $ pour les décrocheurs, et 61 188 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Colombie-Britannique, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 56 906 $ pour les finissants; 31 190 $ pour les persévérants; 38 745 $ pour les persévérants à long terme; 25 715 $ pour les décrocheurs, et 44 782 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Manitoba, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 51 002 $ pour les finissants; 31 685 $ pour les persévérants; 42 467 $ pour les persévérants à long terme; 31 520 $ pour les décrocheurs, et 60 130 $ pour les travailleurs qualifiés.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 50 902 $ pour les finissants; 30 063 $ pour les persévérants; 36 703 $ pour les persévérants à long terme; 33 459 $ pour les décrocheurs, et 51 243 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Nouvelle-Écosse, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 48 720 $ pour les finissants; 29 771 $ pour les persévérants; 32 372 $ pour les persévérants à long terme; 30 005 $ pour les décrocheurs, et 46 812 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Nouveau-Brunswick, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 46 937 $ pour les finissants; 28 621 $ pour les persévérants; 38 738 $ pour les persévérants à long terme; 27 996 $ pour les décrocheurs, et 53 634 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Québec, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 46 054 $ pour les finissants; 31 959 $ pour les persévérants; 36 702 $ pour les persévérants à long terme; 28 645 $ pour les décrocheurs, et 40 889 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Ontario, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 45 743 $ pour les finissants; 27 141 $ pour les persévérants; 35 366 $ pour les persévérants à long terme; 28 132 $ pour les décrocheurs, et 48 380 $ pour les travailleurs qualifiés.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le revenu médian suivant a été observé en 2009 pour chaque groupe des statuts du SIAI de 2008 : 40 640 $ pour les finissants; 25 116 $ pour les persévérants; 35 416 $ pour les persévérants à long terme; 25 265 $ pour les décrocheurs, et 43 347 $ pour les travailleurs qualifiés.
3.3.4 Travail autonome
À première vue, tout porte à croire que les métiers se prêtent bien au travail autonome, car une grande partie des travaux en construction et en mécanique ne sont que de petites tâches domestiques (p. ex., rénovations résidentielles et réparations mécaniques). Quoique cette affirmation puisse s’avérer exacte pour les finissants et les travailleurs qualifiés, ce n’est pas le cas pour les apprentis. Il est donc instructif d’examiner le taux de personnes de métiers occupant un emploi autonome en 2009 et les revenus d’emploi autonome.
Le graphique 3.14 présente une répartition des métiers en fonction du pourcentage de travailleurs des groupes définis de 2008 occupant un emploi autonome en 2009. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre total de travailleurs autonomes au sein de la population active au cours de l’année donnée. Ce tableau démontre très clairement que le nombre de travailleurs autonomes est assez faible (moins de 10 % dans la plupart des cas, comparativement à 15 % pour l’ensemble de la population active). Toutefois, ce chiffre varie grandement selon le groupe et le métier. Les travailleurs qualifiés enregistrent le nombre le plus important de travailleurs autonomes dans la majorité des dix métiers les plus importants, plus particulièrement ceux de coiffeurs-stylistes/barbiers, charpentiers, plombiers et électriciens. Les finissants affichent également un nombre assez élevé de travailleurs autonomes dans les domaines des coiffeurs-stylistes/barbiers et des charpentiers. Ce nombre est relativement faible dans les domaines des mécaniciens de chantier, des mécaniciens de matériel lourd, des cuisiniers et des monteurs de conduites de vapeur/tuyauteurs/installateurs de réseaux de gicleurs, soit moins de 10 %. Bien que cela ne soit pas indiqué dans le graphique, le travail autonome représente également moins de 10 % au sein de tous les autres groupes pour tous les autres métiers.
Graphique 3.14 Pourcentage rapportant des revenus de travail autonome en 2009 selon le métier et le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
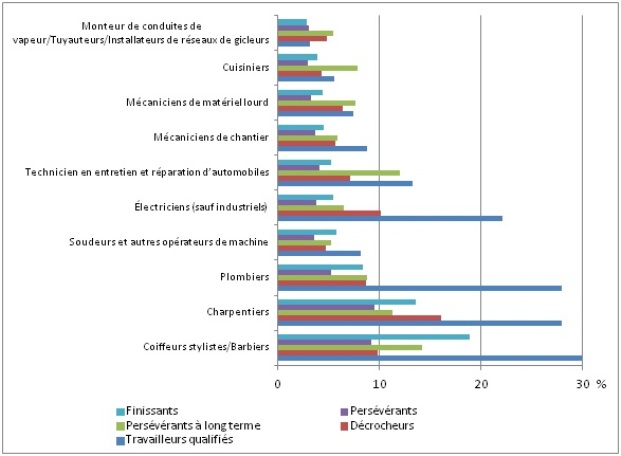
Description de l’image Graphique 3.14 Pourcentage rapportant des revenus de travail autonome en 2009 selon le métier et le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant les revenus tirés du travail autonome en 2009, selon le métier et le statut du SIAI de 2008.
Pour ce qui est du métier de monteur de conduites de vapeur, tuyauteurs et installateurs de réseaux de gicleurs, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 2,82 % pour les finissants; 3,08 % pour les persévérants; 5,5 % pour les persévérants à long terme; 4,79 % pour les décrocheurs, et 3,2 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de cuisinier, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 3,87 % pour les finissants; 2,96 % pour les persévérants; 7,84 % pour les persévérants à long terme; 4,34 % pour les décrocheurs, et 5,56 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de matériel lourd, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 4,45 % pour les finissants; 3,28 % pour les persévérants; 7,61 % pour les persévérants à long terme; 6,36 % pour les décrocheurs, et 7,47 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de chantier, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 4,53 % pour les finissants; 3,65 % pour les persévérants; 5,89 % pour les persévérants à long terme; 5,64 % pour les décrocheurs, et 8,75 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de technicien en entretien et réparation d’automobiles, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 5,28 % pour les finissants; 4,11 % pour les persévérants; 12,01 % pour les persévérants à long terme; 7,16 % pour les décrocheurs, et 13,28 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier d’électricien (sauf industriel), le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 5,49 % pour les finissants; 3,80 % pour les persévérants; 6,55 % pour les persévérants à long terme; 10,12 % pour les décrocheurs, et 22,11 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de soudeur et d’opérateur de machine à souder et à braser, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 5,79 % pour les finissants; 3,61 % pour les persévérants; 5,20 % pour les persévérants à long terme; 4,75 % pour les décrocheurs, et 8,12 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de plombier, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 8,41 % pour les finissants; 5,25 % pour les persévérants; 8,80 % pour les persévérants à long terme; 8,69 % pour les décrocheurs, et 27,99 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de charpentier, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 13,56 % pour les finissants; 9,55 % pour les persévérants; 11,29 % pour les persévérants à long terme; 16,06 % pour les décrocheurs, et 27,98 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de coiffeur-styliste et barbier, le pourcentage rapportant des revenus tirés du travail autonome en 2009 était de 18,85 % pour les finissants; 9,17 % pour les persévérants; 14,23 % pour les persévérants à long terme; 9,81 % pour les décrocheurs, et 29,90 % pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.15 présente la médiane des gains nets tirés d’un emploi autonome en 2009 pour les groupes définis de 2008, dans les métiers où il y avait des revenus de travail autonome nets non nuls. Comme ce fut le cas précédemment, chaque section du graphique compare le pourcentage de finissants à un autre groupe défini. On constate tout d’abord que les revenus d’emploi autonome sont très faibles par rapport aux revenus tirés d’un emploi. Chez les finissants, uniquement les charpentiers et les coiffeurs-stylistes/barbiers eurent des gains nets de plus de 5 000 $ en 2009. Les persévérants à long terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés de plusieurs autres métiers reçurent également des gains semblables. Dans la plupart des cas, les charpentiers touchèrent les revenus d’emploi autonome les plus élevés. La seule exception fut chez les persévérants à long terme, où les plombiers gagnèrent un peu plus que les charpentiers.
Graphique 3.15 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
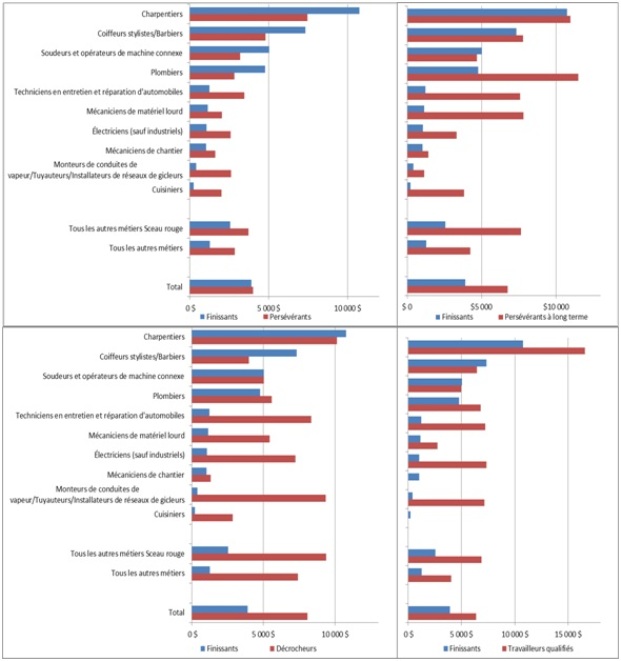
Description de l’image Graphique 3.15 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit de diagrammes en barres illustrant le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes. Quatre graphiques comparent les finissants aux autres catégories de groupes pour chaque métier examiné.
Pour ce qui est du métier de charpentier, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 10 757 $ pour les finissants; 7 474 $ pour les persévérants; 10 970 $ pour les persévérants à long terme; 10 132 $ pour les décrocheurs, et 16 564 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 7 331 $ pour les finissants; 4 800 $ pour les persévérants; 7 786 $ pour les persévérants à long terme; 3 977 $ pour les décrocheurs, et 6 434 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de soudeur, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 5 034 $ pour les finissants; 3 193 $ pour les persévérants; 4 701 $ pour les persévérants à long terme; 5 041 $ pour les décrocheurs, et 4 958 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de plombier, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 4 762 $ pour les finissants; 2 818 $ pour les persévérants; 11 489 $ pour les persévérants à long terme; 5 580 $ pour les décrocheurs, et 6 786 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 1 232 $ pour les finissants; 3 458 $ pour les persévérants; 7 595 $ pour les persévérants à long terme; 8 323 $ pour les décrocheurs, et 7 208 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de matériel lourd, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 1 141 $ pour les finissants; 2 026 $ pour les persévérants; 7 816 $ pour les persévérants à long terme; 5 433 $ pour les décrocheurs, et 2 761 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier d’électricien (sauf industriel), le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 1 056 $ pour les finissants; 2 578 $ pour les persévérants; 3 317 $ pour les persévérants à long terme; 7 239 $ pour les décrocheurs, et 7 327 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de chantier, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 1 031 $ pour les finissants; 1 609 $ pour les persévérants; 1 411 $ pour les persévérants à long terme; 1 338 $ pour les décrocheurs, et zéro pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de monteur de conduites de vapeur et de tuyauteur, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 413 $ pour les finissants; 2 603 $ pour les persévérants; 1 142 $ pour les persévérants à long terme; 9 336 $ pour les décrocheurs, et 7 135 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de cuisinier, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 233 $ pour les finissants; 2 002 $ pour les persévérants; 3 835 $ pour les persévérants à long terme; 2 867 $ pour les décrocheurs, et zéro pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les autres métiers désignés Sceau rouge, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 2 557 $ pour les finissants; 3 726 $ pour les persévérants; 7 640 $ pour les persévérants à long terme; 9 373 $ pour les décrocheurs, et 6 883 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les autres métiers, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 1 271 $ pour les finissants; 2 841 $ pour les persévérants; 4 248 $ pour les persévérants à long terme; 7 400 $ pour les décrocheurs, et 4 042 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les métiers, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009 était de 3 913 $ pour les finissants; 4 022 $ pour les persévérants; 6 757 $ pour les persévérants à long terme; 8 085 $ pour les décrocheurs, et 6 362 $ pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.16 présente le même type de renseignements que le graphique 3.15, mais par province. Note de bas de page 21 Il révèle de très grandes différences dans tous les groupes parmi toutes les provinces, à l’exception des persévérants. Les revenus d’emploi autonome pour les persévérants à long terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés sont plus élevés que ceux des finissants dans la plupart des provinces. La Saskatchewan affiche les gains les plus importants pour les finissants, les persévérants à long terme et les décrocheurs.
De prime abord, ces résultats indiquent que les travailleurs autonomes ont un revenu beaucoup plus faible que les travailleurs salariés. Il est possible que les finissants de 2008 eussent tout récemment obtenu leur certificat en 2009 et qu’ils n’eussent donc pas l’expérience des travailleurs qualifiés, expliquant ainsi leurs faibles revenus d’emploi autonome. Effectuer un suivi des revenus d’emploi autonome chez les participants du SIAI de 2004 peut également nous aider à mieux interpréter la situation.
Graphique 3.16 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon la province ou le territoire et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
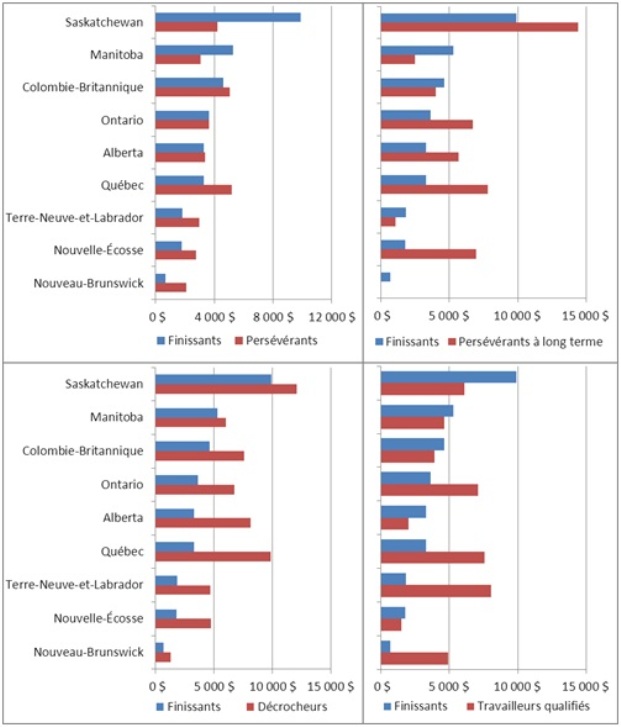
Description de l’image Graphique 3.16 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon la province ou le territoire et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit de diagrammes en barres illustrant le revenu net médian provenant d’un emploi autonome en 2009, selon la province et le statut du SIAI de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes. Quatre graphiques comparent les finissants aux autres catégories de groupes pour chaque province examinée.
En Saskatchewan, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 9 901 $ pour les finissants; 4 200 $ pour les persévérants; 14 401 $ pour les persévérants à long terme; 12 093 $ pour les décrocheurs, et 6 120 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Manitoba, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 5 292 $ pour les finissants; 3 077 $ pour les persévérants; 2 490 $ pour les persévérants à long terme; 6 029 $ pour les décrocheurs, et 4 633 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Colombie-Britannique, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 4 626 $ pour les finissants; 5 049 $ pour les persévérants; 3 996 $ pour les persévérants à long terme; 7 574 $ pour les décrocheurs, et 3 901 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Ontario, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 3 629 $ pour les finissants; 3 622 $ pour les persévérants; 6 697 $ pour les persévérants à long terme; 6 753 $ pour les décrocheurs, et 7 088 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Alberta, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 3 288 $ pour les finissants; 3 372 $ pour les persévérants; 5 658 $ pour les persévérants à long terme; 8 122 $ pour les décrocheurs, et 2 022 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Québec, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 3 281 $ pour les finissants; 5 183 $ pour les persévérants; 7 785 $ pour les persévérants à long terme; 9 879 $ pour les décrocheurs, et 7 553 $ pour les travailleurs qualifiés.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 1 836 $ pour les finissants; 2 963 $ pour les persévérants; 1 072 $ pour les persévérants à long terme; 4 697 $ pour les décrocheurs, et 8 067 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Nouvelle-Écosse, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 1 791 $ pour les finissants; 2 754 $ pour les persévérants; 6 937 $ pour les persévérants à long terme; 4 735 $ pour les décrocheurs, et 1 484 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Nouveau-Brunswick, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome suivant a été observé en 2009 : 664 $ pour les finissants; 2 104 $ pour les persévérants; zéro pour les persévérants à long terme; 1 291 $ pour les décrocheurs, et 4 928 $ pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.17 présente les pourcentages globaux de travailleurs du SIAI de 2004 recevant des revenus d’emploi autonome pour la période de 2002 à 2009, par groupe défini. Les travailleurs qualifiés affichent le plus haut taux de travail autonome au fil des ans, avec une augmentation considérable de 2002 à 2005, c’est-à-dire la période avant et après leur reconnaissance professionnelle. Le taux demeure assez stable après quoi. Les finissants enregistrent également une augmentation au fil du temps, avec une hausse plus remarquable en 2005. Ces résultats nous amènent à croire que la reconnaissance professionnelle pourrait avoir une influence sur le travail autonome. Les travailleurs autonomes sont bien plus nombreux chez les décrocheurs que chez les finissants et les persévérants pendant toute la période.
Graphique 3.17 Pourcentage rapportant des revenus d’emploi autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
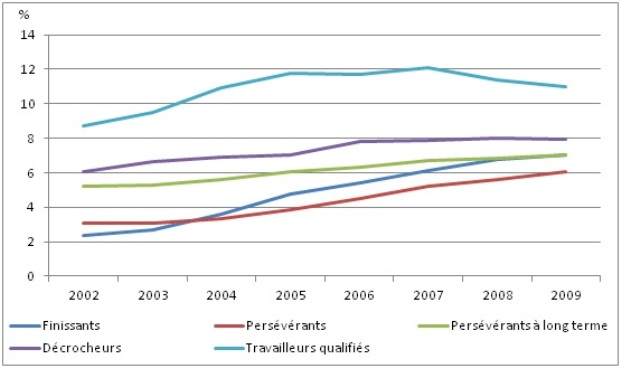
Description de l’image Graphique 3.17 Pourcentage rapportant des revenus d’emploi autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant un revenu tiré du travail autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004.
Le pourcentage de finissants déclarant avoir un revenu tiré du travail indépendant était de 2,4 % en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 7,0 %.
Le pourcentage de persévérants déclarant avoir un revenu tiré du travail indépendant était de 3,1 % en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 6,1 %.
Le pourcentage de décrocheurs déclarant avoir un revenu tiré du travail indépendant était de 6,0 % en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2007 et est ensuite resté stable de 2007 à 2009 à un taux de 8,0 %.
Le pourcentage de persévérants à long terme déclarant avoir un revenu tiré du travail indépendant était de 5,2 % en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 7,0 %.
Le pourcentage de travailleurs qualifiés déclarant avoir un revenu tiré du travail indépendant était de 8,7 % en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2005 pour atteindre 11,8 % et est demeuré relativement stable de 2005 à 2007. Le pourcentage a ensuite décliné de 2007 à 2009 à 11,0 %.
Le graphique 3.18 présente les tendances relatives aux revenus d’emploi autonome chez les groupes définis du SIAI de 2004. Ce sont encore les travailleurs qualifiés qui affichent les plus hauts revenus pendant cette période. Cependant, les finissants enregistrent le taux de croissance le plus rapide. Les tendances de revenu se rejoignent à la fin de la période pour tous les groupes. Un faible déclin fut observé chez les travailleurs qualifiés et les finissants en 2009, nul doute en raison de la récession.
Les résultats de 2009 du graphique 3.18 peuvent être comparés aux « totaux » de la même année du graphique 3.15 pour les groupes du SIAI de 2008. Ces résultats démontrent que les gains augmentent avec l’expérience, la plupart des groupes du SIAI de 2004 touchant environ deux fois le montant de leurs compatriotes de 2008. Toutefois, ces gains demeurent considérablement plus faibles que ceux des travailleurs salariés.
Il est également possible que des revenus d’emploi autonome viennent parfois compléter des revenus d’emplois. On se pencha sur cette possibilité en examinant le revenu d’emploi chez ceux ayant déclaré avoir des revenus d’emploi autonome. On découvrit ainsi qu’un peu plus de la moitié de ceux ayant des gains d’emplois autonomes occupaient également un poste salarié. Les gains tirés d’un emploi étaient bien faibles dans la plupart des cas, la médiane étant de 5 000 $ à 10 000 $ pour les travailleurs autonomes.
Graphique 3.18 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
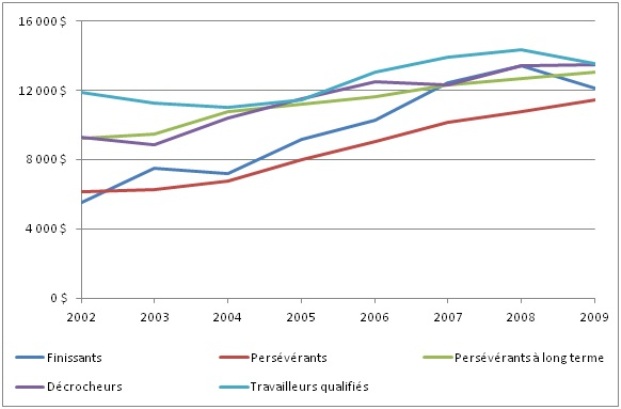
Description de l’image Graphique 3.18 Revenu net médian provenant d’un emploi autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le revenu net médian provenant d’un emploi autonome de 2002 à 2009, selon le statut du SIAI de 2004.
Pour les finissants, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome était de 5 544 $ en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2008 pour atteindre 13 000 $ pour ensuite diminuer à 12 000 $ en 2009.
Pour les persévérants, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome était de 6 000 $ en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 11 500 $.
Pour les décrocheurs, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome était de 9 000 $ en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 13 500 $.
Pour les persévérants à long terme, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome était de 9 000 $ en 2002 et a augmenté à un rythme constant de 2002 à 2009 pour atteindre 13 000 $.
Pour les travailleurs qualifiés, le revenu net médian provenant d’un emploi autonome était de 12 000 $ en 2002. Il a diminué à 11 000 $ en 2004 et a ensuite augmenté à un rythme constant de 2004 à 2008 pour atteindre 14 364 $. Le revenu a diminué à 13 556 $ en 2009.
Finalement, l’un des aspects qui différencient les travailleurs salariés des travailleurs autonomes est que ces derniers peuvent déduire leurs frais professionnels de leur revenu brut. Il est donc possible qu’il y ait un écart entre le revenu brut total et le revenu net provenant d’un emploi autonome. Bien que le revenu net soit une mesure plus appropriée par rapport au revenu d’emploi, il se peut que les dépenses absorbent une part considérable des revenus autonomes d’emploi.
Pour examiner cette possibilité, les revenus nets de 2009 provenant d’un emploi autonome chez les finissants et les travailleurs qualifiés furent calculés pour quatre métiers (charpentiers, électriciens, coiffeurs-stylistes et plombiers) pour lesquels les revenus d’emploi autonome et les gains étaient relativement élevés. Le graphique 3.19 présente ces chiffres par rapport aux gains nets déjà fournis dans le graphique 3.15. Un important écart est observable entre les gains bruts et les gains nets, plus particulièrement chez les finissants charpentiers et plombiers. Dans la plupart des métiers, les gains bruts sont comparables aux revenus des travailleurs salariés, suggérant qu’il pourrait y avoir un montant maximal brut qui serait très semblable aux revenus d’emploi. Ce montant brut peut être limité par le salaire horaire ou le caractère sporadique de l’emploi autonome. Une fois toutes les dépenses déduites, les gains nets sont beaucoup plus faibles.
Graphique 3.19 Revenu brut et net de 2009 provenant d’un emploi autonome pour les finissants et les travailleurs qualifiés de 2008, par métiers choisis [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
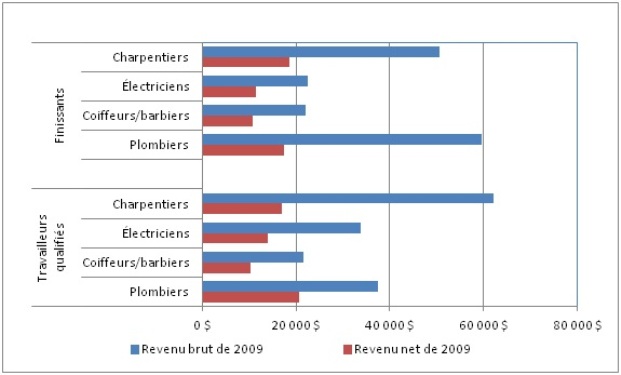
Description de l’image Graphique 3.19 Revenu brut et net de 2009 provenant d’un emploi autonome pour les finissants et les travailleurs qualifiés de 2008, par métiers choisis [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme à barres horizontales illustrant les revenus brut et net de 2009 provenant d’un emploi autonome pour les finissants et les travailleurs qualifiés de 2008 pour les métiers choisis.
Pour les finissants du métier de charpentier, le revenu brut médian était de 50 552 $ et le revenu net était de 18 584 $. Pour les finissants du métier d’électricien, le revenu brut médian était de 22 526 $ et le revenu net était de 11 591 $. Pour les finissants du métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu brut médian était de 22 171 $ et le revenu net était de 10 803 $. Pour les finissants du métier de plombier, le revenu brut médian était de 59 619 $ et le revenu net était de 17 549 $.
Pour les travailleurs qualifiés du métier de charpentier, le revenu brut médian était de 62 102 $ et le revenu net était de 16 920 $. Pour les travailleurs qualifiés du métier d’électricien, le revenu brut médian était de 33 737 $ et le revenu net était de 13 999 $. Pour les travailleurs qualifiés du métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu brut médian était de 21 641 $ et le revenu net était de 10 365 $. Pour les travailleurs qualifiés du métier de plombier, le revenu brut médian était de 37 496 $ et le revenu net était de 20 698 $.
3.3.5 Assurance-emploi
Les informations sur le montant des prestations d’assurance-emploi (AE) reçues en 2009 par les groupes définis du SIAI de 2008 se trouvent dans le fichier couplé SIAI/FFT1, parce que les revenus tirés d’AE sont traités comme un élément distinct aux fins d’impôts. Les persévérants et les persévérants à long terme peuvent être admissibles à toucher des prestations régulières d’AE au cours des périodes de chômage en raison de la formation à temps plein par stages d'études en cours de travail que leur province/territoire leur avait demandé de suivre. Ils peuvent également être admissibles à recevoir de l’aide financière supplémentaire de leur région au cours de cette formation. Ces prestations sont financées en vertu de la partie II du régime d’AE et gérées par la province/le territoire dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail. Les persévérants et les persévérants à long terme peuvent aussi être admissibles à toucher des prestations régulières d’AE au cours de l’année du fait du chômage saisonnier ou de pertes d’emploi résultant de la récession de 2009.
Le fichier couplé FFT1 présente tous les revenus tirés d’AE. Par conséquent, il ne peut pas établir la différence entre les prestations versées au cours de la formation en classe et celles versées en raison de manque de travail en vertu de la partie I, les prestations versées en vertu de la partie II et gérées par la province ou le territoire ainsi que les prestations spéciales disponibles comme prestations de maternité, parentales et de maladie.
Dans le cas des finissants, des décrocheurs et des travailleurs qualifiés, les prestations d’AE versées en 2009 sont censées être constituées de prestations régulières d’AE (non de formation) et éventuellement de prestations spéciales.
Les données sur les prestations d’AE présentées en 2009 peuvent être touchées par l’importante hausse du taux de chômage enregistrée partout dans les provinces/territoires du pays en 2009, en raison des effets de la crise financière mondiale et la récession qui l’a accompagné.
Le graphique 3.20 présente les pourcentages de prestataires d’AE en 2009, par groupes définis du SIAI de 2008 et par métier. Dans l’ensemble, on observe un recours plus élevé dans les métiers liés à la construction. Le recours à l’AE est assez faible pour la plupart des groupes définis dans les métiers de cuisiniers, coiffeurs/stylistes/barbiers, de techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles et de mécaniciens de matériel lourd. Il est également plus faible chez les finissants que tout autre groupe. Hormis ces observations, la tendance au sein des groupes définis varie selon le métier. Par exemple, les charpentiers et les électriciens, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés ont moins souvent recours à l’AE que les trois autres groupes. Le recours à l’AE est généralement plus élevé chez les persévérants que chez d’autres groupes. Il est également assez fort chez les persévérants à long terme pour les métiers de charpentiers, de monteurs de conduites de vapeur/tuyauteurs/installateurs de réseaux de gicleurs et d’électriciens
Il importe de noter qu’en matière d’AE, les différences entre les métiers peuvent tenir en grande partie de la méthode de formation utilisée par les provinces et territoires pour ce métier en question. L’utilisation de la formation par stages d'études en cours de travail est plus répandue dans certaines régions et certains métiers, ce qui a des effets sur le montant en prestations d’AE reçu selon le métier et la région.
Graphique 3.20 Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009 selon le métier et les groupes définis de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
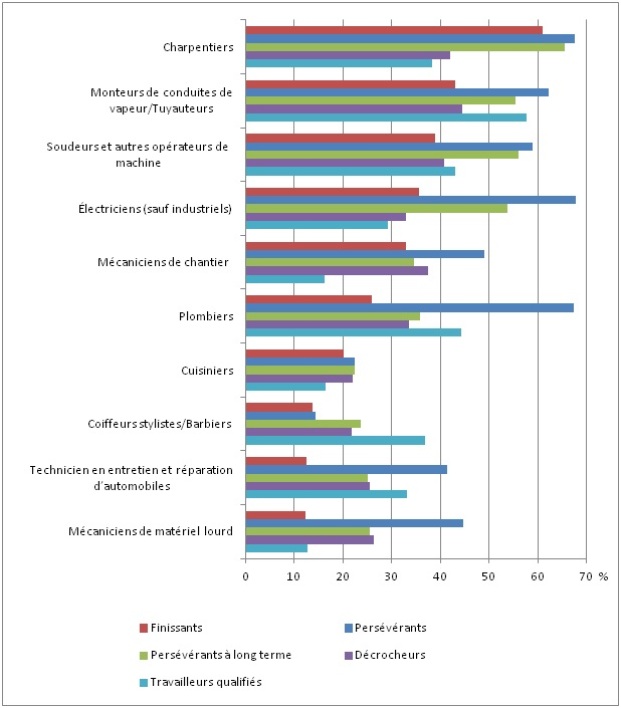
Description de l’image Graphique 3.20 Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009 selon le métier et les groupes définis de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme à barres horizontales illustrant le pourcentage qui a déclaré un revenu d’assurance-emploi (AE) en 2009 selon le statut du SIAI de 2008.
Pour ce qui est du métier de charpentier, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 61,0 % pour les finissants; 67,7 % pour les persévérants; 65,6 % pour les persévérants à long terme; 42,0 % pour les décrocheurs, et 38,4 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de monteur de conduites de vapeur et de tuyauteur, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 43,1 % pour les finissants; 62,2 % pour les persévérants; 55,4 % pour les persévérants à long terme; 44,5 % pour les décrocheurs, et 57,8 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de soudeur, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 39,0 % pour les finissants; 58,9 % pour les persévérants; 56,1 % pour les persévérants à long terme; 40,9 % pour les décrocheurs, et 43,1 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier d’électricien (sauf industriel), le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 35,6 % pour les finissants; 67,9 % pour les persévérants; 53,8 % pour les persévérants à long terme; 33,0 % pour les décrocheurs, et 29,3 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de chantier, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 32,9 % pour les finissants; 49,1 % pour les persévérants; 34,7 % pour les persévérants à long terme; 37,6 % pour les décrocheurs, et 16,3 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de plombier, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 26,0 % pour les finissants; 67,4 % pour les persévérants; 35,9 % pour les persévérants à long terme; 33,7 % pour les décrocheurs, et 44,4 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de cuisinier, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 20,2 % pour les finissants; 22,3 % pour les persévérants; 22,4 % pour les persévérants à long terme; 22,0 % pour les décrocheurs, et 16,5 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de coiffeur-styliste et barbier, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 13,8 % pour les finissants; 14,4 % pour les persévérants; 23,8 % pour les persévérants à long terme; 21,9 % pour les décrocheurs, et 36,9 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 12,6 % pour les finissants; 41,4 % pour les persévérants; 25,2 % pour les persévérants à long terme; 25,5 % pour les décrocheurs, et 33,2 % pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de matériel lourd, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE en 2009 était de 12,3 % pour les finissants; 44,8 % pour les persévérants; 25,6 % pour les persévérants à long terme; 26,3 % pour les décrocheurs, et 12,7 % pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.21 présente la médiane des revenus tirés des prestations d’AE en 2009 par groupes définis du SIAI de 2008 et par métier. Ces données démontrent que les montants des prestations ne sont pas très élevés, soit environ 5 000 $ pour les finissants et les persévérants, et 6 000 $ pour les persévérants à long terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés. Les différences entre les métiers sont relativement petites par rapport à celles décelées entre les revenus d’emploi et les revenus d’emploi autonome. Les finissants perçoivent les plus petits montants. Or, la différence entre les finissants et les persévérants est bien petite. En général, les plus gros montants sont versés aux persévérants à long terme et aux travailleurs qualifiés. Les revenus tirés de prestations d’AE ont tendance à être plus petits pour les métiers du domaine des services comparativement à ceux de la construction.
Graphique 3.21 Revenu médian d’AE en 2009 selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
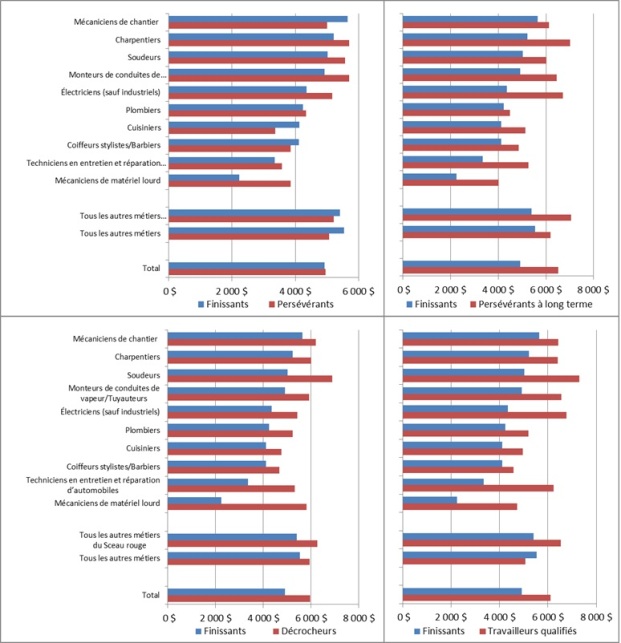
Description de l’image Graphique 3.21 Revenu médian d’AE en 2009 selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit de diagrammes en barres illustrant le revenu médian d’AE en 2009, selon le métier et le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes. Quatre graphiques comparent le revenu médian d’assurance-emploi des finissants aux autres catégories de groupes pour chaque métier examiné.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de chantier, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 5 647 $ pour les finissants; 5 002 $ pour les persévérants; 6 134 $ pour les persévérants à long terme; 6 204 $ pour les décrocheurs, et 6 432 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de charpentier, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 5 220 $ pour les finissants; 5 704 $ pour les persévérants; 7 008 $ pour les persévérants à long terme; 6 012 $ pour les décrocheurs, et 6 402 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de soudeur, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 5 025 $ pour les finissants; 5 570 $ pour les persévérants; 6 025 $ pour les persévérants à long terme; 6 883 $ pour les décrocheurs, et 7 286 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de monteur de conduites de vapeur, tuyauteur et installateur de réseaux de gicleurs, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 917 $ pour les finissants; 5 692 $ pour les persévérants; 6 454 $ pour les persévérants à long terme; 5 911 $ pour les décrocheurs, et 6 547 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier d’électricien (sauf industriel), le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 350 $ pour les finissants; 5 160 $ pour les persévérants; 6 703 $ pour les persévérants à long terme; 5 432 $ pour les décrocheurs, et 6 762 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de plombier, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 240 $ pour les finissants; 4 343 $ pour les persévérants; 4 483 $ pour les persévérants à long terme; 5 221 $ pour les décrocheurs, et 5 186 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de cuisinier, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 122 $ pour les finissants; 3 372 $ pour les persévérants; 5 144 $ pour les persévérants à long terme; 4 752 $ pour les décrocheurs, et 4 953 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 118 $ pour les finissants; 3 861 $ pour les persévérants; 4 866 $ pour les persévérants à long terme; 4 663 $ pour les décrocheurs, et 4 578 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 3 357 $ pour les finissants; 3 576 $ pour les persévérants; 5 276 $ pour les persévérants à long terme; 5 318 $ pour les décrocheurs, et 6 242 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du métier de mécanicien de matériel lourd, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 2 240 $ pour les finissants; 3 850 $ pour les persévérants; 4 018 $ pour les persévérants à long terme; 5 811 $ pour les décrocheurs, et 4 730 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les autres métiers désignés Sceau rouge, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 5 403 $ pour les finissants; 5 220 $ pour les persévérants; 7 057 $ pour les persévérants à long terme; 6 258 $ pour les décrocheurs, et 6 525 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les autres métiers, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 5 542 $ pour les finissants; 5 070 $ pour les persévérants; 6 197 $ pour les persévérants à long terme; 5 947 $ pour les décrocheurs, et 5 067 $ pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est de tous les métiers, le revenu médian d’assurance-emploi en 2009 était de 4 918 $ pour les finissants; 4 957 $ pour les persévérants; 6 525 $ pour les persévérants à long terme; 5 962 $ pour les décrocheurs, et 6 102 $ pour les travailleurs qualifiés.
Le graphique 3.22 présente le pourcentage de travailleurs ayant eu recours à l’AE, et ce, par province/territoire et selon les groupes définis du SIAI de 2008. Il importe de se rappeler que les données sur les prestations d’AE, recueillies en 2009 sur les persévérants de 2008, comprennent les prestations versées lors de la formation en classe ainsi que toutes les autres prestations régulières et celles versées en vertu de la partie II. Le graphique 3.22 ne présente pas de données sur les persévérants et les persévérants à long terme au Québec. Cela s’explique par le fait que le système d’apprentissage du Québec est conçu d’une telle manière que la formation en classe précède celle en cours d’emploi, ce qui ne donne généralement pas lieu au versement de prestations d’AE lors de la formation en classe.
Comme auparavant, ce sont les persévérants qui ont le plus souvent recours à l’AE, avec des chiffres atteignant 60 % à 70 % dans les provinces de l’Atlantique et 50 % dans les autres provinces, à l’exception de l’Ontario. Pour tous les autres groupes, le recours à l’AE est généralement plus élevé dans les provinces de l’Atlantique que dans les autres régions. Chez les finissants, les taux varient largement, passant de plus de 60 % au Québec à moins de 20 % en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
Graphique 3.22 Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009, par province/territoire et selon le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
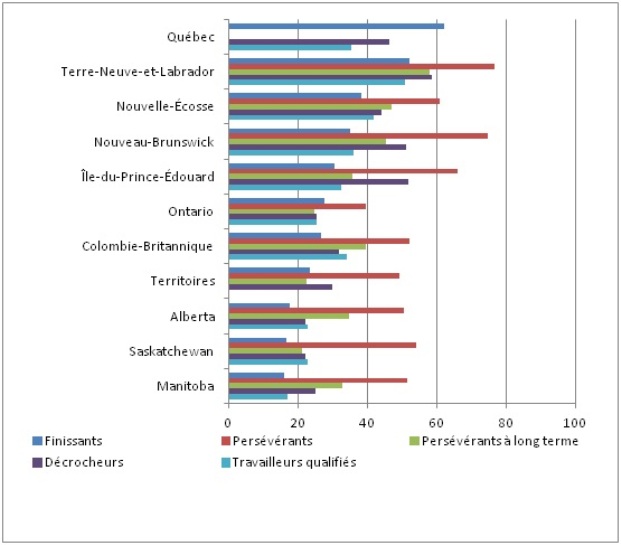
Description de l’image Graphique 3.22 Pourcentage rapportant un revenu d’AE en 2009, par province/territoire et selon le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le pourcentage qui a déclaré un revenu d’assurance-emploi (AE) en 2009, selon la province et le statut du SIAI de 2008. Les barres sont regroupées par provinces et territoires.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 52,1 % pour les finissants; 76,5 % pour les persévérants; 58,1 % pour les persévérants à long terme; 58,5 % pour les décrocheurs, et 50,9 % pour les travailleurs qualifiés.
En Nouvelle-Écosse, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 38,2 % pour les finissants; 61,0 % pour les persévérants; 46,8 % pour les persévérants à long terme; 44,2 % pour les décrocheurs, et 41,9 % pour les travailleurs qualifiés.
Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 35,2 % pour les finissants; 74,8 % pour les persévérants; 45,4 % pour les persévérants à long terme; 51,1 % pour les décrocheurs, et 36,1 % pour les travailleurs qualifiés.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 30,4 % pour les finissants; 66,1 % pour les persévérants; 35,6 % pour les persévérants à long terme; 51,7 % pour les décrocheurs, et 32,4 % pour les travailleurs qualifiés.
En Ontario, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 27,5 % pour les finissants; 39,7 % pour les persévérants; 24,7 % pour les persévérants à long terme; 25,5 % pour les décrocheurs, et 25,2 % pour les travailleurs qualifiés.
Au Québec, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 62,1 % pour les finissants; 46,3 % pour les décrocheurs, et 35,3 % pour les travailleurs qualifiés.
Au Manitoba, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 16,1 % pour les finissants; 51,4 % pour les persévérants; 32,9 % pour les persévérants à long terme; 25,1 % pour les décrocheurs, et 17,1 % pour les travailleurs qualifiés.
En Saskatchewan, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 16,5 % pour les finissants; 54,0 % pour les persévérants; 21,2 % pour les persévérants à long terme; 22,2 % pour les décrocheurs, et 22,7 % pour les travailleurs qualifiés.
En Alberta, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 17,5 % pour les finissants; 50,5 % pour les persévérants; 34,8 % pour les persévérants à long terme; 22,0 % pour les décrocheurs, et 22,9 % pour les travailleurs qualifiés.
En Colombie-Britannique, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 26,8 % pour les finissants; 52,1 % pour les persévérants; 39,6 % pour les persévérants à long terme; 31,9 % pour les décrocheurs, et 34,0 % pour les travailleurs qualifiés.
Dans les Territoires, le pourcentage qui a déclaré un revenu d’AE suivant a été observé en 2009 : 23,5 % pour les finissants; 49,3 % pour les persévérants; 22,6 % pour les persévérants à long terme, et 29,9 % pour les décrocheurs. Aucune information n’a été fournie pour les travailleurs qualifiés.
Remarque : les persévérants et les persévérants à long terme du Québec sont absents, car le régime d’apprentissage du Québec est conçu de manière à ce que la formation en classe ait lieu avant la formation en cours d’emploi, ce qui ne permet pas, habituellement, d’obtenir des prestations d’AE pendant la formation en classe.
Le graphique 3.23 présente le montant total des revenus tirés de prestations de l’AE en 2009 pour les cinq groupes définis, et ce, par province/territoire. On observe encore des différences considérables. Ceux de Terre-Neuve-et-Labrador ont touché le plus de prestations, peu importe le niveau d'achèvement. Tandis que pour la plupart des groupes, ceux de la Saskatchewan en ont le moins reçu. Le montant des prestations était généralement plus faible chez les finissants. Les différences entre les autres groupes étaient plus petites et attribuables à l’emplacement.
Graphique 3.23 Revenu médian d’AE de 2009, par province/territoire et selon le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
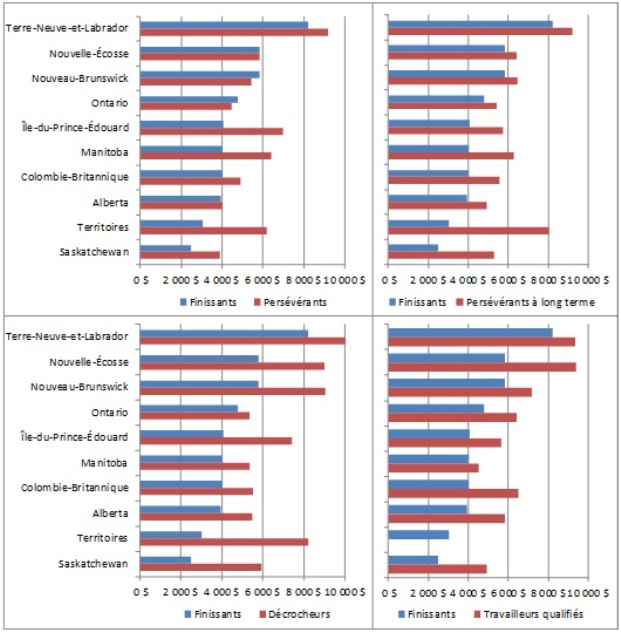
Description de l’image Graphique 3.23 Revenu médian d’AE de 2009, par province/territoire et selon le statut de 2008 : finissants par rapport aux autres groupes [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit de diagrammes en barres illustrant le revenu d’assurance-emploi en 2009, selon les provinces et les territoires ainsi que le statut du SIAI de 2008 : les finissants par rapport aux autres groupes. Quatre graphiques comparent le revenu médian d’assurance-emploi des finissants à celui des autres catégories de groupes pour chaque province et territoire examiné.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 8 202 $ pour les finissants; 9 156 $ pour les persévérants; 9 224 $ pour les persévérants à long terme; 10 506 $ pour les décrocheurs, et 9 335 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Nouvelle-Écosse, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 5 811 $ pour les finissants; 5 827 $ pour les persévérants; 6 394 $ pour les persévérants à long terme; 8 999 $ pour les décrocheurs, et 9 387 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Nouveau-Brunswick, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 5 811 $ pour les finissants; 5 427 $ pour les persévérants; 6 453 $ pour les persévérants à long terme; 9 049 $ pour les décrocheurs, et 7 160 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Ontario, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 4 785 $ pour les finissants; 4 470 $ pour les persévérants; 5 428 $ pour les persévérants à long terme; 5 344 $ pour les décrocheurs, et 6 404 $ pour les travailleurs qualifiés.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 4 062 $ pour les finissants; 6 964 $ pour les persévérants; 5 742 $ pour les persévérants à long terme; 7 423 $ pour les décrocheurs, et 5 651 $ pour les travailleurs qualifiés.
Au Manitoba, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 4 023 $ pour les finissants; 6 407 $ pour les persévérants; 6 258 $ pour les persévérants à long terme; 5 337 $ pour les décrocheurs, et 4 508 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Colombie-Britannique, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 4 023 $ pour les finissants; 4 917 $ pour les persévérants; 5 561 $ pour les persévérants à long terme; 5 512 $ pour les décrocheurs, et 6 513 $ pour les travailleurs qualifiés.
En Alberta, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 3 944 $ pour les finissants; 4 023 $ pour les persévérants; 4 917 $ pour les persévérants à long terme; 5 473 $ pour les décrocheurs, et 5 811 $ pour les travailleurs qualifiés.
Dans les Territoires, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 3 045 $ pour les finissants; 6 174 $ pour les persévérants; 8 048 $ pour les persévérants à long terme, et 8 210 $ pour les décrocheurs.
En Saskatchewan, le revenu médian d’assurance-emploi suivant a été observé en 2009 : 2 481 $ pour les finissants; 3 889 $ pour les persévérants; 5 270 $ pour les persévérants à long terme; 5 918 $ pour les décrocheurs, et 4 937 $ pour les travailleurs qualifiés.
Il est particulièrement difficile d’interpréter les revenus tirés de prestations d’AE, car ces revenus dépendent tout aussi bien du montant gagné lors d’une période de travail que du nombre de semaines de prestations. De plus, ils varient également selon la province ou le territoire, ou même selon la région précise, du prestataire. Bien qu’il soit impossible de discerner les divers facteurs, il est possible d’avoir une bonne vue d’ensemble. Les prestations sont une source partielle de revenu pour un important nombre de gens de métiers.
3.3.6 Différences entre le revenu des hommes et des femmes
Les écarts de revenu entre les sexes ont déjà fait l’objet d’études (p. ex., Ahmed, 2010; Gunderson et Krashinsky, 2012). Cet écart est principalement attribuable au grand nombre de femmes dans quelques métiers à faible revenu, plus particulièrement ceux de coiffeuses-stylistes et de cuisinières. Certains éléments (Boothby et Drewes, 2010) portent à croire que cet écart est inversé lorsqu’il est question des quelques femmes dans les métiers traditionnellement dominés par les hommes. Une fois de plus, les fichiers couplés nous permettent d’approfondir ce sujet plus en détail à l’aide de données précises sur les revenus, tirées des dossiers sur l'impôt sur le revenu.
Dans le but de simplifier la présentation, et en raison du petit nombre de femmes dans certains groupes (en particulier celui de travailleuses qualifiées), les résultats comparatifs ne sont fournis que pour les hommes et les femmes dans le groupe des finissants et pour des groupes de métiers plus généraux que ceux utilisés dans les précédents résultats.
Le graphique 3.24 fournit les tendances chronologiques du revenu d’emploi pour les hommes et les femmes ayant terminé un programme d’apprenti en 2004, sur une période allant de 2002 à 2009. Pour les métiers de coiffeurs-stylistes/barbiers et de cuisiniers, il y a bien peu de différences jusqu’en 2004, tandis que les hommes et les femmes étaient encore des apprentis. Après cette période, l’écart est plus prononcé en faveur des hommes et ne cesse de s’élargir lors des années suivantes, jusqu’à atteindre plus de 7 000 $. Pour tous les autres métiers figurant sur la liste des dix métiers les plus populaires (au sein desquels les femmes ne représentent qu’environ 1 % des finissants), les écarts sont moindres. Pour tous les autres métiers désignés Sceau rouge (moins de 2 % des finissants sont des femmes), les femmes touchent un salaire plus élevé que les hommes après 2005, soit une année ou plus après avoir terminé leur apprentissage. Ces résultats sont semblables aux constatations de Boothby et Drewes (2010). Cependant, pour tous les autres métiers qui ne sont pas désignés Sceau rouge et au sein desquels les femmes représentent 20 % des finissants, l’écart en faveur des hommes et plus important et prend de l’ampleur au fil du temps. Bien que ces résultats n’expliquent pas pourquoi les femmes gagnent plus que les hommes dans certains métiers dominés par ces derniers, ils démontrent que ces métiers proposent un avantage salarial intéressant aux femmes, comparativement à ceux où les femmes sont plus susceptibles de participer.
Graphique 3.24 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009 pour les finissants de 2004 en fonction du sexe, pour des métiers choisis [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
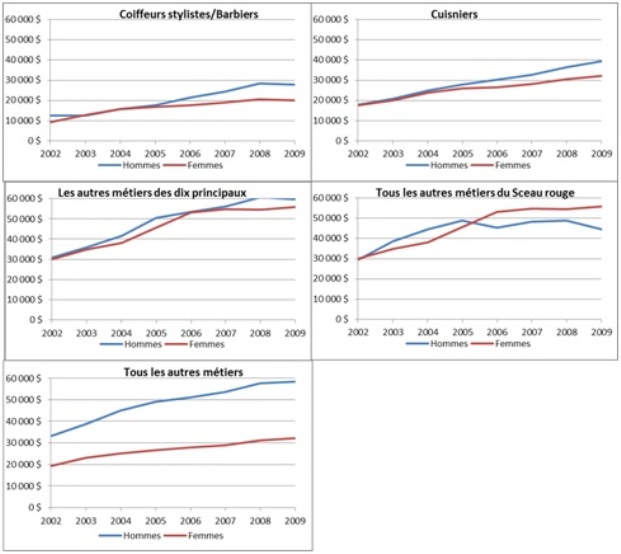
Description de l’image Graphique 3.24 Revenu d’emploi médian de 2002 à 2009 pour les finissants de 2004 en fonction du sexe, pour des métiers choisis [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le revenu d’emploi médian de 2002 à 2009 pour les finissants de 2004, en fonction du sexe. Cinq graphiques sont disponibles, un pour chaque métier ou groupe de métier examiné. Chaque graphique a une ligne pour les hommes et une ligne pour les femmes.
Pour le métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu d’emploi médian des hommes était de 12 549 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 28 331 $ en 2008, et a ensuite diminué à 27 799 $ en 2009. Pour le métier de coiffeur-styliste et barbier, le revenu d’emploi médian des femmes était de 9 160 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 20 669 $ en 2008 et a ensuite diminué à 20 165 $ en 2009.
Pour le métier de cuisinier, le revenu d’emploi médian des hommes était de 17 875 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 39 306 $ en 2009. Pour le métier de cuisinier, le revenu d’emploi médian des femmes était de 17 636 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 32 028 $ en 2009.
Pour les dix autres métiers principaux, le revenu d’emploi médian des hommes était de 30 910 $ en 2002; 36 031 $ en 2003; 41 521 $ en 2004; 50 570 $ en 2005; 53 324 $ en 2006; 56 176 $ en 2007; 60 600 $ en 2008, et 59 645 $ en 2009. Pour les dix autres métiers principaux, le revenu d’emploi médian des femmes était de 30 071 $ en 2002; 34 717 $ en 2003; 38 003 $ en 2004; 45 597 $ en 2005; 53 101 $ en 2006; 54 832 $ en 2007; 54 407 $ en 2008, et 55 950 $ en 2009.
Pour tous les autres métiers désignés Sceau rouge, le revenu d’emploi médian des hommes était de 33 677 $ en 2002; 39 943 $ en 2003; 44 031 $ en 2004; 52 087 $ en 2005; 54 041 $ en 2006; 56 868 $ en 2007; 59 862 $ en 2008, et 57 567 $ en 2009. Pour tous les autres métiers désignés Sceau rouge, le revenu d’emploi médian des femmes était de 29 534 $ en 2002; 38 733 $ en 2003; 44 444 $ en 2004; 48 886 $ en 2005; 45 254 $ en 2006; 48 209 $ en 2007; 48 762 $ en 2008, et 44 516 $ en 2009.
Pour tous les autres métiers, le revenu d’emploi médian des hommes était de 33 205 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 58 292 $ en 2009. Pour tous les autres métiers, le revenu d’emploi médian des femmes était de 19 191 $ en 2002 et a augmenté de façon constante pour atteindre 32 260 $ en 2009.
3.3.7 Mobilité
La mobilité interprovinciale des gens de métiers est un résultat important, car l’un des objectifs principaux du programme du Sceau rouge est de faciliter cette mobilité. L’emploi dans les métiers, et plus particulièrement dans ceux liés au secteur de la construction, est généralement irrégulier et l’emplacement des projets de grande envergure change au fil du temps. Il est donc très important de disposer d’une main-d’œuvre hautement mobile afin de répondre à l’offre et à la demande.
Le fichier couplé SIAI/FFT1 nous permet de déterminer au sein de quelle province ou de quel territoire un individu s’est inscrit en tant qu’apprenti ou s’est présenté à l’examen en tant que travailleur qualifié. Il indique également la province ou le territoire de résidence à la fin de chaque année, de 2002 à 2009. Jumeler ces deux variables permet d’établir une matrice qui vient préciser la province ou le territoire d’origine ou de destination, ce qui révèle alors si un travailleur fut mobile ou non pendant la période étudiée. La variable sur la mobilité peut ainsi être examinée en tant que fonction de la situation d’apprentissage ou de reconnaissance professionnelle.
Le graphique 3.25 nous donne une idée générale du pourcentage de travailleurs des groupes définis du SIAI de 2008 qui, en 2009, se situaient dans une province différente de celle où ils s’étaient inscrits. Selon ces données, les taux de mobilité interprovinciale sont plus faibles pour les finissants, les persévérants et les persévérants à long terme que pour les travailleurs qualifiés et les décrocheurs.
Il est utile de considérer la mobilité selon le type de certificat reçu puisque l’un des objectifs du certificat Sceau rouge est de faciliter la mobilité. Le graphique 3.26 affiche les tendances pour les groupes définis de 2004 à 2009, selon le type de certificat obtenu, et pour les personnes n’ayant pas de certificat en 2008. Somme toute, il y a une chute de la mobilité dans tous les groupes lors des premières années suivies d’une augmentation au cours des années suivantes. Ce sont encore les travailleurs qualifiés qui furent les plus mobiles pendant toute la période couverte. Cependant, la mobilité des travailleurs qualifiés avec un certificat Sceau rouge en 2008 a augmenté à compter de 2007, tandis qu’elle a légèrement freiné pour ceux sans cette mention. Les personnes ne détenant aucun certificat en 2008 (un groupe compris de persévérants et de décrocheurs) étaient en fait plus mobiles que les apprentis finissants (avec ou sans certificat Sceau rouge) pendant toute cette période. La mobilité des apprentis avec la mention Sceau rouge augmenta plus rapidement à compter de 2006 par rapport à ceux sans la mention.
Graphique 3.25 Pourcentage résidant dans une province autre que celle de l’inscription en 2009, selon le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
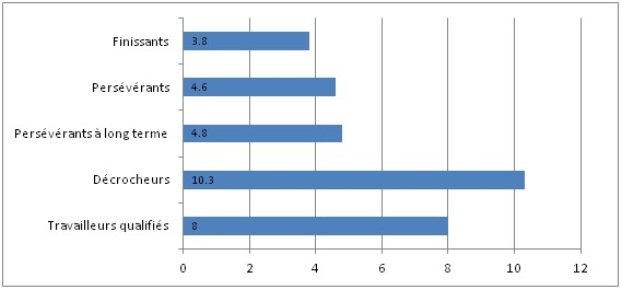
Description de l’image Graphique 3.25 Pourcentage résidant dans une province autre que celle de l’inscription en 2009, selon le statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription en 2009, selon le statut de 2008.
En 2009, le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription était de 3,8 % pour les finissants, 4,6 % pour les persévérants, 4,8 % pour les persévérants à long terme, 10,3 % pour les décrocheurs et 8,0 % pour les travailleurs qualifiés.
Graphique 3.26 Pourcentage résidant dans une province autre que celle de l’inscription, de 2004 à 2009, selon le type de certificat remis en 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
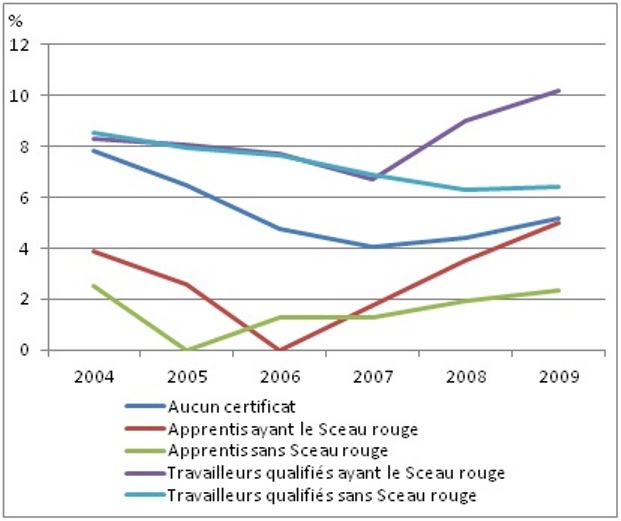
Description de l’image Graphique 3.26 Pourcentage résidant dans une province autre que celle de l’inscription, de 2004 à 2009, selon le type de certificat remis en 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription selon le type de certificat reçu en 2008. Les années couvertes par le graphique vont de 2004 à 2009.
Le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription pour celles qui n’ont pas de certificat était de 7,8 % en 2004; 6,5 % en 2005; 4,8 % en 2006; 4,0 % en 2007; 4,4 % en 2008, et 5,2 % en 2009.
Le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge était de 3,9 % en 2004; 2,6 % en 2005; 0,0 % en 2006; 1,8 % en 2007; 3,5 % en 2008, et 5,0 % en 2009.
Le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription pour les apprentis n’ayant pas de certificat portant la mention Sceau rouge était de 2,5 % en 2004; 0 % en 2005; 1,3 % en 2006; 1,3 % en 2007; 1,9 % en 2008, et 2,3 % en 2009.
Le pourcentage de travailleurs qualifiés habitant une province autre que leur province d’inscription et ayant un certificat portant la mention Sceau rouge était de 8,3 % en 2004; 8,1 % en 2005; 7,7 % en 2006; 6,7 % en 2007; 9,0 % en 2008, et 10,2 % en 2009.
Le pourcentage de travailleurs qualifiés habitant une province autre que leur province d’inscription et n’ayant pas de certificat portant la mention Sceau rouge était de 8,5 % en 2004; 7,9 % en 2005; 7,6 % en 2006; 6,9 % en 2007; 6,3 % en 2008, et 6,4 % en 2009.
Le graphique 3.27 présente les pourcentages de personnes qui, en 2009, demeuraient dans une province autre que celle où elles s’étaient inscrites. Les résultats sont répartis en fonction de trois groupes définis du SIAI de 2008, par province d’inscription. Ces pourcentages représentent le taux de mobilité vers l’extérieur des provinces d’inscription par rapport au nombre total de travailleurs dans chacun des groupes au sein de cette même province. Dans l’ensemble du Canada et pour sept provinces sur dix, les taux de mobilité vers l’extérieur pour les travailleurs qualifiés avec la mention Sceau rouge sont plus élevés que ceux des apprentis finissants ou ceux des personnes sans certificat. Les taux de mobilité chez ces deux derniers groupes sont semblables. La mobilité vers l’extérieur est relativement faible pour tous les groupes en Saskatchewan et au Manitoba, et elle est particulièrement faible pour ceux sans certificat et pour les apprentis finissants avec la mention Sceau rouge au Québec.
Graphique 3.27 Pourcentage résidant en 2009 à l’extérieur de la province d’inscription en fonction de celle-ci et du statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
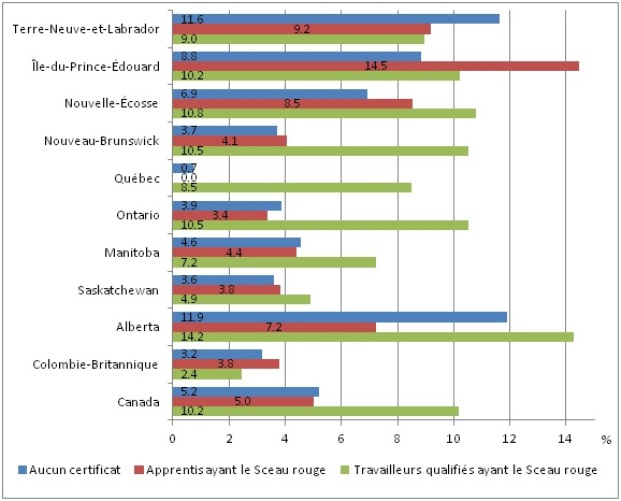
Description de l’image Graphique 3.27 Pourcentage résidant en 2009 à l’extérieur de la province d’inscription en fonction de celle-ci et du statut de 2008 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un graphique linéaire simple illustrant le pourcentage de personnes habitant une province autre que leur province d’inscription en 2009, selon la province d’inscription et le statut de 2008. Les lignes sont regroupées en fonction des provinces et des Territoires.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 11,6 % pour les personnes non certifiées, 9,2 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 9,0 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 8,8 % pour les personnes non certifiées, 14,5 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 10,2 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
En Nouvelle-Écosse, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 6,9 % pour les personnes non certifiées, 8,5 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 10,8 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 3,7 % pour les personnes non certifiées, 4,1 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 10,5 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
Au Québec, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 0,7 % pour les personnes non certifiées, 0,0 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 8,5 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
En Ontario, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 3,9 % pour les personnes non certifiées, 3,4 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 10,5 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
Au Manitoba, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 4,6 % pour les personnes non certifiées, 4,4 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 7,2 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
En Saskatchewan, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 3,6 % pour les personnes non certifiées, 3,8 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 4,9 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
En Alberta, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 11,9 % pour les personnes non certifiées, 7,2 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 14,2 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
En Colombie-Britannique, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 3,2 % pour les personnes non certifiées, 3,8 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 2,4 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
Au Canada, le pourcentage suivant de personnes vivant dans la province qui ont une autre province d’inscription a été observé en 2009 : 5,2 % pour les personnes non certifiées, 5,0 % pour les apprentis ayant un certificat portant la mention Sceau rouge et 10,2 % pour les travailleurs qualifiés ayant un certificat portant la mention Sceau rouge.
Le graphique 3.28 vient compléter le graphique 3.25, en mettant l’accent sur la province de destination plutôt que d’origine. Les pourcentages représentent le rapport entre le nombre d’entrants et le nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination. Les travailleurs qualifiés avec la mention Sceau rouge sont encore une fois les travailleurs les plus mobiles. Toutefois, la tendance de mobilité vers l’intérieur est différente de celle vers l’extérieur. L’Ontario et le Québec accueillent relativement peu de travailleurs de l’extérieur par rapport à leur nombre total d’apprentis inscrits. Il est fort probable que cette situation soit le reflet du grand nombre d’apprentis inscrits dans ces provinces par rapport au nombre de travailleurs potentiels provenant d’autres provinces. Les trois provinces des Prairies accueillent la plus grande portion de travailleurs qualifiés avec la mention Sceau rouge, tandis que les provinces de l’Atlantique et la Saskatchewan sont les provinces privilégiées par les apprentis finissants avec la mention Sceau rouge.
Graphique 3.28 Province de destination en 2009 selon le statut d’appartenance à un groupe en 2008 comme un pourcentage de chaque groupe au sein de la province de destination [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
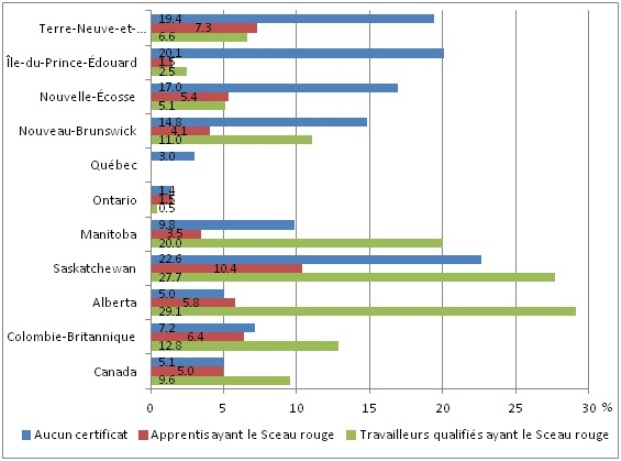
Description de l’image Graphique 3.28 Province de destination en 2009 selon le statut d’appartenance à un groupe en 2008 comme un pourcentage de chaque groupe au sein de la province de destination [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant les provinces de destination en 2009, selon le statut d’appartenance à un groupe en 2008 comme un pourcentage de chaque groupe au sein de la province de destination. Les barres sont regroupées selon la province.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 19,4 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 7,3 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 6,6 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 20,1 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 1,5 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 2,5 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
En Nouvelle-Écosse, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 17,0 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 5,4 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 5,1 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 14,8 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 4,1 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 11,0 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
Au Québec, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 3,0 % pour ceux qui n’ont aucun certificat.
En Ontario, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 1,4 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 1,5 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 0,5 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
Au Manitoba, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 9,8 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 3,5 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 20,0 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
En Saskatchewan, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 22,6 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 10,4 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 27,7 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
En Alberta, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 5,0 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 5,8 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 29,1 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
En Colombie-Britannique, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 7,2 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 6,4 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 12,8 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
Au Canada, le pourcentage d’entrants par rapport au nombre total d’apprentis inscrits dans la province de destination en 2009 était de 5,1 % pour ceux qui n’ont aucun certificat; 5,0 % pour les apprentis ayant le Sceau rouge, et 9,6 % pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge.
La mobilité peut être examinée à long terme en observant la mobilité des travailleurs du SIAI de 2004, et ce, de 2004 à 2009. Le graphique 3.29 présente les résultats de la mobilité vers l’extérieur pour les six provinces disposant de données individuelles pour 2004, sous forme de pourcentage pour tous les travailleurs mobiles. Les taux de mobilité varient considérablement selon le type de certificat et la province. Somme toute, ce fut la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui affichèrent les plus hauts taux de mobilité vers l’extérieur. Pour ce qui est des travailleurs sans certificat, la mobilité vers l’extérieur fut plus élevée en Saskatchewan et au Manitoba qu’au Québec et en Ontario. Il en va principalement de même pour ce qui est des apprentis avec la mention Sceau rouge et ceux sans cette mention, bien que la mobilité vers l’extérieur soit particulièrement plus élevée en Nouvelle-Écosse chez les apprentis sans la mention par rapport à ceux avec la mention. Le plus important taux de mobilité vers l’extérieur somme toute, et celui présentant le plus grand écart entre les provinces, fut observé chez les travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge. En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec, la mobilité vers l’extérieur de ces travailleurs est considérablement plus élevée que chez ceux avec la mention.
Graphique 3.29 Pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009, selon le type de certificat en 2004 et la province d’origine [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
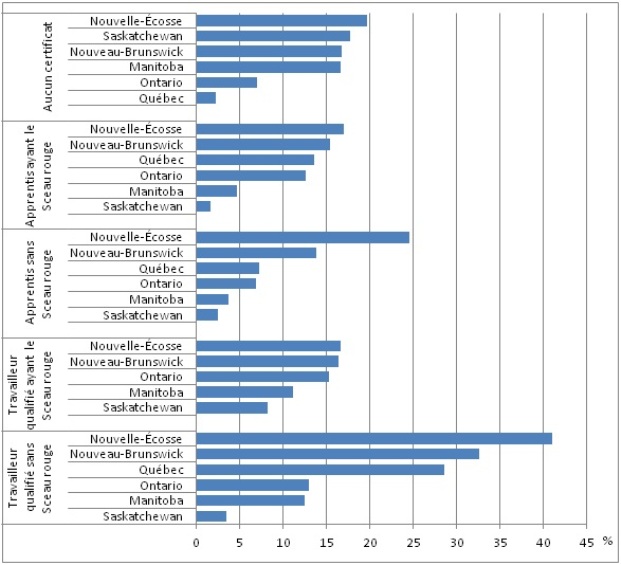
Description de l’image Graphique 3.29 Pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009, selon le type de certificat en 2004 et la province d’origine [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009, selon le type de certificat et la province d’origine en 2004. Les barres sont regroupées selon le type de certificats.
Pour ceux qui n’ont pas de certificat, le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009 selon leur province d’origine était de 19,6 % en Nouvelle-Écosse; 17,7 % en Saskatchewan; 16,7 % au Nouveau-Brunswick; 16,6 % au Manitoba; 6,9 % en Ontario, et 2,3 % au Québec.
Pour les apprentis ayant le Sceau rouge, le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009 selon leur province d’origine était de 17,0 % en Nouvelle-Écosse, 15,4 % au Nouveau-Brunswick, 13,5 % au Québec, 12,5 % en Ontario, 4,7 % au Manitoba, et 1,6 % en Saskatchewan.
Pour les apprentis sans Sceau rouge, le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009 selon leur province d’origine était de 24,5 % en Nouvelle-Écosse; 13,8 % au Nouveau-Brunswick; 7,3 % au Québec; 6,9 % en Ontario; 3,7 % au Manitoba, et 2,5 % en Saskatchewan.
Pour les travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge, le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009 selon leur province d’origine était de 16,7 % en Nouvelle-Écosse; 16,4 % au Nouveau-Brunswick; 15,3 % en Ontario; 11,2 % au Manitoba, et 8,2 % en Saskatchewan.
Pour les travailleurs qualifiés sans Sceau rouge, le pourcentage de travailleurs mobiles de 2004 à 2009 selon leur province d’origine était de 41,0 % en Nouvelle-Écosse; 32,6 % au Nouveau-Brunswick; 28,57 % au Québec; 13,0 % en Ontario; 12,4 % au Manitoba, et 3,4 % en Saskatchewan.
Le graphique 3.30 vient compléter le graphique 3.29 en fournissant des données sur la mobilité vers l’intérieur. Les trois principales destinations sont données alors que les autres sont combinées. La somme de tous les pourcentages dans le graphique qui suit est de 100 %, car toutes les provinces représentent une destination. Cependant, on rappelle que ce 100 % désigne les travailleurs qui ont quitté l’une des six provinces d’origine énumérées. La tendance est évidente : l’Alberta est la destination principale pour tous les groupes, à l’exception des travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge. En effet, 40 % à 60 % des migrants de quatre groupes sur cinq ont choisi cette province. La Colombie-Britannique arrive en seconde place, avec des résultats moins considérables que ceux observés en Alberta. Bien que le Québec ne soit pas une destination principale pour la plupart des groupes, la province attire tout de même un nombre plus élevé de travailleurs qualifiés sans la mention Sceau rouge que les deux destinations principales.
Graphique 3.30 Provinces de destination pour les travailleurs mobiles de 2004 à 2009, en fonction du groupe de certification en 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
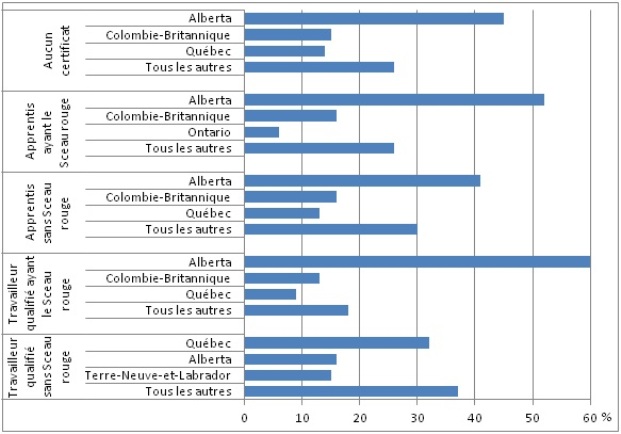
Description de l’image Graphique 3.30 Provinces de destination pour les travailleurs mobiles de 2004 à 2009, en fonction du groupe de certification en 2004 [Source : données couplées du SIAI/FFT1]
Il s’agit d’un diagramme en barres qui illustre la province de destination pour ces travailleurs mobiles, de 2004 à 2009, selon le groupe de certificat en 2004. Les barres sont regroupées selon le type de certificats.
Pour ce qui est de ceux qui n’ont aucun certificat, les provinces de destination de choix étaient l’Alberta, à raison de 45 %; la Colombie-Britannique avec 15 %; le Québec avec 14 %, et les autres provinces avec 26 %.
Pour ce qui est des apprentis ayant le Sceau rouge, les provinces de destination de choix étaient l’Alberta, à raison de 52 %; la Colombie-Britannique avec 16 %; l’Ontario avec 6 %; et les autres provinces avec 26 %.
Pour ce qui est des apprentis sans Sceau rouge, les provinces de destination de choix étaient l’Alberta, à raison de 41 %; la Colombie-Britannique avec 16 %; le Québec avec 13 %, et les autres provinces avec 30 %.
Pour ce qui est des travailleurs qualifiés ayant le Sceau rouge, les provinces de destination de choix étaient l’Alberta, à raison de 60 %; la Colombie-Britannique avec 13 %; le Québec avec 9 %, et les autres provinces avec 18 %.
Pour ce qui est des travailleurs qualifiés sans Sceau rouge, les provinces de destination de choix étaient le Québec, à raison de 32 %; l’Alberta avec 16 %; Terre-Neuve-et-Labrador avec 15 %, et les autres provinces avec 37 %.
3.4 Modélisation des résultats sur le marché du travail
3.4.1 Modélisation par régression
Les résultats sur le marché du travail sont déterminés par un grand nombre de variables autres que les professions et les provinces ou territoires. Par exemple, les femmes gagnent généralement moins que les hommes dans plusieurs professions. Semblablement, les revenus peuvent découler de l’âge et de l’expérience et, encore plus important dans le cadre de cette étude, des titres de compétences. Il est difficile de distinguer les incidences propres à un facteur puisqu’ils interagissent tous les uns avec les autres.
Pour aborder ce type de situation complexe, l’approche analytique la plus souvent utilisée est l’analyse de régression multiple. Dans cette section, nous présentons des modèles de régression pour les groupes définis de 2004 et 2008. Nous avons eu recours aux revenus d’emploi en tant qu’indicateur de résultats et aux variables professionnelles et démographiques en tant que variables explicatives. La variable explicative d’intérêt est le groupe du SIAI, soit de 2004 ou 2008, définie par cinq variables dichotomiques (codées 1,0), représentant les cinq groupes définis. Les variables contrôlées sont le sexe, l’âge, le métier et la province ou le territoire (également codées en tant que série de variables dichotomiques). Il ne fut pas possible d’inclure le plus haut niveau de scolarité atteint, les handicaps et l’appartenance à un groupe autochtone, car les données du SIAI sur ces variables étaient de piètre qualité.
Les coefficients utilisés dans ces modèles représentent essentiellement la différence en dollars courants entre les revenus d’emploi de chaque groupe défini. Les variables explicatives susmentionnées sont quant à elles contrôlées. Les résultats diffèrent donc de ceux présentés dans les sections précédentes, car les incidences des variables qui ne sont pas liées aux groupes définis ne sont pas utilisées dans ce modèle. Les incidences faisant l’objet du rapport viennent donc s’ajouter à celles liées au sexe, à l’âge, au métier et à la province ou au territoire. Les incidences découlant de ces dernières variables sont présentées dans l’ensemble complet des coefficients du modèle, compris dans les tableaux A3.1 et A3.2 de l’annexe A.
3.4.2 Modèle du SIAI de 2008
Le graphique 3.31 affiche les coefficients de régression pour les revenus d’emplois de 2009, en fonction des groupes définis du SIAI de 2008. Ils sont exprimés sous forme de variations marginales en dollars, à partir du revenu moyen (34 885 $) des persévérants.Note de bas de page 22 Ce « modèle de groupe » est un modèle au sein duquel les variables liées aux groupes définis sont regroupées. Par contre, les autres modèles ne sont pas contrôlés. Il s’agit là d’une méthode tout aussi efficace que de calculer séparément les revenus d’emploi moyens pour chaque groupe. Le modèle « complet » est un modèle pour lequel l’âge, le sexe, la province ou le territoire, et le métier (les dix métiers les plus importants et tous les autres) sont contrôlés.Note de bas de page 23 Le changement de coefficients d’un modèle de groupe à un modèle complet est une mesure de l'incidence découlant du fait de contrôler les autres variables relativement aux variables principales (groupes définis).
Graphique 3.31 Coefficients de régression pour le revenu d’emploi de 2009 selon le statut de 2008, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier, de la région
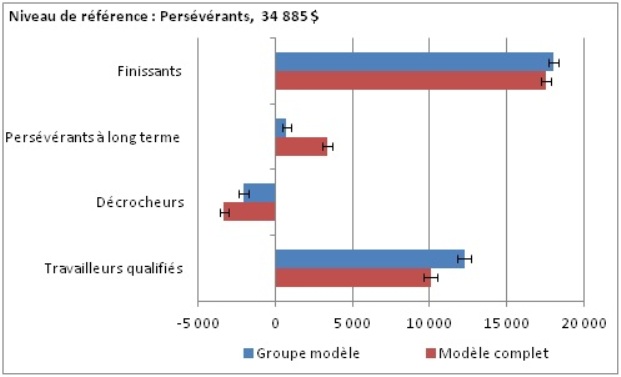
Description de l’image Graphique 3.31 Coefficients de régression pour le revenu d’emploi de 2009 selon le statut de 2008, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier, de la région
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant les coefficients de régression pour le revenu d’emploi de 2009, selon le statut de 2008, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier et de la région. Le niveau de référence est celui de persévérants (34 885 $). Chaque ensemble de données compte une petite barre représentant un écart-type.
Pour ce qui est du groupe modèle, les coefficients sont de 18 004 pour les finissants; 728 pour les persévérants à long terme; (-2 084) pour les décrocheurs, et 12 249 pour les travailleurs qualifiés. Pour ce qui est du modèle complet, les coefficients sont de 17 512 pour les finissants; 3 372 pour les persévérants à long terme; (-3 314) pour les décrocheurs, et 10 050 pour les travailleurs qualifiés.
Comme prévu, les résultats démontrent que les finissants jouissent des avantages salariaux les plus importants, soit près de 18 000 $ de plus que les persévérants. Cette somme est essentiellement la même que celle indiquée dans le graphique 3.12. Le montant ne change que très légèrementNote de bas de page 24 lorsque d’autres variables sont contrôlées. Les travailleurs qualifiés viennent en seconde place, touchant environ 12 000 $ lorsque les variables ne sont pas contrôlées. Cette somme diminue de façon importante pour se chiffrer à environ 10 000 $ si les variables sont contrôlées. Cette situation peut être attribuable à un facteur comme l’âge, puisqu’il est probablement plus bénéfique pour un travailleur qualifié d’être plus âgé, l’âge pouvant être synonyme d’expérience.
Les persévérants à long terme ne touchent qu’un très petit avantage (environ 700 $) par rapport aux autres persévérants du modèle de groupe. Cette somme augmente cependant de manière considérable, atteignant environ 3 400 $, si d’autres variables sont contrôlées. Toutefois, l’avantage de ce groupe est bien loin de celui des finissants.
Le salaire des décrocheurs se retrouve réduit d’environ 2 000 $ par rapport aux persévérants. L’écart avec les finissants est encore plus profond, pouvant atteindre jusqu’à 3 300 $ si l’on tient compte d’autres variables. Ces résultats sont intéressants, car ils indiquent qu’il est plus avantageux pour les apprentis de demeurer dans le programme que de décrocher.
Bien que ces modèles permettent de dresser un portrait relativement précis des écarts entre les salaires des travailleurs des divers groupes définis, il est important de souligner qu’aucune des variables comprises dans le modèle ne contribue véritablement aux écarts salariaux. En effet, ceci peut être démontré en examinant le « pouvoir de prédiction » du modèle en tant que statistique connue sous le nom de carré du coefficient de corrélation multiple (R2). Les valeurs de R2 peuvent varier de zéro, si le modèle n’a aucun pouvoir de prédiction (par exemple, si toutes les variables explicatives sont des chiffres aléatoires), à un, si les variables peuvent parfaitement prédire le résultat. R2 est perçu en tant que « proportion de variation ». Cette proportion est comptabilisée selon les variables du modèle.
Le graphique 3.32 donne la valeur de R2 pour chacun des groupes de variables dans le modèle, de manière séparée plutôt que cumulative. Cette situation démontre qu’une fois considéré séparément, chaque groupe n’est responsable que d’une très petite proportion de l’écart total. Plus particulièrement, le sexe, le métier et la province ou le territoire ont une plus grande répercussion que les groupes définis. Le modèle complet a un plus grand pouvoir de prédiction, révélant ainsi que les ensembles de variables agissent en grande partie de manière cumulative. On peut donc déduire que les revenus d’emploi sont influencés par une multitude de facteurs, mais encore plus par les métiers, la province et le territoire que par les groupes définis, l’âge et le sexe.
Graphique 3.32 Proportions de la variance des revenus d’emploi comptabilisés par les groupes de variables dans le modèle
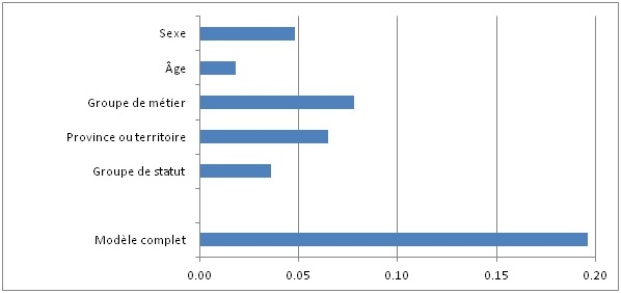
Description de l’image Graphique 3.32 Proportions de la variance des revenus d’emploi comptabilisés par les groupes de variables dans le modèle
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant les proportions de la variance des revenus d’emploi comptabilisés par les groupes de variables dans le modèle.
La proportion de variances des différents groupes de variables dans le modèle est la suivante 0,048 pour le sexe; 0,018 pour l’âge; 0,078 pour le groupe de métier; 0,065 pour la province ou le territoire; 0,036 pour le groupe de statut, et 0,196 pour le modèle complet.
3.4.3 Modèle du SIAI de 2004
Le graphique 3.33 illustre les coefficients de régression des revenus d’emploi pour l’année 2009, cinq ans après l’achèvement de l’apprentissage chez les groupes définis du SIAIS 2004. Ces résultats indiquent un salaire inférieur d’environ 12 000 $ par rapport au modèle précédent pour les finissants en relation aux persévérants dans le modèle de groupe. La baisse représente un peu plus de 10 000 $ lorsque l’on vérifie les autres variables. Encore une fois, les travailleurs qualifiés reçoivent un avantage de salaire un peu plus bas, soit d’un peu plus de 8 500 $ sans vérification des autres variables, et d’environ 6 200 $ avec vérification.
Dans ce cas, les persévérants à long terme ont un revenu un peu plus faible que les persévérants dans le modèle de groupe, et on n’observe aucune différence importante à l’échelle statistique dans le modèle complet. Le revenu d’emploi des décrocheurs est inférieur d’environ 5 000 $ par rapport à celui des finissants, et de plus de 15 000 $ par rapport à celui des finissants du modèle de groupe. Leur revenu est presque le même que celui des individus qui font partie du modèle complet. Ces données sont cohérentes au modèle précédent selon lequel la poursuite de l’apprentissage favoriserait plus un avantage salarial que le décrochage.
L’efficacité prédictive de ce modèle ainsi que les effets des autres variables explicatives sont environ les mêmes que pour le modèle précédent. Le graphique de variable explicative n’est donc pas répété.
Graphique 3.33 Coefficients de régression du revenu d’emploi de 2009 selon le statut de 2004, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier, de la région
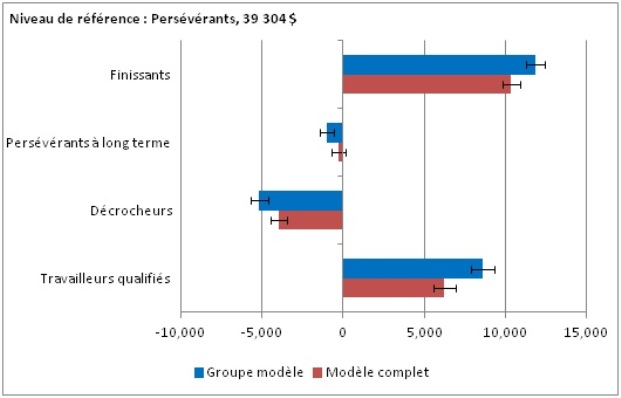
Description de l’image Graphique 3.33 Coefficients de régression du revenu d’emploi de 2009 selon le statut de 2004, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier, de la région
Il s’agit d’un diagramme en barres illustrant les coefficients de régression du revenu d’emploi de 2009, selon le statut de 2004, en tenant compte de l’âge, du sexe, du métier et de la région. Le niveau de référence est celui des persévérants (39 304 $). Chaque coefficient compte une petite barre représentant un écart-type.
En ce qui a trait aux coefficients du groupe modèle, ils sont de 11 872 pour les finissants; ‑1 011 pour les persévérants à long terme; -5 160 pour les décrocheurs, et 8 632 pour les travailleurs qualifiés.
En ce qui a trait aux coefficients du modèle complet, ils sont de 10 370 pour les finissants; -279 pour les persévérants à long terme; -3 954 pour les décrocheurs, et 6 243 pour les travailleurs qualifiés.
3.5 Résultats sociodémographiques
En comparaison aux autres parties, la capacité à examiner les résultats sociodémographiques est limitée par le manque relatif de données dans ce secteur dans les banques de données accessibles. L’analyse est donc limitée à quelques résultats sur l’attitude et la satisfaction tirés des études de l’ENA de 2007 et à quelques résultats sur la participation des femmes et des immigrants. Les femmes et les immigrants sont considérés comme des résultats puisque l’augmentation de la participation de ces groupes est parfois considérée comme une manière d’augmenter la participation générale aux métiers et à l’apprentissage, ce qui permet d’augmenter les sources de travailleurs.
3.5.1 Attitude et satisfaction
Un des rapports de l’ENA de 2007 (CCDA, 2010) était spécialement consacré à la perception des répondants de la qualité de la formation d’apprentissage. Ce rapport a fourni plusieurs résultats sur l’attitude des participants envers le programme et leur satisfaction quant à sa qualité. Voici un résumé de ces résultats :
- dans l’ensemble, plus de 85 % des apprentis dans chacun des trois groupes de programmes (finissants, persévérants à long terme et décrocheurs) signalaient « ne pas avoir éprouvé de difficultés » lors des volets de la formation en milieu de travail ou technique ;
- les répondants qui ont affirmé ne pas avoir éprouvé de difficultés lors de la formation ont aussi fourni des réponses positives sur les autres aspects de leur expérience d’apprentissage, incluant le rythme de l’apprentissage, leur compréhension des nouvelles tâches ou les leçons apprises en classe ;
- seules quelques différences mineures ont été déterminées quant à la perception de la qualité des formations techniques ou en milieu de travail en fonction des caractéristiques sociodémographiques des apprentis ;
- il n’y avait aucune différence dans la perception de la difficulté de la formation en milieu de travail analysée en fonction de l’âge au moment de l’inscription. Par contre, les apprentis qui avaient moins de 25 ans au moment de leur inscription à l’apprentissage étaient moins susceptibles de signaler d’éventuelles difficultés lors de la formation technique que les apprentis qui avaient plus de 25 ans lorsqu’ils se sont inscrits ;
- plus le niveau d’instruction des apprentis était élevé au moment de l’inscription, moins les apprentis étaient susceptibles de signaler des difficultés lors de la formation technique ;
- les apprentis qui avaient déjà de l’expérience de travail dans leur métier avant leur inscription à l’apprentissage avaient une perception un peu plus positive de leur cheminement d’apprenti que les apprentis qui n’avaient pas d’expérience dans leur métier ;
- plus le milieu de travail était petit, plus les apprentis étaient susceptibles de signaler que la formation en milieu de travail leur avait permis d’accomplir des tâches variées pour se préparer à l’examen de reconnaissance professionnelle ;
- une plus grande proportion des apprentis, qui ont suivi leur formation technique auprès d’agents de mise en œuvre privés ou au centre de formation d’un syndicat ou d’une entreprise, ont affirmé ne pas avoir éprouvé de difficultés lors de la formation technique comparativement aux apprentis qui ont suivi leur formation dans une école de métiers, un centre de formation professionnelle ou un collège communautaire ;
- un plus grand nombre de différences a été observé entre les finissants, les persévérants à long terme et les décrocheurs pour la formation technique que pour la formation en milieu de travail. Par exemple, les finissants étaient plus nombreux à avoir une opinion positive par rapport au rythme de la formation technique, suivi des décrocheurs et des persévérants à long terme ;
- les persévérants à long terme étaient plus susceptibles que les finissants et les décrocheurs de signaler des difficultés à comprendre les documents écrits présentés en classe ou en ligne ;
- les apprentis qui ont trouvé un emploi après avoir terminé leur formation étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils n’avaient éprouvé « aucune difficulté » lors de leur formation en milieu de travail que ceux qui s’étaient déclarés sans emploi après leur formation d’apprentissage.
Tous ces résultats indiquent une attitude généralement positive et un grand niveau de satisfaction par rapport aux programmes d’apprentissage.
3.5.2 Participation des groupes cibles
Une des études de l’ENA de 2007 (Laryea et Medu, 2010) était aussi consacrée à la question des taux de participation de groupes cibles précis, soit les femmes, les Autochtones et les immigrants. Ce rapport ne sera pas résumé en détail dans ce document. Nous nous contenterons de dire que les femmes étaient le groupe le moins représenté. En effet, à peine 10 % environ des répondants à l’ENA étaient des femmes (alors que les femmes représentent près de 50 % de la population active), et une importante proportion des femmes travaillaient dans deux métiers, soit ceux de coiffeur et de cuisinier. Les immigrants étaient aussi sous-représentés. La participation de ce groupe était environ inférieure de moitié à la participation attendue chez les immigrants. Par contre, la participation des Autochtones correspondait à la proportion de leur population.
Le fichier couplé du SIAI/FFT1/BDIM nous permet de quelque peu extrapoler ces résultats à la population générale d’apprentis pour les femmes et les immigrants. Des données en série temporelle sur la participation des femmes par métier sont aussi présentées par Statistique Canada par l’entremise du CANSIM. Malheureusement, plusieurs données concernant les individus à identité autochtone sont manquantes dans le SIAI, ce qui nous amène à juger que tout résultat serait trop peu fiable pour être présenté dans un rapport.
Une des plus importantes questions concernant la participation des femmes à l’apprentissage est de déterminer si la proportion des femmes dans les métiers a augmenté, comme il a été le cas pour la plupart des autres professions. Le graphique 3.34 montre le pourcentage de femmes qui ont obtenu une reconnaissance grâce à un programme d’apprentissage ou encore un titre professionnel de 1991 à 2010. Les métiers de coiffeur/esthéticiens et de préposé aux services alimentairesNote de bas de page 25 ont été séparés puisqu’ils sont les seuls où l’on observe une importante participation des femmes. Tous les autres métiers ont été examinés en tant que groupes puisque, malgré les faibles proportions, ils révèlent une tendance temporelle intéressante.
Graphique 3.34 Pourcentage des apprenties et des travailleuses qualifiées, de 2001 à 2010 [Source : CANSIM]
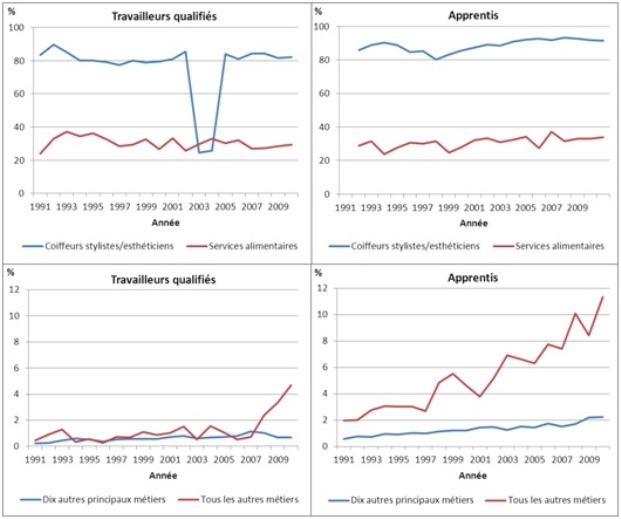
Description de l’image Graphique 3.34 Pourcentage des apprenties et des travailleuses qualifiées, de 2001 à 2010 [Source : CANSIM]
Il s’agit de graphiques linéaires simples illustrant le pourcentage d’apprenties et de travailleuses qualifiées, de 2001 à 2010. Il y a quatre graphiques : un pour les travailleuses qualifiées qui occupent un emploi de coiffeuse-styliste, d’esthéticienne ou un emploi dans les services alimentaires; un pour les apprenties qui occupent un emploi de coiffeuse-styliste, d’esthéticienne ou un emploi dans les services alimentaires; un pour les travailleuses qualifiées qui occupent un emploi dans l’un des dix principaux métiers ou tous les autres métiers; et un pour les apprenties qui occupent un emploi dans l’un des dix principaux métiers ou tous les autres métiers.
Le pourcentage de travailleuses qualifiées occupant le poste de coiffeuse-styliste ou d’esthéticienne était de 83,3 % en 1991 et il est demeuré stable jusqu’en 2003, année où il a diminué très rapidement à 24,4 %. Il est demeuré faible pendant une année et a remonté rapidement à 84,1 % en 2005, et il est demeuré constant jusqu’en 2010. Le pourcentage de travailleuses qualifiées occupant un emploi dans les services alimentaires était de 23,9 % et il est demeuré entre 25 % et 35 % de 1991 à 2010.
Le pourcentage de travailleuses qualifiées occupant un emploi dans tous les autres dix principaux métiers était de 0,2 %, et il est demeuré entre 0,2 % et 1 % de 1991 à 2010. Le pourcentage de travailleuses qualifiées dans tous les autres métiers variait entre 0,5 % et 1 % de 1991 à 2007, lorsque le pourcentage a commencé à augmenter. Il a augmenté de 2007 à 2010, de 0,7 % en 2007 à 4,7 % en 2010.
Le pourcentage d’apprenties qui occupent le métier de coiffeuse-styliste ou d’esthéticienne est demeuré constant entre 80 % et 90 % de 1991 à 2010. Le pourcentage d’apprenties occupant un métier dans les services alimentaires a varié entre 28 % et 33 % de 1991 à 2010. Le pourcentage le plus élevé a été en 2008 et le plus faible a été en 1994.
Le pourcentage d’apprenties dans les 10 autres principaux métiers était de 0,6 % en 1991, et ce pourcentage a augmenté de manière constante jusqu’à 2,2 % en 2010. Le pourcentage d’apprenties dans tous les autres métiers était de 2,0 % en 1991. Le pourcentage a fluctué selon une tendance à la hausse pour atteindre son sommet le plus élevé de 11,3 % en 2010.
Ces graphiques montrent que les femmes représentent environ 80 % des travailleurs qualifiés et 90 % des apprentis dans les métiers de coiffeur et d’esthéticien. Le pourcentage d’apprenties a augmenté quelque peu de 1997 à 2005 environ avant de chuter légèrement à nouveau. La forte baisse dans la proportion des travailleuses qualifiées de 2003 à 2004 a été causée par une importante hausse du nombre d’hommes ayant obtenu un certificat à cette époque, alors que le nombre de femmes n’avait pas beaucoup changé. Il est difficile d’expliquer ce phénomène à partir des tableaux du CANSIM desquels sont tirées ces données.
Dans les services alimentaires, le pourcentage de femmes dans les deux groupes a fluctué légèrement d’une année à l’autre, mais sans présenter de tendance précise au fil du temps. Le pourcentage global était d’environ 30 % sur la période complète.
La proportion de travailleuses qualifiées dans tous les autres métiers est demeurée très faible, soit de moins de 1 % au cours de la majorité de la période. L’exception est une forte augmentation dans tous les autres métiers depuis 2007. Bien que cela ne représente qu’environ 5 % de femmes en 2010, il sera intéressant de voir s’il s’agit du début d’une tendance à long terme.
La tendance chez les apprentis dans les dix autres métiers les plus populaires a été une augmentation relativement régulière. Malgré cette augmentation de la participation, le niveau n’a atteint qu’environ 2 % au cours des dernières années. Une tendance plus prononcée est apparente pour tous les autres métiers, où on observe une augmentation claire d’environ 3 % au début des années 1990 à 11 % en 2010. Cette augmentation l’emportait sur certaines des fluctuations observées d'une année sur l'autre.
CANSIM ne fournit pas de données comparables concernant les immigrants. Certains renseignements sont offerts par le fichier couplé puisque le statut d’immigration est reconnaissable à partir de variables de la BDIM incluses dans ce dossier. En raison des petits nombres (et de la suppression de données par Statistique Canada qui en résulte), ce document ne fournit pas de répartition en sections détaillée par province et territoire. Par contre, en raison de tendances relatives à l’immigration plus communes dans certaines provinces ou certains territoires, il est possible de fournir une répartition régionale en section. Cela est illustré dans le graphique 3.35.
Ce graphique indique que la proportion générale d’immigrants inscrits à des programmes d’apprentissage est d’environ 8 %; un pourcentage beaucoup plus bas que la population d’immigrants d’environ 20 % enregistrée lors du Recensement. La participation des immigrants est distribuée de façon inégale à l’échelle régionale. En Ontario, on enregistre une proportion supérieure à la moyenne canadienne. En Alberta et en Colombie-Britannique, la participation des immigrants aux programmes d’apprentissage est près de la moyenne nationale, alors qu’elle est beaucoup inférieure à la moyenne dans les provinces de l’Atlantique ainsi qu’au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces résultats sont raisonnablement cohérents avec les tendances de l'immigration dans chaque région.
Graphique 3.35 Pourcentage d’immigrants du SIAI de 2008 par région [Source : fichier couplé du SIAI/BDIM]
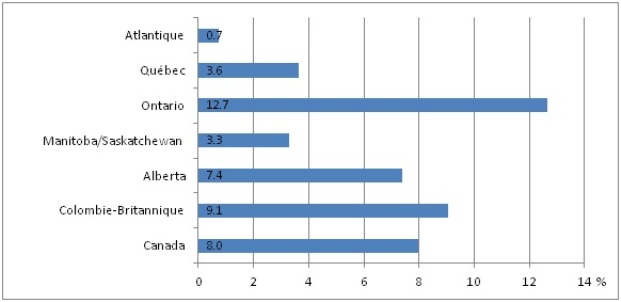
Description de l’image Graphique 3.35 Pourcentage d’immigrants du SIAI de 2008 par région [Source : fichier couplé du SIAI/BDIM]
Il s’agit un diagramme en barres illustrant le pourcentage d’immigrants à partir du SIAI de 2008, selon la région.
Le pourcentage d’immigrants en 2008, selon le SIAI, était de 0,7 % dans le Canada atlantique; 3,6 % au Québec; 12,7 % en Ontario; 3,3 % au Manitoba et en Saskatchewan; 7,4 % en Alberta; 9,1 % en Colombie-Britannique, et 8,0 % au Canada.
3.6 Résumé et conclusions
Ce chapitre dégage trois types de résultats associés à l’apprentissage et à la formation dans les métiers. Il s’agit des résultats de l'éducation et la formation, des résultats obtenus sur le marché du travail et des résultats sociodémographiques. Les sources de données accessibles fournissent une abondance de renseignements sur les deux premiers types de renseignements, mais très peu sur le troisième.
Les principales conclusions tirées dans ce chapitre peuvent être résumées comme suit :
3.6.1 Résultats associés à la réussite et à la reconnaissance
- Dans l’ensemble de la population active, la proportion de détenteurs d’un certificat d'une école de métiers de tout genreNote de bas de page 26 est demeurée stable à environ 12 % depuis plus de 20 ans.
- Parmi les personnes qui travaillaient dans les métiers en 2005 (données tirées du Recensement de 2006), environ 17 % avaient un certificat d'apprenti inscrit. Une proportion semblable détenait un autre type de certificat d'une école de métiers comme plus haut niveau d’éducation. C’était chez les électriciens et les plombiers qu’on retrouvait le plus grand nombre de personnes ayant un certificat d'apprenti inscrit (près de 36 %), et chez les cuisiniers que l’on comptait le plus petit nombre titulaires d’un certificat d'apprenti inscrit (4 %).
- On a enregistré une importante hausse dans l’achèvement des formations d’apprentissage, ce qui est cohérent avec la tendance d’augmentation du nombre d’inscriptions aux programmes d’apprentissage, mais avec un retard causé par le temps nécessaire pour terminer la formation. En 2010, 36 000 participants ont terminé leur formation d’apprentissage, alors que moins de 20 000 participants l’avaient terminée la décennie dernière.
- Une décennie après l’inscription, le taux de réussite des programmes d’apprentissage avait tendance à se chiffrer autour de 50 % chez les candidats qui s’étaient inscrits dans les années 1990. D’après les résultats, les taux de réussite pourraient avoir diminué pour atteindre environ 40 % pour les participants qui s’étaient inscrits au début des années 2000.
- Un nombre relativement peu élevé d’apprentis termine le programme après six ans. Après cette période, la majorité des participants ont décroché de leur programme. Le pourcentage de personnes qui poursuivent leur programme durant dix ans ou plus n’a pas beaucoup changé au fil du temps (environ 9 %).
3.6.2 Résultats obtenus sur le marché du travail
- Dans le passé, les taux de chômage étaient un peu plus élevés dans les métiers que dans les autres professions, particulièrement dans les métiers de la construction.
- Selon le Recensement de 2006, pour tous les niveaux d’instruction inférieurs au baccalauréat, le revenu annuel médian dans les métiers était plus élevé que dans toutes les autres professions. En effet, les personnes qui possédaient un certificat d'apprenti inscrit et qui travaillaient dans un métier avaient un revenu plus élevé que celles qui avaient un baccalauréat, même si ces dernières travaillaient dans un métier ou non. Il existe néanmoins d’importantes différences entre les niveaux de revenu dans les différents métiers.
- Au cours de la période de 2002 à 2009, les travailleurs qualifiés et finissants de programmes d’apprentissage de 2004 gagnaient un salaire beaucoup plus élevé que les persévérants, les persévérants à long terme ou les décrocheurs. Les avantages de salaire offerts sont très différents entre les différents métiers (ils varient moins entre les territoires/provinces). En effet, les métiers liés aux services n’offrent pratiquement pas d’avantage salarial, alors que certains métiers associés à la mécanique peuvent offrir des avantages pouvant atteindre 20 000 $ ou plus.
- Les travailleurs qualifiés qui ont terminé leur formation en 2008 recevaient un salaire plus élevé que les autres groupes au cours des sept années précédentes. Les finissants de 2008 ont atteint le même niveau de revenu que les travailleurs qualifiés en 2008, et leur revenu a légèrement dépassé celui de ce groupe en 2009.
- À quelques variations près, les différences du revenu d’emploi chez les groupes définis demeurent constantes, dans la mesure où certaines variables comme le sexe, l’âge, le métier et la province ou le territoire, sont contrôlées.
- Dans l’ensemble, le travail autonome est relativement rare dans les métiers, mais il est plus commun chez les travailleurs qualifiés que dans les autres groupes. Parmi les travailleurs qualifiés, le travail autonome est le plus pratiqué (20 % à 30 %) chez les coiffeurs-stylistes/barbiers, les charpentiers, les plombiers et les électriciens. Le revenu net tiré du travail indépendant est généralement beaucoup plus bas que celui tiré d’un emploi régulier. Bien que plusieurs travailleurs indépendants aient aussi déclaré recevoir un revenu d’emploi, le revenu combiné chez ce groupe demeure beaucoup plus bas que le revenu des personnes qui ne travaillent pas à leur compte.
- Les modèles de régression du revenu de 2009 pour les groupes définis du SIAI de 2004 et 2008 montrent que les avantages salariaux offerts aux finissants des programmes d’apprentissage et aux travailleurs qualifiés sont réduits, mais qu’ils demeurent importants quand les autres facteurs qui contribuent au revenu sont contrôlés. Plus particulièrement, les avantages offerts aux apprentis finissants de 2008, par rapport aux persévérants, sont d’environ 18 000 $, alors qu’ils sont d’environ 10 000 $ pour les finissants de 2004 (dont certains auraient terminé leur programme d’apprentissage avant 2009). Les avantages de salaire offerts aux travailleurs qualifiés, par rapport aux persévérants, sont près de 10 000 $ pour les personnes qui ont terminé leur programme d’apprentissage en 2008 et de 6 000 $ pour celles qui ont terminé leur programme d’apprentissage en 2004.
- En 2009, la mobilité interprovinciale était moins fréquente chez les finissants et plus fréquente chez les décrocheurs et les travailleurs qualifiés. Les travailleurs qualifiés et les apprentis certifiés qui avaient obtenu le Sceau rouge, étaient plus mobiles que ceux qui ne l’avaient pas obtenu.
- Dans l’ensemble, c’est en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick que l’on comptait le plus grand nombre d’apprentis qui quittaient leur province de 2002 à 2009. La grande majorité des travailleurs de tous les groupes qui quittaient ces provinces se rendaient en Alberta, à l’exception des travailleurs qualifiés qui n’avaient pas la mention Sceau rouge. La Colombie-Britannique était la deuxième destination en importance, bien que le nombre de travailleurs à s’y rendre fût beaucoup plus faible que celui des travailleurs qui choisissaient l’Alberta.
3.6.3 Résultats sociodémographiques
- De façon générale, les répondants à l’ENA de 2007 avaient une opinion positive de l’apprentissage, et seul un petit nombre de personnes avaient éprouvé des difficultés lors de la formation technique ou en milieu de travail. Les participants qui avaient un niveau d’instruction plus élevé et de l’expérience de travail avaient tendance à avoir une attitude plus positive envers l’apprentissage.
- Les apprenties sont concentrées dans quelques métiers, particulièrement ceux de coiffeur et de cuisinier. L’augmentation du nombre de femmes dans les métiers a été lente. Néanmoins, même au cours des dernières années, les femmes ne représentent qu’environ 2 % des travailleurs dans les métiers les plus populaires (autres que les métiers de coiffeur et de cuisinier), et environ 11 % dans tous les autres métiers. On compte aussi très peu de travailleuses qualifiées, peu importe le secteur.
- Les immigrants sont également sous-représentés dans les métiers, où ils ne représentent qu’environ 8 %, comparativement à 20 % dans la population générale. La proportion d’apprentis immigrants varie considérablement d’une région à l’autre. En Ontario, on enregistre une proportion supérieure à la moyenne canadienne. En Alberta et en Colombie-Britannique, cette proportion est près de la moyenne nationale, alors qu’elle est beaucoup inférieure à la moyenne dans les provinces de l’Atlantique, au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan
Encore une fois, on remarque que la capacité à examiner les résultats sociodémographiques était limitée par un manque de données. Par exemple, il n’était pas possible d’approfondir la question de la participation des Autochtones parce que les sources de données accessibles ne permettaient pas d’identifier les personnes d'origine autochtone.
3.6.4 Conclusions
Les personnes qui ont un certificat d'une école de métiers ou un certificat d’apprentissage ne représentent environ que le tiers de la main-d’œuvre totale dans les métiers. Dans une population active dont le niveau d’instruction augmente généralement, la proportion de personnes qui détient de tels certificats n’a pratiquement pas changé en plus de 20 ans. En tenant pour acquis que la reconnaissance représente un atout recherché pour les personnes de métier, ce phénomène suggère qu’il y a beaucoup de place pour la croissance de la reconnaissance dans les métiers. L’augmentation du nombre d’inscriptions aux programmes d’apprentissage et, par incidence, l’augmentation du nombre de finissants, indique que cette croissance pourrait se produire au cours des quelques prochaines années.
L’augmentation du nombre d’inscriptions au début des années 2000 semble avoir été accompagnée par un certain déclin du nombre de participants qui terminaient leur programme d’apprentissage, comme il a été observé lors du suivi des cohortes de 2003 à 2009. Ce phénomène n’est peut-être pas surprenant puisqu’il pourrait y avoir un certain retard entre la capacité de l’industrie à accepter les nouveaux apprentis et la capacité de ces derniers à réussir leur programme d’apprentissage. Étant donné le retard inévitable dû au suivi, il serait utile de mettre à jour les données accessibles avec celles plus récentes du SIAI.
Les travailleurs qualifiés demeurent une importante source de nouveaux diplômés, même si la proportion de personnes qui reçoit un certificat grâce à ce cheminement est en déclin par rapport à la proportion de nouveaux diplômés de programmes d’apprentissage. Il y a des raisons d’encourager l’obtention de titres professionnels, particulièrement puisque la main-d’œuvre dans les métiers inclut de toute évidence un grand nombre de travailleurs expérimentés qui n’ont jamais obtenu de titre professionnel.
La principale conclusion que l’on peut tirer des nombreux résultats qui ont été présentés concernant les revenus est que, dans la majorité des métiers, d’importants avantages salariaux sont associés à la détention d’un titre professionnel. Ce constat appuie très fortement la conclusion selon laquelle l’obtention d’un titre professionnel représente une réussite valorisée. Le revenu ne semble pas être beaucoup influencé par l’obtention d’un titre professionnel grâce à un programme d’apprentissage ou d’un programme de reconnaissance professionnelle. Par contre, en moyenne, les apprentis obtiennent un titre professionnel beaucoup plus tôt que les autres, ce qui permet de compenser les coûts liés à l’apprentissage. Cependant, les primes offertes varient beaucoup selon les métiers, ce qui démontre que les titres professionnels sont beaucoup plus importants dans certains métiers que dans d’autres. Toute intervention politique visant à appuyer l’obtention d’un certificat doit donc tenir compte de ces différences.
Les résultats associés au fossé des sexes sont très intéressants puisqu’ils renforcent l’idée que ce fossé est principalement le résultat de la concentration des femmes dans quelques métiers peu payants. Le très petit nombre de femmes qui travaillent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes obtiennent des résultats aussi bons, et même de meilleurs dans certains métiers, que les hommes
Contrairement aux résultats associés au revenu, la reconnaissance professionnelle ne semble pas être un facteur important pour ce qui est de la mobilité des travailleurs. Le fait que les finissants des programmes d’apprentissage se déplacent moins que les autres indique que la réussite de la formation pourrait représenter un facteur favorisant la stabilité d’emploi, réduisant ainsi le besoin de se déplacer. Parallèlement, les travailleurs qualifiés se déplacent plus que les autres, qu’ils aient la mention Sceau rouge ou non. La mobilité pourrait en effet encourager les travailleurs qualifiés à obtenir un titre professionnel.
Bibliographie du chapitre 3
Ahmed, N. (2010). Enquête nationale auprès des apprentis 2007: L’influence du marché du travail et des conditions économiques sur l’achèvement et la poursuite à long terme des programmes d’apprentissage au Canada. Ottawa: CCDA/RHDCC
Boothby, D. et Drewes, T. (2006). Postsecondary Education in Canada: Returns to university, college and trades education. Analyse de politique. 32, 1, 1-22.
Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage (2010). Perceptions de la qualité de la formation. Ottawa: Auteur
Desjarsins, L et Paquin, N. Apprentis inscrits : les cohortes de 1994 et 1995, une décennie plus tard. Ottawa: Statistique Canada. Récupéré le 2 février 2012 du site Web http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=81-595-m&lang=fra
Gunderson, M. et Krashinsky, H. (2004). Rates of Return to Apprenticeship and Post-Secondary Education in Canada. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario
Gunderson, M. et Krashinsky, H. (2012). Returns to Apprenticeship: Analysis Based on the 2006 Census. Document de travail no 99. Réseau canadien de chercheurs dans le domaine du marché du travail et des compétences
Laryea, S. et K. Medu. 2010. Enquête nationale auprès des apprentis de 2007 : Apprenticeship in Canada: Participation of Women, Immigrants and Aboriginal People in Apprenticeship Programs. Ottawa : CCDA/RHDCC.
Morissette, D. (2008) Apprentis inscrits: la cohorte de 1993, une décennie plus tard. Ottawa : Statistique Canada
Prasil, S. (2005) Apprentis inscrits : la classe de 1992, une décennie plus tard.
Ottawa : Statistique Canada
Notes
- Note de bas de page 11
-
Puisque les données du SIAI n’étaient disponibles que jusqu’en 2009, 2003 fut la dernière année pour laquelle il fut possible de faire le suivi des apprentis sur une période d’au moins six ans. Avec la méthodologie utilisée, ces chiffres peuvent être aisément mis à jour dès que de nouvelles données du SIAI sont disponibles. De plus, les améliorations en matière de divulgation des années d’inscription au cours des dernières années faciliteront le calcul des taux de réussites de toutes les provinces et tous les territoires.
- Note de bas de page 12
-
L’ENA de 2007 a bel et bien un groupe de finissants sans certificat. Toutefois, on considère que cette situation est le fruit du délai entre la réussite des exigences d’apprentissage et la réussite de l’examen menant à la reconnaissance professionnelle. Dans le SIAI, hormis quelques rares exceptions, les participants ne sont pas considérés comme des finissants à moins d’être titulaires d’un certificat.
- Note de bas de page 13
-
Les travailleurs qualifiés contribuent considérablement au nombre total de travailleurs titulaires d’un certificat chaque année. Le nombre de certificats remis à des travailleurs qualifiés est indiqué dans le chapitre 4.
- Note de bas de page 14
-
Ces chiffres furent calculés à partir du fichier de micro données à grande diffusion dans le cadre de l’EPA. Les groupes de métiers sont donc plus vastes que ceux utilisés pour les dix métiers les plus importants dans ce rapport.
- Note de bas de page 15
-
Ces résultats sont tirés du fichier de microdonnées à grande diffusion du Recensement qui inclut toute profession du groupe H de la CNP-S dans les métiers (nous avons cependant exclu le groupe H-8 du tableau). Dans les faits, quelques métiers d’apprentissage se trouvent dans des groupes autres que le groupe H. De plus, ce ne sont pas tous les sous-groupes qui comprennent des métiers d’apprentissage. Néanmoins, c’est le groupe H de la CNP-S qui illustre le mieux les professions liées aux métiers. Les chiffres sont donc exacts pour un grand nombre de professions semblables aux métiers.
- Note de bas de page 16
-
Les cinq groupes utilisés aux fins de la présente étude sont les finissants, les persévérants, les persévérants à long terme, les décrocheurs et les travailleurs qualifiés.
- Note de bas de page 17
-
Dans les faits, nous ne pouvons connaître l’état actuel de chaque individu au cours de toutes les années pour lesquelles nous avons des données sur le revenu, car cette information du SIAI n’est pas toujours comprise dans le fichier couplé. L’état n’est indiqué que pour les SIAI de 2004 et 2008.
- Note de bas de page 18
-
Il s’agit du salaire annuel pour l’année faisant l’objet du rapport, et non de dollars constants.
- Note de bas de page 19
-
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan.
- Note de bas de page 20
-
Ce ne sont pas tous les répondants de 2008 qui indiquèrent leur revenu d’emploi pour l’ensemble de ces années. Cependant, environ les deux tiers fournirent leur revenu à partir de 2002, ce qui signifie que cette proportion de travailleurs participa à la population active pendant l’ensemble de la période. Plus de 90 % fournirent leur revenu en 2008 et 2009.
- Note de bas de page 21
-
Il n’y avait pas assez de travailleurs autonomes dans les Territoires pour fournir des résultats stables.
- Note de bas de page 22
-
Une approche marginale est requise, car les variables liées aux groupes sont mutuellement exclusives et codées en tant que variables indicatrices. Les modèles de régression ne peuvent être calculés lorsque toutes les données sont comprises dans un groupe de variables indicatrices. On résout ce problème en utilisant l’un des groupes en tant que référence et en comparant tous les autres à celui-ci.
- Note de bas de page 23
-
Les coefficients pour toutes les variables du modèle complet sont présentés à l’annexe A.
- Note de bas de page 24
-
Les lignes à la fin de chaque colonne sont des barres représentant un écart-type. Elles représentent la marge d’erreur, au niveau de confiance de 0,95, pour chaque coefficient. Les différences entre les coefficients sont jugées importantes sur le plan statistique si les barres ne se chevauchent pas.
- Note de bas de page 25
-
Ces deux secteurs portent des noms un peu différents dans le CANSIM et le SIAI, mais cette nuance ne modifie pas les résultats généraux.
- Note de bas de page 26
-
L’EPA ne fait pas de distinction entre les travailleurs qui ont un certificat d’apprenti inscrit et ceux qui ont une autre forme de certificat d'une école de métiers. Durant la majorité de la période, il n’y a eu qu’une faible croissance du nombre de réussites des programmes d’apprentissage. Cette tendance a changé au cours des dernières années.
- Date modified:

